Coming on October 1st from Telos Press Publishing: Ernst Jünger’s Sturm. Pre-order your copy today, and we will ship it as soon as it is available.
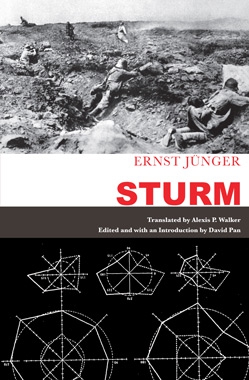 Sturm
Sturm En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ernst Jünger, Katholik
von Alexander Pschera
Ex: https://erstezone.wordpress.com
Ernst Jünger konvertierte kurz vor seinem Tod zur katholischen Kirche. Die Bücher seines Spätwerks weisen den Weg dahin. Sie lassen sich als eine Theologia in Nuce lesen. Allen voran der Essay Die Schere.
Als Ernst Jünger am 26. September 1996 zum katholischen Glauben konvertierte, zeigten sich viele Zeitgenossen überrascht – und zwar, weil man gerade von Jünger annahm, er habe die traditionelle Religion mit einer „neuen Theologie“ überwunden. Diese neue Theologie trat auf als ein mythologisches Denken großen Maßstabs. Jüngers mythischem Denken traute man zu, die Verwerfungen und Umbrüche der Moderne wenn nicht begrifflich, so doch zumindest bildhaft klären und an die ewigen Kräfte der Erde rückbinden zu können. Jünger galt als homo mythologicus, weniger als homo religiosus. Die Konversion schreckte daher auf. Sie erschien als Rückschritt, als eine Aufgabe desjenigen Postens, den Jünger nie verließ, als Abflachung eines plastischen Bilderuniversums. Warum dieser Regressus ad Romam?
Liselotte Jünger bekannte, ihr Mann habe den Wunsch geäußert, so beerdigt zu werden „wie alle hier“ – mit „hier“ ist die Dorfgemeinschaft des oberschwäbischen Wilflingen gemeint, in dem Jünger die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte. Kaum einer der Exegeten gab sich mit solch einer Erklärung zufrieden. So wurde das Werk Jüngers auf katholische Spuren hin abgeklopft mit dem Ziel, die Konversion als den letzten Schritt eines Prozesses darzustellen. Bei dieser Suche nach religiösen Motiven wurde man fündig. Zwar enthalten die Bücher, die auf die Erfahrung des ersten Weltkriegs zurückgehen, allen voran die Stahlgewitter, höchstens para-religiöse Momente. Aber im zweiten Weltkrieg, so bezeugen es Jüngers Tagebücher Strahlungen, vollzieht sich eine Wendung hin zum Christentum. Diese Tagebücher belegen eine zweimalige Bibellektüre, eine Zuwendung zu den Kirchenvätern und zu Léon Bloy, den Jünger durch Carl Schmitt kennenlernte. Jüngers Schrift Der Friede, die in der Endphase des zweiten Weltkriegs im Kreis des Widerstands zirkulierte, beruft sich auf den 73. Psalm – der auch bei der Konversionsfeier eine Rolle spielte – und konstatiert, daß die „humanitäre“ Wandlung, die nach dem Krieg erforderlich ist, von einer „theologischen“ zu begleiten sei. Und auch im Alterswerk, vor allem in der Serie der Tagebücher Siebzig verweht, stößt man immer wieder auf Notate, die eine christliche Haltung bezeugen: Das Gebet „gibt dem Menschen, vor allem in unseren nördlichen Breiten, die einzige Pforte zur Wahrheit, zur letzten und rücksichtslosen Ehrlichkeit“ (Siebzig verweht II). Auch positiv besetzte Figuren wie der naturgelehrte und zum Martyrium bereite Pater Lampros vom Kloster Maria Lunaris aus dem Roman Die Marmorklippen (1939) wurden zitiert, um Jüngers Respekt vor der katholischen Welt zu unterstreichen – und sie wurden einer blassen Figur wie dem Superintendenten Quarisch aus dem Roman Die Zwille (1973) gegenüberstellt, um zu zeigen, wie weit sich Jünger von der entmythologisierten protestantischen Kirche seiner Zeit entfernt hatte. Kurz: Jüngers Konversion zum Katholizismus erschien vor dem Hintergrund seines vielschichtigen Lebensprogramms als logischer Schritt hin zu einer umfassenden, universellen Religion, ja es erschien als roter Faden, als sinnstiftende Einheit in der Vielfalt dieses Lebens.

Richtig ist, daß Jünger in den Jahren des zweiten Weltkrieges, die er in Paris und an der Ostfront erlebte, angesichts der Kriegsgräuel tatsächlich eine christliche Wende vollzog. Doch schon bald zeigte er auch ein reges Interesse an der Gnosis. In den fünfziger Jahren heißt es in einem Brief an seinen Sekretär Armin Mohler, daß der Autor sich „von theologischen Neigungen freihalten [müsse]. Sie sind Belege, Fundstellen für ihn“ (2.4.1959). In der Tat sammelt Jüngers Werk denn auch Belege für alle möglichen Formen der Transzendenz, ohne daß der Autor sein Denken einem religiösen System anvertraut. Griechische Mythologie, Buddhismus, Taoismus, pantheistische Strömungen, chassidische Lehren, orientalische Weisheiten, die Kirchenväter, immer wieder auch biblische, vor allem alttestamentarische Motive, aber auch literarische Quellen, die, wie Hölderlin, in den Rang von Mythenspendern erhoben werden, macht Jünger für die Interpretation unseres Weltzeitalters nutzbar. Dabei entwickelt er den Kampf zwischen den Titanen – Chiffre für die alles beherrschende Welt der Technik – und den zurückgezogenen Göttern als Leitmotiv. Gerade das Motiv des Rückzugs der Götter, ihre Abwesenheit, zeigt, wie Jünger sammelt und arbeitet. Dieses Motiv wird von ihm mit Léon Bloys vielzitierter – aber nicht wörtlich nachgewiesener – Rede vom „zurückgezogenen Gott“ und auch mit Hölderlins Versen („Zwar leben die Götter / Aber über dem Haupt droben in anderer Welt“) parallelisiert. Ob „Gott“ oder „Götter“ ist dabei sekundär. Entscheidend ist der Rückzug der göttlichen Substanz. Dieser Rückzug der göttlichen Substanz hinterläßt ein mit sich selbst beschäftigtes, materialistisches und durchorganisiertes Diesseits, in dem nur noch der Mensch für sich selbst und für Ordnung unter seinesgleichen sorgt: „Inzwischen haben wir eine Station erreicht, in der auch die Physik Gleichnisse anbietet. Das hängt damit zusammen, daß sie in die Lücke eindringt, die der Rückzug der Götter hinterlassen hat“ (Die Schere, 18). Doch gibt es im mythologischen Bezugssystem Jüngers auch Hoffnung auf die Wiederkehr des Göttlichen, die sich vor allem in Gestalt der Mutter Erde konkretisiert.
Diese Form der mythologischen Belegentnahme ist eine Spielart postmodernen, postmythischen Denkens. Jünger wurde vor allem mit seinen Büchern An der Zeitmauer (1959) und Über die Linie (1950) zu einem Vorläufer dessen, was später als Diskurs der Postmoderne bekannt wurde. Wäre Jünger ein systematischer Denker, so hätten sich seine Mythenkollektionen zu einem widerspruchslosen System verhärtet. Doch zum Glück war Jünger kein Systematiker. Jüngers Reflexionen entspringen einem vorrationalen, vorbegrifflichen Bezirk. Seine Begriffe entwachsen einem bildlichen Ursprung und tragen bei aller Prägnanz die Mehrdeutigkeiten und Widersprüche des Metaphorischen in sich. Dies läßt sich am Begriff der Zeitmauer zeigen. Er meint nicht, daß vor der Mauer die Zeit und die Geschichte existierten und hinter ihr etwas anderes, aber eben nicht mehr „Zeit“ und „Geschichte“ in unserem jenseitigen Verständnis: „Man kann die Außenwand der Zeitmauer auch als Brunnenrand sehen. (…). Moos und Efeu, die oben am Brunnenrand wuchern, verbreiten sich im Kreise; der Fortschritt kehrt wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, in sich zurück. In die Tiefe des Brunnens dringen Wurzeln, doch keine Blicke ein“ (Die Schere, 174).
Hier nähert man sich dem Katholischen in Jüngers späteren Werken an. Die Annäherung führt immer aus dem empirischen Bereich in einen anderen Bezirk, für den Jünger zahlreiche bildhafte Umschreibungen fand: „andere Seite“, „Welt, die außerhalb unserer Erfahrung liegt“, Ziel der Wanderung, Bezirk jenseits der Kerkerwand und des zerreißenden Vorhangs. Die Zeit, die „dort drüben“ gilt, nennt er „Schicksalszeit“ im Unterschied zur „meßbaren Zeit“ der Erfahrungswelt. Die Überwindung der meßbaren Zeit geschieht im „Zeitsprung“, das heißt in einem aus der Ordnung und aus der Meßbarkeit fallenden Vollzug. Nennungen der anderen Seite sind stets an Akte des Sehens gebunden. So faßt er die Hoffnung auf die Auferstehung als einen „Ausblick durch die Kerkerwand“ (Die Schere, 18), die prophetische Vorschau und das zweite Gesicht als ein „Spähen durch ein Schlüsselloch“ (35). Mitunter fällt der Blick auf bedeutsam Nebensächliches, auf „Nebendinge wie ein umgestoßenes Tintenfaß“, die eine Störung im Getriebe der Zeit sind und uns aufschrecken lassen. Die Welt der Erfahrung wird dann als ganze zu einem Verweis auf die Welt des Jenseits.
Jünger legt großen Wert auf die Unterscheidung zwischen dem unsichtbar Vorhandenen und dem überhaupt nicht Vorhandenen: „Wir unterscheiden (…) zwischen dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren und dem Nicht-Vorhandenen“ (Die Schere, 49). Nicht alles, was unsichtbar ist, ist demnach nicht vorhanden. Gleichzeitig ist aber auch nicht alles, was unsichtbar ist, immer auch vorhanden. Doch wie läßt sich zwischen Wahrheit, daß heißt Vorhandenheit, und Unwahrheit, daß heißt Nicht-Vorhandenheit, unterscheiden? Diese Frage führt hinein in eine mystische Schau einer Wahrheit, die den „Göttern“ ursächlich vorgelagert ist und Gott meint. Der Weg leitet dabei von der „Annäherung“ als einer originär dichterischen und künstlerischen Aufgabe über verschiedene Zwischenstufen zur Epiphanie – wobei zugleich deutlich wird, daß Jünger den Dichter als privilegierten Seher in der Tradition des poeta vates interpretiert.
Die erste Stufe dieser Hierarchie des Erkennens bildet das „zweite Gesicht“. Jünger bezeichnet damit einen Zustand der Entrückung, der im alltäglichen Erleben angesiedelt ist und in dem zukünftiges Erleben erschaut wird, bei dem jedoch Erhabenes noch keine Rolle spielt. Die „Vorschau“ macht dann schon deutlicher, daß es sich bei diesen Wahrnehmungen nicht bloß um subjektive Fiktionen handelt: „In der Vorschau hat ein Zeitsprung stattgefunden; eine Vorhut wurde vorausgeschickt. Insofern wird in der Schau nicht Zukünftiges, sondern Vergangenes gesehen. Der Vorschauer hat die Gegenwart überholt. So kam es zur verblüffenden Identität des Geschauten und seiner Wiederholung in der Zeit“ (30). Die Vorschau – von Jünger dann auch als „Prognose“ bezeichnet – ist eine „Vorbeurteilung von Entwicklungen“, die „sich auf Tatsachen“ stützt. Die Gewißheit, mit der eine solche Fakultät der Vorausschau als existierend angenommen wird, muß davon ausgehen, daß das Sein auf einem festen Fundament ruht. Es geht Jünger hier nicht um Determinismus, sondern um die Annahme einer vorgegebenen sinnhaften Ordnung, um einen der Schöpfung zugrundeliegenden Logos. Jünger faßt das auf seine Weise, wenn es in Auseinandersetzung mit Kant heißt: „Die Existenz der Dinge ist also vorgezeichnet, wie in einem Prägstock, dessen Figur, in Wachs gedrückt, mehr oder minder deutlich ‚erscheint’. Eben war es noch möglich, während es nun existiert (‚nun’ ist hier besser als ‚jetzt’). Wir dürfen daraus schließen, daß das ‚Hiersein’ nur eine der möglichen Qualitäten des ‚Daseins’ ist“ (85).
In Jüngers Theorie der „Vorschau“ wird also in der Privatsprache des mythologisch denkenden Mystikers ein poetisches Modell christlicher Seins-Gewißheit entwickelt, daß sich darin neutestamentarisch gibt, indem es sich von den Propheten des Alten Testaments deutlich abgrenzt. Denn im Unterschied zur Vorschau gründet sich die Prophetie „weniger auf Tatsachen als auf Eingebung und Erscheinungen“ (41). Der Wahrheitscharakter der Prognose beruht mithin auf ihrer Fundierung durch eine Wirklichkeit, eben durch den fleischgewordenen Logos, den die Propheten nur „prophezeien“ konnten. Erst dieser macht das möglich, was Jünger einen „Zeitsprung“ nennt (und zwar deswegen, weil diese Fleischwerdung Gottes selbst ein solcher „Zeitsprung“ war). Nun ist der Mensch frei, über das Mögliche, gleichwohl noch Unsichtbare, als etwas Wirklichem gedanklich zu verfügen und über dieses unsichtbar Mögliche als über etwas Vergangenes zu sprechen. Denn alles Mögliche muß von nun an verstanden werden als bereits bei Gott existierend und damit eben als unsichtbar vorhanden.
Es ist mehr als ein Deutungsansatz, wenn man Jüngers Theorie der Prognose strukturell als Beschreibung einer christlichen Seinsschau interpretiert. Denn in der Schere läßt Jünger die Reihe der Erkenntniszustände in der Epiphanie gipfeln. Als Zeuge tritt nun nur noch Paulus auf: „’Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinungen nicht ungläubig’. So Paulus – das war behutsam gesprochen, denn er stand vor Gericht. Er konnte sich auch auf Zeugen berufen, die mit ihm auf dem Weg nach Damaskus das Licht, ‚’heller denn der Sonne Glanz’, gesehen, wenngleich sie die Stimme nicht gehört hatten“ (146). In der Epiphanie gipfelt die Schau der anderen Seite insofern, als sie eine auf Erscheinungen des Göttlichen ausgerichtete Vorschau ist. Und indem Jünger in diesem Zusammenhang auf das Verhältnis von Epiphanie und Zeit zu sprechen kommt, hebt sich unvermutet und nur ganz kurz der Mythen-durchwebte Vorhang, der dem Jünger-Leser Bilder aller Zeiten und Räume vorgaukelt, um ihn an der Vielheit der Erscheinungen des Göttlichen teilhaben zu lassen, und gibt den Blick auf den Logos frei: „Die Schöpfung ist Zeit schaffend. Die Götter sind Zeit setzend, die Titanen Zeit kürzend und dehnend (…)“ (146). Am Ursprung der Zeit sieht Jünger also nicht die Götter, sondern Gott. Die Götter selbst sind, wie es an anderer Stelle heißt, eben auch nur „Gleichnisse“ und Bilder, die an das Unsichtbare heranführen. Sie sind historisch bedingte Erkenntnismuster der religiösen Vernunft. Die Schöpfung aber, die in ihrer wunderbaren Vielfalt Jüngers bevorzugten Zugang zum Ursprung des Seins darstellt, ist historisch nicht bedingt, sondern bedingend. Damit nun ist Gott gemeint.
Man muß darüber streiten, warum Jünger hier und anderer Stelle nicht von Gott spricht, wenn er ihn, was aus dem Kontext deutlich wird, meint. In seiner letzten Schrift Gestaltwandel heißt es hierzu: „’Gott’ genießt, auch wenn der Name nicht genannt wird oder die Sprache sich mehr oder minder überzeugend um ihn herumwindet, noch einen gewissen Respekt. Daß die Rechnung mit unserem Jetzt und Hier nicht aufgeht, wird instinktiv gefühlt und auf jeder geistigen Stufe erkannt. Entsprechend formt sich das Gebet“. Doch das ist keine Antwort. Die Stelle belegt nur, daß Jünger sich des eigenen „Herumwindens“ durchaus bewußt ist. Einen Schritt weiter geht Jünger, wenn er dieses Herumwinden auch bei Nietzsche festmacht und eine epochale Situation anruft: „Nietzsches ‚Gott ist tot’ kann nur bedeuten, daß der epochale Stand der Erkenntnis nicht genügt“ (Gestaltwandel). Ist es also tatsächlich die historische Erkenntnissituation des, wie es bei Jünger heißt, „Interims“, die es nicht zuläßt, von Gott zu reden? „Im Interim sind Götter selbst in der Dichtung unzeitgemäß; am besten wird ihr Name neutralisiert“ (ebd.). Jüngers Argumentation ist hier schwer zu folgen, schon allein deswegen, weil er fordert, die Namen der Götter zu neutralisieren, während sich, wie er selbst sagt, die Sprache um den Namen Gottes nur mühsam herumwinden kann. Wäre Jünger ein Systematiker, auf dessen Begriffe und terminologische Abgrenzungen Verlaß wäre, so könnte man in dieser Unterscheidung einen Hinweis auf die stärkere Seinskraft Gottes sehen, die durch Erkenntnis und Sprache gleichsam hindurchdrängt. Doch Jünger ist eben kein Denker, sondern ein Dichter. Daher bleibt auch diese Differenzierung dunkel.
Und deswegen bietet sich eine andere, weitergehende Hypothese an. Könnte es sein, daß Jünger die Klarheit des mit dem Namen Gottes verbundenen Logos meidet, der für alle nur denkbaren Bilder immer auch die Auflösung, den Schlüssel bereithält, und auf die „Schöpfung“ rekurriert, weil es ihm darum geht, seine dichterische Existenz, die in der Erschaffung von unaufgelösten Bildwelten besteht, zu schützen? Diese Vermutung gewinnt an Beweiskraft, wenn man betrachtet, welche Rolle dem Dichter angesichts der Gewißheit zukommt, daß es das unsichtbar Vorhandene als Mögliches gibt und daß der Mensch Gewißheit darüber hat. „Das Mögliche, besser noch das Vermögende, ist unbegreiflich; die Vorstellung ist von ihm wie durch eine Mauer getrennt. Es kann nur duch Dinge, die innerhalb der Erfahrung liegen, der Anschauung nähergebracht werden – also durch Gleichnisse“ (Die Schere, 86). Gleichnisse und Bilder sind Sichtbarmachungen des Unsichtbaren. Der Dichter ist es, der diese Bilder findet. „Wo Bilder fallen, müssen sie durch Bilder ersetzt werden, sonst droht Verlust“, heißt es zu Beginn der Schere (1). Bilder fallen immer dann, wenn Religionen, die Jünger als „mehr oder minder gelungene Kunstwerke“ (ebd.) betrachtet, untergehen. Genau dies ist im Zeitalter der Titanen geschehen. Die Bilderwelten der Religionen, die eine Ahnung des Transzendenten vermitteln, sind untergegangen – und daran hatte Luther keinen geringen Anteil („Es scheint, daß die Begegnungen schwächer werden, wenn man Linien wie Moses-Paulus-Luther bedenkt“, 77). Nur die Gleichnisse des Dichters können diesen Bildverlust ausgleichen, indem sie anstelle der Epiphanien und Begegnungen mit dem Überirdischen wenigstens poetisch an der Sichtbarmachung des Unsichtbaren arbeiten. Man gelangt in Jüngers Spätwerk also an einen Punkt, an dem sowohl die offene als auch die verdeckte Struktur der Texte eindeutig auf den Logos hinlenken. Genau an dieser Stelle jedoch weicht Jünger aus und in den Bereich der ästhetischen Präfiguration zurück. Was das für die Konversion des Menschen Jünger bedeutet, wird (und soll auch) immer ein Geheimnis bleiben. Jüngers Texte jedenfalls haben jene Linie des 26. September 1996 nicht überschritten. Sie bleiben diesseits des Logos.
(zuerst in: Die Tagespost, September 2015)
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théologie, catholicisme, ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Coming on October 1st from Telos Press Publishing: Ernst Jünger’s Sturm. Pre-order your copy today, and we will ship it as soon as it is available.
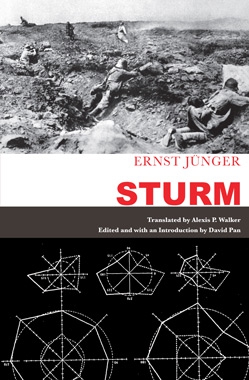 Sturm
Sturm Publication Date: October 1, 2015
Pre-order your copy today.
Translated by Alexis P. Walker
With an Introduction by David Pan
Set in 1916 in the days before the Somme offensive, Ernst Jünger’s Sturm provides a vivid portrait of the front-line experiences of four German infantry officers and their company. A highly cultivated man and an acute observer of his era, the eponymous Lieutenant Sturm entertains his friends during lulls in the action with readings from his literary sketches. The text’s forays into philosophical and social commentary address many of the themes of Jünger’s early work, such as the nature of war, death, heroism, the phenomenon of Rausch, and mass society.
Originally published in installments in the Hannoverscher Kurier in 1923, Sturm fell into obscurity until 1960, when it was re-discovered and subsequently re-published by Hans Peter des Coudres, a scholar of Jünger’s work. This translation—the first to be published in English—brings to the English-speaking world a work of literature of interest not only to students of Jünger’s work and of World War I, but to any reader in search of a powerful story of war and its effects on the lives of the men who endure it.
Praise for Ernst Jünger’s Sturm
“The rediscovery of Ernst Jünger’s Sturm, abandoned by its author after its first publication in 1923, significantly alters our understanding of Jünger’s place in modern European literature. The literary and aesthetic moments, frequently seen as secondary in Jünger’s early work, turn out to be constitutive from the very beginning. While the plot deals with the experience of war in 1916, Sturm‘s ultimate concern is the possibility of radical modern art under conditions of extreme violence.”
—Peter Uwe Hohendahl, Jacob Gould Schurman Professor Emeritus of German Studies and Comparative Literature, Cornell University
“This translation of Sturm fills a long missing gap in the German war literature of the 1920s available to English readers. The translation by Alexis Walker is vibrant and precise while also reflecting the nuances and tone of the original German text. David Pan’s introduction sets the stage with a masterful overview of the context in which Sturm was written and pays particular attention to the debates since then on the aestheticization of the war experience.”
—Elliot Neaman, Professor of History, University of San Francisco
“An unblinking account of a culture in twilight, this novella recasts central themes of Ernst Jünger’s chronicles of the Great War: the unrelenting test of human perdurance under new technologies of annihilation; the naturalist’s precise aesthetic of life teeming amid martial insanity; and, a new note, the harrowing free fall of civilian life into erotic aimlessness and inebriated despair, for which only art serves for an antidote. In Alexis Walker’s carefully wrought translation, Sturm will be a welcome surprise to Jünger’s veteran readers, and an ideal introduction for those who are curious to know more than his name.”
—Thomas Nevin, author of Ernst Jünger and Germany: Into the Abyss, 1914–1945
“Had Stephen Crane’s Henry Fleming been born in 1895 Germany, his story might very well have read like the eponymous protagonist’s of Ernst Jünger’s Sturm. In a fascinating novella in turn meditative and wrenchingly physical, Jünger stages a drama of one man’s ideas about himself, as told through a narration conflicted about its own subject.”
—Alex Vernon, James and Emily Bost Odyssey Professor of English, Hendrix College
“Sturm is a subtle novella about an intellectual in the trenches who sees the age of industrial-scale war as deeply dehumanizing, yet recognizes that this war has given him a sense of identity, and of community with others, that no peacetime experience could match. . . . Jünger is a remarkable writer. In this novella he comes across as a romantic with a loathing of modernity, especially as characterized by the overbearing state. The book is grim, and deeply pessimistic—but exceptionally interesting, and well worth reading.”
—George Simmers, Great War Fiction blog
About the Author
Ernst Jünger (1895–1998) was one of the most complex and controversial writers of twentieth-century Germany. Born in Heidelberg, he fought in the German Army during World War I, an experience that he would later recount in his gripping war memoir, Storm of Steel. Though Jünger would serve as a German officer during World War II, his 1939 novel On the Marble Cliffs daringly advanced an allegorical critique of Hitler’s regime. Over the course of his long literary career, Jünger would author more than fifty books, some of which are now available in English translation from Telos Press, including On Pain, The Adventurous Heart, The Forest Passage, and the brilliant dystopian novel Eumeswil.
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : première guerre mondiale, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

« Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l’inhabituel, des grandspérils. La guerre nous avait saisis comme une ivresse. » [1]
Dès les premières lignes d’Orage d’acier, Ernst Jünger dépeint la léthargie dans laquelle sont nés, pour la jeunesse allemande de 1914, l’attrait irrésistible du front, la soif d’aventure, besoin physique de danger et de violence. Ils allaient connaître une violence inédite, celle de la guerre moderne, loin des rêveries d’épopées héroïques. Une violence déshumanisée. La guerre de position, le pilonnage continu de l’artillerie industrielle, la mort anonyme. Dans les récits de guerre qui fleurirent dès le lendemain des démobilisations, de 1918 jusqu’en 1920, il ressort une image uniforme du profond choc causé par le dépassement de tous les seuils de tolérance devant la brutalité ordinaire de la guerre de tranchées. Les bombardements, les assauts – brèves et mortelles montées à la surface – et l’entassement de cadavres sans sépulture, autant d’expériences qui égrainent un quotidien déjà saturé de violence.
Les traces physiques et morales portées par les hommes ont marqué leurs témoignages. Elles forment la trame qui sous-tend toute la littérature de guerre, de Roland Dorgelès à Erich Maria Remarque. Du grand dolorisme qui imprègne cette production, il est néanmoins une œuvre qui se détache radicalement.
Né en 1895 à Heidelberg, en plein apogée wilhelminien, Ernst Jünger manifeste dès sa jeunesse la fibre littéraire qui fera de lui l’écrivain de guerre de langue allemande le plus essentiel du XXe siècle. Son cheminement semblait, dès le début, tendre au mystique, exalté dans l’admiration pour les penseurs formalistes, empreint de l’héritage nietzschéen et du lyrisme de Hölderlin, naturellement enclins à l’apologie du guerrier. Il gravite notamment dans la proximité du George-Kreis, noyau informel de ce qui deviendra la frange aristocratique de la révolution conservatrice, et s’engage auprès des Wandervögel. En 1912, âgé de 17 ans, il revêt une première fois l’uniforme au sein de la légion d’Afrique. Engagement armé et inspiration littéraire s’entrecroisaient déjà, dans la quête d’une violence encore pure et brutale qu’il espérait trouver sur le continent noir.

Lors de l’appel aux armes, en août 1914, Jünger fait partie des troupes volontaires. Il rejoint le 72e régiment de fusilier en Champagne. Dès lors, il ne quitta plus le front, et obtint plusieurs promotions dans les rangs de la l’armée impériale. Après s’être formé en tant que sous-officier, il obtiendra dans les dernières années du conflit le grade d’Oberleutnant à la tête de la 7e compagnie. La position d’officier subordonné, c’est-à-dire d’officier de tranchée, marque profondément l’expérience combattante de Jünger. C’est la position clef du combat rapproché, de la guerre vécue. En tant qu’Oberleutnant, il est la tête d’un corps combattant abandonné dans le no-man’s-land, coupé de l’arrière. Le modèle de courage, le chef qui doit entraîner ses hommes au combat ; « L’officier occupe sa place : dans toutes les circonstances, la plus proche de l’ennemi. » [2]. Son engagement de soldat puis d’officier lui vaudra quatorze blessures et la suprême décoration impériale de la croix Pour le mérite.
En 1920, alors qu’il sert encore dans l’armée de la République de Weimar, il publie l’opus majeur de son œuvre de guerre, Orages d’acier (In Stahlgewittern). Il est puisé par ses carnets de guerre, scrupuleusement rédigés au fil des affrontements et des périodes d’accalmie. Dans ce premier ouvrage, Jünger développe de manière inédite l’expérience du combat, exposant la relation brute et cinglante de l’individu avec la violence de guerre, à la fois comme figure littéraire fondamentale et comme objet central pour une conception de l’existence dans la modernité du monde. Orages d’acier forme le tronc d’une ramification composée d’un essai, La guerre comme expérience intérieure (Der Kampf als inneres Erlebnis – 1922) et d’ouvrages de moindre ampleur, qui s’ajoutent peu à peu dans les années suivantes à partir des carnets inexploités. Lieutenant Sturm (Sturm – 1923), Le boqueteau 125 (Das Wäldchen 125 – 1924) et Feu et sang (Feuer und Blut – 1925) donnent des points de focalisation détaillés sur des aspects particuliers du combat, variant l’approche et le traitement. Chez Jünger, la narration est souveraine, brutale, précise – une écriture qui ne tremble pas, même devant l’horreur – et c’est dans La guerre comme expérience intérieure que se déploie le véritable sens donné au combat, la mystique guerrière. Ses écrits se répondent et ne peuvent véritablement être dissociés les uns des autres.
La guerre que décrit Jünger n’est pas un phénomène volontaire, une contingence diplomatique, ou, suivant la formule de Clausewitz, de la politique poursuivie avec d’autres moyens. La guerre trouve sa cause première dans l’homme, dans sa nature archaïque. Elle ne commence pas avec une déclaration de guerre, elle ne se termine pas avec un traité de paix. La guerre est un état perpétuel qui, bien qu’il puisse être contenu sous le vernis de la culture policée, ressurgit immanquablement. « La guerre n’est pas instituée par l’homme, pas plus que l’instinct sexuel ; elle est loi de nature, c’est pourquoi nous ne pourrons jamais nous soustraire à son empire. Nous ne saurions la nier, sous peine d’être engloutis par elle. » [3]. Le profond besoin de violence guerrière, gravé dans la chair des hommes, s’étend comme un lien indéfectible entre le montagnard armé d’une massue et de pierres, et le soldat des tranchées sous la pluie de feu et d’acier. Lorsque la guerre éclate, qu’elle embrase tout, il ne reste qu’une alternative : se battre ou disparaître. Cela vaut pour les civilisations, cela vaut pour chaque individu ; « Le fort seul a son monde bien en poigne, au faible il glisse entre les doigts dans le chaos » [4].
Mais la violence combattante - la pulsion qui pousse irrésistiblement au combat - n’est pas une résurgence d’un bas instinct qui abîme les hommes dans la brutalité gratuite. Jünger la conçoit au contraire comme la marque d’une antique noblesse, qui relève l’humanité de son affaissement. « Nous avons vieilli, et comme les petits vieux nous aimons nos aises. C’est devenu un crime d’être davantage ou d’avoir plus que les autres. Dûment sevrés des fortes ivresses, nous avons pris en horreur toute puissance et virilité ; la masse et l’égalitaire, tels sont nos nouveaux dieux. » [5] Pour Jünger, la force combattante, la nature guerrière de l’homme, est ce qui permet à l’homme de s’élever au dessus de ses semblables et aux civilisations d’inverser le cours de leur décadence pour renouer avec la grandeur. Une forme particulière de volonté de puissance qui réveille le besoin du sacrifice, pour un idéal, pour Dieu, pour la gloire. Ainsi parle-t-il des combattants de choc dans les tranchées : « Cette seule idée qui convienne à des hommes : que la matière n’est rien et que l’esprit est tout, cette idée sur laquelle repose tout entière la grandeur humaine, ils l’exaspéraient jusqu’au paradoxe » [6]. Oublier le moi pour le je. Devenir acteur de sa pensée. Telle est en somme, dans la pensée de Jünger, la plus haute des vertus combattantes.
Il met en valeur un type d’homme particulier, qui s’est approprié une virilité guerrière parfaite, chez lequel l’idée du combat a définitivement triomphé sur le matériel : « La perfection dans ce sens – au point de vue du front –, un seul en présentait l’apparence : le lansquenet. En lui, les vagues de l’époque s’entrechoquaient sans dissonance aucune, la guerre était son élément, en lui de toute éternité » [7]. Le lansquenet, mercenaire combattant, soldat de métier et d’engagement, concrétise donc dans sa manière d’exister la coupure totale avec le monde civil installé. Comme le légionnaire des armées de la Rome antique, il vit de la guerre, dans la guerre, pour la guerre. Le sens guerrier coule dans son sang, il en a adopté tous les codes, et il s’est entièrement arraché à l’esprit bourgeois. Le lansquenet est en quelque sorte la quintessence de l’existence. En lui, le détachement est total ; il ne vit plus que par le danger. « Pour chacun, vivre veut dire autre chose, pour l’un le chant du coq au matin clair, pour l’autre l’étendue qui dort au midi, pour le troisième les lueurs qui passent dans les brumes du soir. Pour le lansquenet, c’est le nuage orageux qui couvre au loin la nuit, la tension qui règne au-dessus des abîmes. » [8]

Quel sens a cette représentation d’une violence de guerre stylisée, si on la rapporte au charnier de la Première Guerre Mondiale ? C’est ce qui se découvre dans les textes tirés des carnets de guerre. Le boqueteau 125, sous-titré Une chronique des combats de tranchée, contient le déroulement d’une séquence de combat qui tient lieu dans la dernière phase de la guerre, au début de l’été 1918, devant les ruines de Puisieux-au-Mont, près d’Arras. Jünger relate le stationnement de sa compagnie dans les tranchées bordant le boqueteau 125, une place intégrée aux lignes allemandes sur le front du nord, quotidiennement pilonnée par les forces anglaises. Le point central de l’ouvrage est l’offensive anglaise lancée contre cette position dont Jünger en commande la compagnie d’intervention. Celle-ci subit d’abord le tir d’anéantissement de l’artillerie britannique, puis l’offensive de l’infanterie.
Chargés de fatigue, dans un espace-temps désarticulé, sous la pluie des bombes, les éclats d’obus qui arrachent les membres, les soldats de la troupe de choc sont confrontés à toutes les conditions de la violence extrême qui caractérise la guerre de tranchées. L’assaut représente alors un moment clef. C’est le moment où on s’apprête à entrer en contact direct avec l’ennemi devenu invisible derrière les murs de glaise. Le moment où l’exposition aux tirs de shrapnel, des mitrailleuses, des grenades menacent le plus de sectionner le maigre fil de la vie. Au cœur de la nuit, la peur de la mort, l’horreur du spectacle macabre se propagent comme un virus. C’est dans ce contexte que Jünger voit surgir dans le visage de ces hommes cette marque des héros modernes : « Nous sommes cinquante hommes, guère plus, debout dans ce boyau, mais sélectionnés par des douzaines de combats et familiarisés par une longue expérience avec le maniement de toutes les armes. Si quelqu’un est capable d’y tenir sa place, c’est nous et nous pouvons dire que nous sommes prêts. Être prêt, où que ce soit, pour quelque tâche que ce soit, voilà ce qui fait l’homme » [9]. Réminiscence de l’idéal du lansquenet, celui qui a fait toutes les guerres, qui en est imprégné de part en part, Jünger affirme que ce n’est pas l’uniforme, l’alignement sur le champ d’honneur dans la brume de l’aube qui fait la beauté du guerrier. C’est au contraire la résistance aux conditions les plus déshumanisantes qui distingue l’esprit combattant. Ils ont des visages taillés comme des spectres, qui ne respirent plus que la bravoure.
C’est dans cette bravoure que Jünger identifie le grand renouveau de l’humanité : « Bravoure est le vent qui pousse aux côtes lointaines, la clef de tous les trésors, le marteau qui forge les grands empires, l’écu sans quoi nulle civilisation ne tient. Bravoure est la mise en jeu de sa propre personne jusqu’aux conséquences d’acier, l’élan de l’idée contre la matière, sans égard à ce qui peut s’en suivre. Bravoure est pour l’homme seul de se faire mettre en croix pour sa cause, bravoure est de professer encore et toujours, au dernier soubresaut nerveux, au dernier souffle qui s’éteint, l’idée qu’on a soutenue jusqu’à la mort. Le diable emporte les temps qui veulent nous ravir la bravoure et les hommes ! » [10]. C’est par elle que le soldat de tranchée est le frère du lansquenet. La profonde modernité que Jünger a vue dans ses égaux au combat, c’est cette audace ultime que confère la bravoure. La soif de gloire et de danger. L’audace des conquistadores et des ascètes du désert, qui ont forgé leur âme au feu de l’idéal. « Voilà l’humanité nouvelle, le soldat du génie d’assaut, l’élite de l’Europe centrale. Une race toute neuve, intelligente, forte, bourrée de volonté. Ce qui se découvre au combat, y paraît à la lumière, sera demain l’axe d’une vie au tournoiement sonore et toujours plus rapide. » [11]

La guerre contemporaine n’est pas une guerre de samouraïs ou une guerre de chevaliers. Ni même une guerre de petits soldats. La bataille, ses unités de temps, de lieu et d’action ont été battues en brèche par la technologie de l’armement de pointe. On ne se bat plus sur le champ, ni même dans les tranchées pour mener le siège en rase campagne. La guerre moderne se mène de loin, derrière des écrans, ou bien au ras du sol, suivant les codes de la guérilla. Le vernis de civilisation imposé pendant des siècles à la violence par l’Occident s’écaille et tombe en poussière. Plus de consensus implicite qui porte les forces à l’affrontement décisif. On se bat dans les ruines, on tire dans le dos, on ne distingue plus guère civils et combattants. Ainsi se bat-on en Ukraine, au Proche-Orient. Ainsi se battait-on en Irlande du Nord, il y a quelques décennies encore. Ainsi se battra-t-on peut-être demain, au cœur des nations qui se sont inventé une paix éternelle. Car si l’on en croit Jünger, les fruits du pacifisme sont amers. « Une civilisation peut être aussi supérieure qu’elle veut – si le nerf viril se détend, ce n’est plus qu’un colosse aux pieds d’argile. Plus imposant l’édifice, plus effroyable sera la chute. » [12]
Ernst Jünger ne laisse pas, dans sa première œuvre, d’espoir à une paix durable qui soit de ce monde. Il l’exclut par nécessité, car le renouvellement passe par le perpétuel lien entre les hommes et la guerre. C’est au combat que se forge l’élite de l’humanité, celle des vrais hommes. « Polemos est le père de toutes choses », selon la formule d’Héraclite. Mais quelle inspiration un jeune homme du XXIe siècle peut-il bien tirer de ce qui peut apparaître comme un véritable culte du carnage ?
Le lyrisme d’Ernst Jünger au sujet de la guerre lui a valu d’être qualifié par certains critiques de poète de la cruauté. Pourtant, jamais un mot de haine pour l’ennemi. Au contraire. L’estime va au soldat d’en face, français ou anglais, bien plus qu’aux hommes de l’arrière qui entretiennent la propagande. Il ne s’agit pas de perpétrer des exactions, mais de monter à l’assaut. Cette quête de bravoure, d’où qu’elle vienne, est le trait prédominant de l’œuvre jungerienne. Il s’est affirmé au cours de la Grande Guerre, il s’accentuera encore dans les années trente, lorsque l’auteur prendra peu à peu conscience de l’écart croissant entre le national-socialisme et les espérances des penseurs de la révolution conservatrice. Le régime d’un idéologue populacier, déserté par la noblesse, avide de briser les individus au profit de la masse, lui inspirera le dégoût. La force de l’homme seul avec lui-même, l’exaltation de son existence au combat, quel que soit ce combat, c’est en cela que consiste l’essence de la pensée de Jünger, de son éthique. Elle ne repose dans rien d’autre que dans le dépassement de ses propres faiblesses, dans l’unité de l’esprit et du sang au profit du sacrifice. « Rien n’est mieux fait pour enflammer l’homme d’action que le pas de charge à travers les champs où voltige le manteau de la mort, l’adversaire en pointe de mire. » [13]
[1] JÜNGER E., Orages d’acier, traduction par H. Plard, Paris, Le livre de Poche, 2002, p.6
[2] JÜNGER E., Le boqueteau 125, traduction par Th. Lacaze, Paris, Payot, 1995, p.178
[3] JÜNGER E., La guerre comme expérience intérieure, traduction par Fr. Poncet, Paris, Christian Bourgeois, 1997, p.75
[4] Ibid., p.76
[5] Ibid., P.95
[6] Ibid., p.104
[7] Ibid., p.97
[8] Ibid., p.106
[9] JÜNGER E., Le boqueteau 125, op. cit, p. 179
[10] JÜNGER E., La guerre comme expérience intérieure, op. cit., p.87
[11] Ibid., p.121
[12] Ibid., p.76
[13] Ibid., p.91
00:05 Publié dans Littérature, Militaria, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : militaria, révolution conservatrice, allemagne, ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://www.iaslonline.lmu.de
Ein gutes Jahr nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, im Mai 1934, schrieb Ernst Jünger im Vorwort zu seiner Aufsatzsammlung Blätter und Steine, es seien "nur solche Arbeiten aufgenommen, denen über einen zeitlichen Ansatz hinaus die Eigenschaft der Dauer innewohnt. [...] Aus dem zu Grunde liegenden Material wurden somit die rein politischen Schriften ausgeschieden; – es verhält sich mit solchen Schriften wie mit den Zeitungen, die spätestens einen Tag nach dem Erscheinen und frühestens in hundert Jahren wieder lesbar sind." 1
Drei Jahre nach seinem Tod sind Jüngers politische Schriften nun zum erstenmal wieder zugänglich. Das Bild, das wir heute von Jünger haben, wäre ein anderes, wenn Jüngers Haltung jener Jahre aus diesen Texten bekannt gewesen wäre. Wo Jünger in der Weimarer Republik politisch stand, war bislang nur in Umrissen erkennbar.
Karl Otto Paetel, der von Jüngers regimekritischer Haltung überzeugen wollte, schrieb 1943 in der Emigrantenzeitschrift Deutsche Blätter, "dass sich Ernst Jünger um die Tagespolitik wirklich nie gekümmert" 2 habe. Paetel hätte es besser wissen müssen: Er kannte Jüngers politische Arbeit gut. Zu Beginn der 30er Jahre war Paetel Hauptschriftleiter der Zeitschrift Die Kommenden, deren Mitherausgeber Jünger war. 3
Als Paetel den Jünger der Marmorklippen (1939) in seiner inneren Emigration vorstellte, hatten Emigranten verschiedener Richtungen Jünger seinen Beitrag zur Zerstörung der Weimarer Republik längst zuerkannt. Siegfried Marck 4 , Hermann Rauschning 5 , Golo Mann 6 und Karl Löwith 7 sahen in Jünger einen Wegbereiter der deutschen Katastrophe. Vermutlich wußten sie von Jüngers tagespolitischem Geschäft in den Jahren 1925 bis 1930. In ihren Analysen waren sie jedoch nicht darauf eingegangen.
Selbst Armin Mohler hatte Jünger zu Lebzeiten nicht überzeugen können, seine politische Publizistik neu zu edieren. Zwei Gesamtausgaben erschienen ohne sie. Unbekannt war sie freilich nicht: In den Bibliographien Jüngers ist sie nahezu vollständig erfaßt. Dennoch sind die zum großen Teil schwer zugänglichen Texte weitgehend unbekannt geblieben.
Künftige Biographen mögen nun entscheiden, ob Jünger sein Denken und Handeln ehrlich oder selbstgerecht verarbeitete. Kurz nach dem Krieg war Jünger vorgeworfen worden, er wolle wie viele bloß Seismograph und Barometer, nicht aber Aktivist gewesen sein. 8 Ein anderer Zugang ist jedoch wichtiger. Die Bedeutung von Jüngers politischer Publizistik liegt weniger in ihrer Teilhabe am Gesamtwerk Jüngers, sondern in ihrem exemplarischen Charakter. Jünger spricht hier als Exemplar seiner Generation – einer Generation, die entscheidende lebensprägende Impulse nicht im Studium, sondern in den Erfahrungen an der Front und in den Wirren der gescheiterten Revolution sowie der katastrophalen wirtschaftlichen Lage bis zur Währungsreform im Dezember 1923 empfing.
Es ist oft betont worden, wie offen in der Spätphase der Weimarer Republik vielen Zeitgenossen die Zukunft schien. Zunächst bietet es sich daher an, Jüngers politische Publizistik zu lesen unter Einklammerung des Wissens um die weitere Entwicklung der deutschen Verhältnisse. Natürlich ist dies nur hypothetisch möglich und hat seine Grenzen. Die Perspektive des Zeitgenossen ist uns verschlossen. Wenn dieses Verfahren hier empfohlen wird, dann aus folgendem Grund: In den Diskussionen des Feuilleton wird der Blick auf Autoren wie Jünger in der Regel auf zwei Perspektiven verengt: Stellung zum Nationalsozialismus und zum Antisemitismus. Selbstverständlich sind dies Fragen, die immer wieder neu gestellt werden müssen. Nur: Jüngers Denken und seine Stellung in den Ideenzirkeln der intellektuellen Rechten wird so im Dunkeln bleiben. Die Kritik, die nur diese Maßstäbe kennt, und die Apologeten vom Schlage Paetels bewirken gemeinsam, daß die Komplexität der Weimarer Rechten, wie sie in so unterschiedlichen Werken wie denjenigen Armin Mohlers und Stefan Breuers erkannt wurde, aus dem Blick gerät.
Der nun vorliegende Band Politische Publizistik 1919-1933 versammelt nicht nur die politische Publizistik jener Jahre, sondern auch eine Fülle anderer Texte, die diesem Genre nicht zugeordnet werden können. Insgesamt sind es 144 Texte. Die Vorworte zu verschiedenen Auflagen von In Stahlgewittern, von Der Kampf als inneres Erlebnis , von Feuer und Blut und Das Wäldchen 125, die alle nicht in die Werkausgaben aufgenommen wurden, kommen ebenso zum Abdruck wie einige Rezensionen, die zwischen 1929 und 1933 entstanden.
Man könnte einwenden, daß der Band insgesamt ein heterogenes Sammelsurium von Texten der Jahre 1920–33 sei, und so gesehen der Titel der Ausgabe in die Irre führe. Auf der anderen Seite: Die Grenze zwischen politischen und unpolitischen Arbeiten ist bei einem Autor wie Jünger schwer zu ziehen. Und: die nun vorliegende Ausgabe hat einen eminenten Vorzug. Jüngers mitunter äußerst schwer zugängliche Arbeiten aus der Zeit der Weimarer Republik liegen nun – soweit sie bekannt sind – zum erstenmal vollständig vor. 9
Eingeleitet wird der Band von einigen kleineren Arbeiten, die ebenfalls nicht im strengen Sinn politisch zu nennen sind. Zwischen 1920 – dem Jahr, in dem In Stahlgewittern erschien – und 1923 schrieb Jünger einige kürzere Aufsätze, die Fragen der modernen Kriegsführung behandeln, im Militär-Wochenblatt. Zeitschrift für die deutsche Wehrmacht.
Am 31. August 1923 – in der Hochphase der Inflation – schied Jünger aus der Reichswehr aus. Im Wintersemester immatrikulierte er sich in Leipzig als stud. rer. nat. Jünger war damals 28 Jahre alt. In einer Lebensphase, in der wesentliche Prägungen bereits abgeschlossen sind, begann er zu studieren. Jünger hörte Zoologie bei dem Philosophen und Biologen Hans Driesch, dem führenden Sprecher des Neovitalismus, und Philosophie bei Felix Krüger und dessen Assistenten Hugo Fischer. Auch dürfte er Hans Freyer, der seit 1925 in Leipzig Professor war, an der Universität kennengelernt haben.
Seine erste politische Arbeit schrieb Jünger kurz nach seinem Ausscheiden aus der Reichswehr für den Völkischen Beobachter – einer von zwei Beiträgen in dieser Zeitung, der zweite erschien 1927. Im September 1923, knapp zwei Monate vor Hitlers Münchner Putschversuch, erscheint der Aufsatz mit dem Titel Revolution und Idee. Schon hier finden sich Motive, die sich durch Jüngers politisches Argumentieren der folgenden Jahre ziehen werden: die Bedeutung der Idee und die Unaufhaltsamkeit einer künftigen Revolution. Die gescheiterte Revolution von 1918, schrieb Jünger, "kein Schauspiel der Wiedergeburt, sondern das eines Schwarmes von Schmeißfliegen, der sich auf einen Leichnam stürzte, um von ihm zu zehren", war nicht in der Lage eine Idee zu verwirklichen. Sie mußte daher notwendig scheitern: "Für diese Tatsachen, die späteren Geschlechtern unglaublich vorkommen werden, gibt es nur eine Erklärung: der alte Staat hatte jenen rücksichtslosen Willen zum Leben verloren, der in solchen Zeiten unbedingt notwendig ist" (35). Es gilt daher einzusehen, daß die versäumte Revolution nachgeholt werden muß:
Die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden, sie marschiert unaufhaltsam heran. Sie ist keine Reaktion, sondern eine wirkliche Revolution mit all ihren Kennzeichen und Äußerungen, ihre Idee ist die völkische, zu bisher nicht gekannter Schärfe geschliffen, ihr Banner ist das Hakenkreuz, ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt – die Diktatur! Sie wird ersetzen das Wort durch die Tat, die Tinte durch das Blut, die Phrase durch das Opfer, die Feder durch das Schwert. (36)
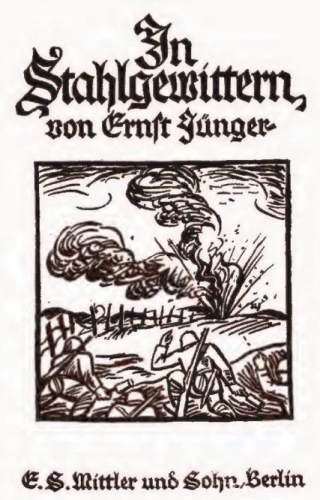 1922 erscheint Der Kampf als inneres Erlebnis und die zweite Auflage von In Stahlgewittern, 1923 im Hannoverschen Kurier in 16 Folgen die Erzählung Sturm, 1924 und 1925 Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen und Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Schlacht. Die erste Phase seines Werkes, in dem Jünger seine Fronterlebnisse verarbeitete, ist damit abgeschlossen. Das Jahr 1925 bedeutet für Jünger in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Zehn Jahre lang – bis zu den Afrikanischen Spielen von 1936 – wird Jünger keine Erzählungen und Romane veröffentlichen.
1922 erscheint Der Kampf als inneres Erlebnis und die zweite Auflage von In Stahlgewittern, 1923 im Hannoverschen Kurier in 16 Folgen die Erzählung Sturm, 1924 und 1925 Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen und Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Schlacht. Die erste Phase seines Werkes, in dem Jünger seine Fronterlebnisse verarbeitete, ist damit abgeschlossen. Das Jahr 1925 bedeutet für Jünger in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Zehn Jahre lang – bis zu den Afrikanischen Spielen von 1936 – wird Jünger keine Erzählungen und Romane veröffentlichen.
In den zehn für das Schicksal Deutschlands entscheidenden Jahren von 1925–1935 schreibt Jünger Weltanschauungsprosa als politischer Publizist in einer Vielzahl meist rechtsstehender Organe, als Herausgeber verschiedener Sammelbände und als Essayist in den Büchern Das Abenteuerliche Herz (1929) und Der Arbeiter (1932). Aber das Jahr 1925 ist noch in anderer Hinsicht eine Zäsur: Jünger bricht das Studium ab und tritt in den bürgerlichen Stand der Ehe.
Dem im September 1923 im Völkischen Beobachter veröffentlichten Artikel folgt fast zwei Jahre lang keine im strengen Sinne politische Stellungnahme. Die regelmäßige politische Publizistik Jüngers beginnt am 31. August 1925 mit einem Aufsatz in der Zeitschrift Gewissen, dem Organ der sich um Arthur Moeller van den Bruck scharenden jungkonservativen >Ring-Bewegung<. Moderater im Ton als im Völkischen Beobachter finden sich die gleichen Forderungen wie zwei Jahre zuvor: Einsicht in die Bedeutung einer Idee und Notwendigkeit einer Revolution. Bemerkenswert ist der Publikationsort. Zwar lassen sich zwischen Jünger und dem Kreis um Moeller auch Gemeinsamkeiten nachweisen, aber in wesentlichen Punkten bestehen Differenzen – von ihnen wird später noch die Rede sein.
Jünger veröffentlichte seine politischen Traktate in einer Vielzahl auch Kennern der Zeitschriftenlandschaft der Weimarer Republik eher unbekannten Organen. 10 Man kann hier unterscheiden zwischen Zeitschriften, in denen Jünger als Gast schrieb – in der Regel gab es dann nur ein oder zwei Beiträge –, und solchen, in denen er regelmäßig zur Feder griff. Bei den meisten Zeitschriften, in denen Jünger regelmäßig schrieb, trat er auch als Mitherausgeber auf.
Die erste Zeitschrift, für die Jünger regelmäßig arbeitete, war das von ihm mitherausgegebene Blatt Die Standarte. Beiträge zur geistigen Vertiefung des Frontgedankens . Es erschien zum erstenmal im September als Sonderbeilage des Stahlhelm. Wochenschrift des Bundes der Frontsoldaten.
Mit dem Erscheinen dieser Beilage begann eine zunehmende Politisierung des Stahlhelm. Der im Dezember 1918 gegründete republikfeindlich eingestellte Bund der Frontsoldaten war schon aufgrund seiner hohen Mitgliederzahlen eine geeignete Zielgruppe für politische Agitation. 11 Bis zum Dezember schrieb Jünger für jede Nummer der wöchentlich erscheinenden Beilage. Diese insgesamt 17 Beiträge stehen in engem Zusammenhang, der letzte Beitrag erscheint als Schluß.
Von allen politischen Zeitschriftenarbeiten Jüngers dürften diejenigen in der Stahlhelm–Beilage Die Standarte die größte Wirkung gehabt haben. Die Wochenschrift des Stahlhelm hatte eine Auflage von 170 000 – eine Zahl, an die sämtliche anderen Zeitschriften, in denen Jünger veröffentlichte, nicht annähernd herankamen. Weil Jünger mit diesen Beiträgen vermutlich die größte Wirkung entfaltete, aber auch, weil sie für eine bestimmte Etappe in seinem politischem Schaffen stehen, sollen sie etwas ausführlicher behandelt werden.
Das Programm, das Jünger in der Stahlhelm–Beilage Die Standarte entwickelt, ist getragen von leidenschaftlicher Parteinahme für eine nationalistische Revolution. Auf einen Punkt von Jüngers Physiognomie der Gegenwart sind alle weiteren Überlegungen bezogen. Jünger lebt im Glauben, daß der große Krieg noch gar kein Ende gefunden habe, noch nicht endgültig verloren sei. Politik ist ihm daher eine Form des Krieges mit anderen Mitteln (S. 63f.). Die Generation der vom Krieg geprägten Frontsoldaten soll diesen Krieg fortsetzen. Jünger will nicht zurückschauen, sondern die Zukunft gestalten. Die Gruppe der Frontsoldaten, der sich Jünger zurechnet, muß daher versuchen, die Jugend zu gewinnen (S. 77).
Jüngers Programm nennt sich>Nationalismus<: "Ja wir sind nationalistisch, wir können gar nicht nationalistisch genug sein, und wir werden uns rastlos bemühen, die schärfsten Methoden zu finden, um diesem Nationalismus Gewalt und Nachdruck zu verleihen" (S. 163). Das nationalistische Programm soll auf vier Grundpfeilern basieren: Der kommende Staat muß national, sozial, wehrhaft und autoritativ gegliedert sein (S. 173, S. 179, S. 197, S. 218). Die "Staatsform ist uns nebensächlich, wenn nur ihre Verfassung eine scharf nationale ist" (S. 151). "Der Tag, an dem der parlamentarische Staat unter unserem Zugriff zusammenstürzt, und an dem wir die nationale Diktatur ausrufen, wird unser höchster Festtag sein" (S. 152). Mit dem Schlagwort Nationalismus ist wenig gesagt. Was ist es, das den Nationalismus des Frontsoldaten auszeichnet?
Durch den Krieg, so Jünger, wurde der von der wilhelminischen Epoche geprägte Frontsoldat in ganz andere Bahnen gerissen: "Er betrat eine neue, unbekannte Welt, und dieses Erlebnis rief in vielen jene völlige Veränderung des Wesens hervor, die sich am besten mit der religiösen Erscheinung der >Gnade< vergleichen läßt, durch welche der Mensch plötzlich und von Grund auf verwandelt wird" (S. 79).
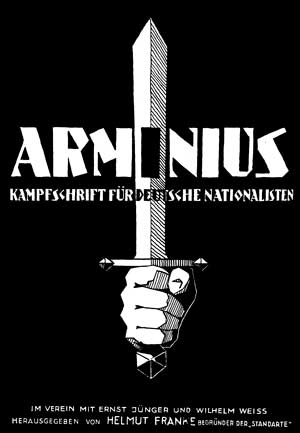 Mit dem Ende des Kaiserreichs verbindet Jünger die Überwindung einer materialistischen Naturanschauung, der individualistischen Idee allgemeiner Menschenrechte und des bloßen Strebens nach materiellem Wohlstand. Dagegen behauptet er die Bedeutung der >Nachtseite< des Lebens. 12 Gegen das rationalistische, mechanistische, materialistische Denken des Verstandes setzt er das Gefühl und den organischen Zusammenhang mit dem Ganzen: "Für uns ist das Wichtigste nicht eine Revolution der staatlichen Form, sondern eine seelische Revolution, die aus dem Chaos neue, erdwüchsige Formen schafft." (S. 114).
Mit dem Ende des Kaiserreichs verbindet Jünger die Überwindung einer materialistischen Naturanschauung, der individualistischen Idee allgemeiner Menschenrechte und des bloßen Strebens nach materiellem Wohlstand. Dagegen behauptet er die Bedeutung der >Nachtseite< des Lebens. 12 Gegen das rationalistische, mechanistische, materialistische Denken des Verstandes setzt er das Gefühl und den organischen Zusammenhang mit dem Ganzen: "Für uns ist das Wichtigste nicht eine Revolution der staatlichen Form, sondern eine seelische Revolution, die aus dem Chaos neue, erdwüchsige Formen schafft." (S. 114).
Die Weltanschauung, die Jünger seiner Generation der Frontsoldaten empfiehlt, hat ihre Wurzeln in der Romantik und der Lebensphilosophie Nietzsches. Jünger betont die Bedeutung des Gefühls der Gemeinschaft, der Verbindung mit dem Ganzen, denn das Gefühl stehe am Anfang jeder großen Tat. Wachstum ist für Jünger das natürliche Recht alles Lebendigen (S. 82), das keines Beweises zu seiner Rechtfertigung bedarf (S. 186):
Alles Leben unterscheidet sich und ist schon deshalb kriegerisch gegeneinander gestellt. Im Verhältnis des Menschen zu Pflanzen und Tieren tritt das ohne weiteres hervor, jeder Mittagstisch liefert den unwiderleglichen Beweis. Das Leben äußert sich jedoch nicht nur im Kampfe der Arten untereinander, sondern auch im Kampfe innerhalb der Arten selbst. (S. 133) 13
Jünger hat den soziologischen Blick, der dem Konservatismus seit der Romantik eigen ist. Deutlich zeigt sich seine Aufnahme romantischen Geschichtsdenkens in der Betonung des Besonderen gegen das Allgemeine, seiner Betonung der Abhängigkeit "von unserer Zeit und unserem Raum" (S. 158). Er fordert, mit "dem unheilvollen Streben nach Objektivität, die nur zur relativistischen Aufhebung der Kräfte führt, aufzuräumen" und sich zu bewußter Einseitigkeit zu bekennen, "die auf Wertung und nicht auf >Verständnis< beruht" (S. 79f.).
Ein wichtiges Moment in Jüngers Geschichtsdenken ist das Verhältnis von soziologischer Diagnose und zukünftiger Aufgabe. Wenn Jünger bestimmte historische Entwicklungen untersucht, bemüht er häufig die Kategorie der Notwendigkeit. Ereignisse treten mit Notwendigkeit ein. In der gescheiterten Revolution "lag auch eine Notwendigkeit" (S. 110). Über die Entwicklung der Technik urteilt er: "Zwangsläufige Bewegungen lassen sich nicht aufhalten" (S. 160).
Hinter der Überzeugung, daß bestimmte Ereignisse mit Notwendigkeit eintreten, steht die Vorstellung einer überpersönlichen Idee, die sich in der Geschichte zu verwirklichen sucht: Im Krieg gibt es Augenblicke, in denen "die kriegerische Idee sich rein, vornehm und mit einer prächtigen Romantik offenbart. Dort werden Heldentaten verrichtet, in denen kaum noch der Mensch, sondern die kristall-klare Idee selbst am Werke scheint" (S. 109).
Über den geschichtsphilosophischen Schwung der Jahre, in denen diese Aufsätze entstanden sind, schrieb Jünger am 20. April 1943 rückblickend in seinem zweiten Pariser Tagebuch:
Es ist die Geschichte dieser Jahre mit ihren Denkern, ihren Tätern, Märtyrern und Statisten noch nicht geschrieben; wir lebten damals im Eie des Leviathans. [...] Die Mitspieler sind ermordet, emigriert, enttäuscht oder bekleiden hohe Posten in der Armee, der Abwehr, der Partei. Doch immer werden diejenigen, die noch auf Erden weilen, gern von jenen Zeiten sprechen; man lebte damals stark von der Idee. So stelle ich mir Robespierre in den Arras vor. 14
Für den Jünger der zwanziger Jahre gilt: Der Mensch ist nichts ohne eine Idee. Scheitert die Verwirklichung einer Idee, wie in der Novemberrevolution, so scheitert sie notwendig, weil sie noch nicht stark genug war. Die Zeit war dann noch nicht reif genug. Aufgabe des einzelnen ist es, sich in den Dienst der Idee zu stellen: Die großen geschichtlichen Leistungen besitzen die Eigenschaft, daß der "Mensch nur als Werkzeug einer höheren Vernunft" (S. 93) tätig ist. 15
Auch hier zeigt sich: Jüngers Geschichtsdenken kommt aus dem 19. Jahrhundert und zeigt den für die Ideenlehre der historischen Schule typischen Hang zur geschichtsphilosophischen Spekulation. Karl Löwith, der Jünger in der Folge Nietzsches sah, hat darauf hingewiesen, daß "Jünger selbst noch der bürgerlichen Epoche entstammt" und daher in der problematischen Lage sei, daß das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht gilt. 16 Dies gilt weniger für die Inhalte, umsomehr aber für die Formen von Jüngers Denken.
Durch den Einfluß von Nietzsches vitalistischer Teleologie werden Jüngers geschichtsphilosophische Spekulationen auch biologisch fundiert: "Aber je mehr man beobachtet, desto mehr kommt man dazu, an die große geheimnisvolle Steuerung durch eine große biologische Vernunft zu glauben" (S. 171). 17 Und auch sein Begriff der Zeit zeigt Jünger, dem die Arbeiten Bergsons vertraut waren, in der Tradition des organologisch-lebensphilosophischen Denkens des 19. Jahrhunderts: Zeit ist ihm nichts Zufälliges, "sondern ein geheimnisvoller und bedeutungsvoller Strom, der jedes durchfließt und sein Inneres richtet, wie ein elektrischer Strom die Atome eines metallischen Körpers richtet und regiert" (S. 182).
Die Hinweise auf die Wurzeln von Jüngers Denken erfolgen nicht in der Absicht, Jüngers Originalität zu schmälern oder der bekannten Linie das Wort zu reden, nach der die Lebensphilosophie in den Faschismus mündet. Vielmehr geht es darum, Jüngers Geschichtsdenken in Beziehung zu setzen zur sogenannten >Konservativen Revolution<. Es soll untersucht werden, ob Jüngers Denken als konservative Revolution im Sinne der als >Konservative Revolution< etikettierten Geistesrichtung der Weimarer Republik begriffen werden kann.
Jüngers revolutionäre Einstellung ist offenkundig. Weniger deutlich ist, inwiefern sein Denken >konservativ<genannt werden kann. Das wichtigste >konservative< Moment in Jüngers Denken liegt in der Bedeutung der Gemeinschaft.
Das Gefühl der >Gemeinschaft in einem großen Schicksal<, das am Beginn des Krieges stand, das Bewußtsein der Idee der Nation und die gemeinsame >Unterwerfung unter eine Idee< sind für Jünger Zeichen einer grundsätzlichen Kurskorrektur: "Wir erblicken darin die erste Anknüpfung einer verloren gegangenen Verbindung, die Offenbarung einer höheren Sicherheit, die sich im Persönlichen als Instinkt äußert" (S. 86).
Jünger bejaht die Revolution, aber er schränkt ihre Bedeutung zugleich ein, indem er sie als Methode und nicht als Ziel begreift. Sie kann nur Methode sein, denn der "Frontsoldat besitzt Tradition und weiß, daß alle Größe und Macht organisch gewachsen sein muß, und nicht aus der reinen Verneinung, aus dem leeren Dunst herausgegriffen werden kann. Wie er den Krieg nicht verleugnet, sondern aus ihm als einer stolzen Erinnerung heraus die Kraft zu neuen Aufgaben zu schöpfen sucht, so fühlt er sich auch nicht berufen, das zu verachten, was die Väter geleistet haben, sondern er sieht darin die beste und sicherste Grundlage für das neue größere Reich." (S. 124f.; vgl. S. 128f.)
Die Denkfigur einer >Konservativen Revolution< zielt auf den Versuch, einen organischen Zusammenhang wiederherzustellen. Das Eintreten für eine >Konservative Revolution< lebt also wesentlich von der Entscheidung, an welche gewachsenen Traditionen wieder angeschlossen werden soll. Jüngers Forderung nach einer Revolution, die an die Tradition anschließt, bestimmt sich aber im wesentlichen ex negativo. Die Verbindung, die Jünger zwischen seiner historistischen Lebensphilosophie und seinem Nationalismus herstellen will, bleibt so rein äußerlicher Natur. Es fehlt ihr der Nachweis eines inneren Zusammenhanges.
Ein Argument für diesen Zusammenhang bleibt nur der Versuch, das Individuum auf der Ebene des Gefühls an die organisch gewachsene Nation zu binden. Die Bildung der Nation müßte aber nicht zwingend auf Jüngers Fassung eines autoritativen Nationalismus hinauslaufen. Lediglich die Opposition zu bestimmten Weltanschauungen ist durch den Willen, das Individuum organisch einzubinden, notwendig. Für die Krise des entwurzelten Individuums ist diesem Willen gemäß der Liberalismus und mit ihm die Idee der parlamentarischen Demokratie verantwortlich.
Die großen Gefahren sieht Jünger daher "nicht im marxistischen Bollwerk" (S. 148, S. 151), sondern in allem, was mit dem Liberalismus zusammenhängt: Die "Frage des Eigentums gehört nicht zu den wesentlichen, die uns vom Kommunismus trennen. Sicher steht uns der Kommunismus als Kampfbewegung näher als die Demokratie, und sicher wird irgendein Ausgleich, sei er friedlicher oder bewaffneter Natur erfolgen müssen"(S. 117).
Schon die 19 Aufsätze in der Beilage Die Standarte zwischen September 1925 und März 1926 würden ausreichen, um das Urteil zu korrigieren, Jünger sei im Grunde ein unpolitischer Einzelgänger gewesen. Unabhängig von den politischen Bekenntnissen, die Jünger abgibt, wird dies schon durch seine leidenschaftliche Parteinahme deutlich. Aber auch später spricht Jünger von dem kleinen Kreis, dem er angehöre (S. 197), und greift immer wieder auf die Wir-Form zurück: "Wir Nationalisten" (S. 207). Ein Aufsatz beginnt mit der Anrede: "Nationalisten! Frontsoldaten und Arbeiter!" (S. 250) Und in einem anderen heißt es: "ich spreche im Namen von hunderttausend Frontsoldaten" (S. 267).

Um so erstaunlicher ist es, daß der Herausgeber Sven Berggötz in seinem Nachwort schreibt, Jünger hätte zwar durchaus einen beachtlichen Leserkreis erreicht, aber dieser hätte "sich weitgehend auf Leser mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund beschränkt". So habe er zwar auf die Meinungsbildung eingewirkt, aber "mit Sicherheit nicht in signifikanter Weise Einfluß auf die öffentliche Meinung genommen" (S. 867).
Weshalb 170 000 den Stahlhelm lesende ehemalige Frontsoldaten nicht zur öffentlichen Meinung zählen, bleibt Berggötz' Geheimnis – oder wollte Berggötz bloß sagen, die Stahlhelmer dachten ohnehin schon, was Jünger formulierte? Von welchem Autor ließe sich dann nicht behaupten, er artikuliere nur, was andere denken? Noch unverständlicher ist aber sein abschließendes Urteil: "Letztlich war Jünger schon damals ein im Grunde unpolitischer Mensch, der im wesentlichen utopische Vorstellungen vertrat." (S. 868) Als ob Utopie und Politik einen Gegensatz darstellten. 18
Der Stahlhelm–Beilage Die Standarte war keine lange Lebenszeit beschieden. Schon nach sieben Monaten erschien Die Standarte im März 1926 nach Unstimmigkeiten mit der Bundesleitung des Stahlhelm zum letzten Mal. Nachfolgeorgan war die fast gleichnamige Standarte. Wochenschrift des neuen Nationalismus, die nun selbständig erschien – herausgegeben von Ernst Jünger, Helmuth Franke, Franz Schauwecker und Wilhelm Kleinau. Ihre Auflage von vermutlich wenigen Tausend Exemplaren reichte nicht annähernd an Die Standarte heran.
Das Selbstverständnis der Herausgeber wird in einem programmatischen Beitrag Helmut Frankes für die erste Nummer der neuen Standarte deutlich: "Wir Standarten-Leute kommen aus allen Lagern: Vom konservativen bis zum jungsozialistischen. Die faschistische Schicht hat kein Programm. Sie wächst und handelt. " 19
Auch die Standarte erschien nicht lange. Im August 1926 wurde die Zeitschrift vorübergehend verboten, weil in dem Artikel Nationalistische Märtyrer die Morde an Walther Rathenau und Matthias Erzberger legitimiert worden waren. Im November 1926 gründete Jünger mit Helmut Franke und Wilhelm Weiss die nächste Zeitschrift: Arminius. Kampfschrift für deutsche Nationalisten (teilweise mit dem Nebentitel: Neue Standarte), die bis September 1927 existierte. Im Oktober 1927 gründete Jünger mit Werner Lass die Zeitschrift Vormarsch. Blätter der nationalistischen Jugend, die bis 1929 erschien. Die nächste Zeitschrift war ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt von Jünger und Werner Lass. Von Januar 1930 bis Juli 1931 gaben sie die Zeitschrift Die Kommenden. Überbündische Wochenschrift der deutschen Jugend heraus.
Zwischen 1926 und 1930 war Jünger also nahezu ununterbrochen in die Herausgabe von Zeitschriften involviert. Neben einer Vielzahl von Beiträgen, die er für seine Zeitschriften schrieb, veröffentlichte Jünger auch in einigen anderen Organen, z. B. in Wilhelm Stapels Deutschem Volkstum.
Einzelne Beiträge erschienen auch in Zeitschriften der demokratischen Linken, in Willy Haas' Literarischer Welt und in Leopold Schwarzschilds Das Tagebuch. Hier stellte Jünger seinen Nationalismus vor. Eine größere Zahl von Beiträgen plazierte Jünger in Ernst Niekischs Widerstand. Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik. Nach 1931 schrieb er fast nur noch in diesem Blatt. Die Hauptphase seiner politischen Arbeiten endet 1930.
Nachdem die Stahlhelmleitung im Oktober 1926 die Parole >Hinein in den Staat< ausgegeben hatte, ging Jünger scharf auf Distanz. Im November 1926 äußerte er seine Befremdung ob der Ereignisse im Stahlhelm und reagierte: Der Wille müsse frei gemacht werden von "organisatorischen Verbindungen, die sich als Fessel" erwiesen haben (S. 258): "Reine Bewegung, aber nicht Bindung fordern wir" (S. 259, vgl. S. 256). Im Februar 1927 wiederholte er im Arminius seinen Angriff: Der Stahlhelm ist "bürgerlicher und damit liberalistischer Natur" (S. 305).
Hinter dem Bekenntnis zum Staat, das die Stahlhelmleitung verkündet hatte, vermutete Jünger bestimmte Interessengruppen: Man "bemühe sich mit Hilfe zur Verstärkung herbeigerufener Routiniers, die sich durch jahrelange Tätigkeit an jenen esoterischen Debattierklubs in Berlin W. ein Höchstmaß an politischer Balancierkunst erworben haben, die Hineinparole so zu verklausulieren, daß sie ebensogut sie selbst wie ihr Gegenteil sein kann" (S. 305).
Nachdem Jünger und seine Mitstreiter aus dem Stahlhelm zurückgedrängt worden waren, gewannen Mitglieder des Juniklubs zunehmend Einfluß. 20 Neben Heinz Brauweiler, dem Theoretiker des Ständestaats, tat sich vor allem der >Antibolschewist< Eduard Stadtler hervor. 21 Stadtler war vor dem Krieg Sekretär der Jugendbewegung der Zentrumspartei. Nach dem Krieg wurde er durch die Gründung der Antibolschewistischen Liga bekannt. Stadtler gehörte zu den ersten, die eine Verbindung von Konservatismus und Revolution als Programm expressis verbis formulierten. 22 Anfang der zwanziger Jahre war er eine der führenden Figuren des Juniklubs.
Versteht man unter >Konservativer Revolution< eine politische Richtung, den Zusammenhang verschiedener Personen und Gruppen, die ein gemeinsames politisches Ziel haben, so ist zu klären, in welchem Verhältnis diese Personen zueinander standen, wo und wie sie sich organisierten.
Im August 1926 hatte Jünger geschrieben: "Dieser Nationalismus ist ein großstädtisches Gefühl" (S. 234). Im Juni 1927 zog er mit seiner jungen Familie von Leipzig nach Berlin um. Zunächst wohnte er in der Nollendorfstraße in Schöneberg, also in unmittelbarer Nähe der Motzstraße, wo die Jungkonservativen im Schutzbundhaus in der Nr. 22 ihre Zusammenkünfte abhielten. Jünger blieb nicht lange in West-Berlin. Bereits nach einem Jahr siedelte er um in den Ostteil der Stadt, in die Stralauer Allee, wo vornehmlich Arbeiter wohnten. 23 1931 zog Jünger in die Dortmunder Straße, nähe Bellevue, 1932 in das ruhige, bürgerliche Steglitz.
Natürlich kann man aus dem Wechsel der Wohnorte nicht einfach auf die Entwicklung eines Denkens schließen. Aber es wird kein bloßer Zufall gewesen sein, daß Jünger zunächst in so unmittelbarer Nähe der Motzstraße wohnte, daß er den Arbeiter schrieb und in einem Arbeiterviertel wohnte, daß sein allmählicher Rückzug aus der politischen Agitation mit dem Umzug nach Steglitz zusammenfiel.
Über die Kontakte Jüngers zu den Jungkonservativen ist wenig bekannt. Hans-Joachim Schwierskott hat seiner Biographie Moellers eine Mitgliederliste der Jungkonservativen beigegeben, in der sich auch der Name Jüngers findet. 24 Aber das Verhältnis zwischen Jünger und den Jungkonservativen war gespannt. In seinen politischen Arbeiten erwähnt Jünger Moeller gelegentlich, aber neben einer Anspielung auf Edgar Julius Jungs Buch Die Herrschaft der Minderwertigen (S. 432) gibt es kaum explizite Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit den Jungkonservativen.
Der erwähnte Angriff auf die "esoterischen Debattierclubs in Berlin-West" deutet darauf hin, daß Jünger in für ihn wesentlichen Punkten Differenzen zwischen sich und Jungkonservativen wie Eduard Stadtler, Max Hildebert Boehm oder Edgar Julius Jung sah. Vermutlich waren sie ihm zu bürgerlich, zu liberal, zu christlich, zu sehr im Staat. Den Gedanken einer hierarchisch geprägten Stände-Gesellschaft lehnte Jünger vehement ab: "Aufgrund des Blutes und des Charakters wollen wir uns in Gemeinschaften und immer größere Gemeinschaften binden, ohne Rücksicht auf Wissen, Stand und Besitz, und uns klar trennen und scheiden von allem, was nicht in diese Gemeinschaften gehört" (S. 212).
Aus den Reihen der sich um den 1925 verstorbenen Moeller van den Bruck gruppierenden Jungkonservativen sollte Jünger später heftig attackiert werden. Seine konsequenten Angriffe auf alles Bürgerliche – ein Grundmotiv der politischen Publizistik, das er im Arbeiter besonders radikal vertrat – brachte Jünger eine heftige Replik seitens Max Hildebert Boehms ein. 25 Aber Jünger hat von Seiten der Jungkonservativen auch Zuspruch gefunden. Der Philosoph Albert Dietrich, ein Schüler Ernst Troeltschs und Mitglied des Juniklubs seit der ersten Stunde, überwarf sich mit Boehm über dessen Angriff auf Jünger. 26 Auch hatte Jünger gute Kontakte zu einem anderen Flügel der Jungkonservativen Bewegung‚ zum sogenannten >Tatkreis< um Hans Zehrer, Giselher Wirsing und Ferdinand Fried. 27
Ob die Zuordnung Jüngers zur >Konservativen Revolution< gerechtfertigt ist, kann nicht pauschal entschieden werden. Zumindest drei Unterscheidungen bieten sich an.
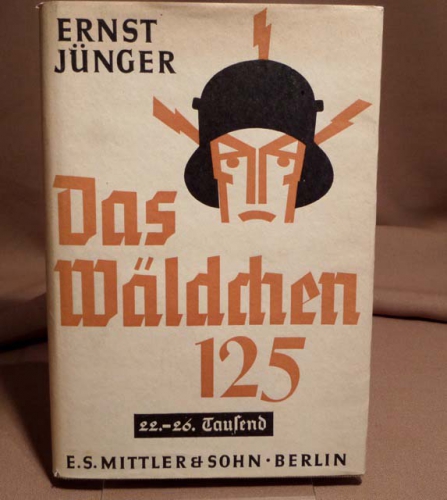 Es sind erstens die personellen Verbindungen zu betrachten. Sie können Zeichen sein für ein gemeinsames Arbeiten an gemeinsamen Zielen, auch wenn in letzter Instanz die Ziele nicht die gleichen sind. Zweitens sind die konkreten politischen Positionen zu untersuchen und zu vergleichen. Und drittens ist nach Gemeinsamkeiten der Denkstile, der Denkfiguren, der Mentalität zu suchen.
Es sind erstens die personellen Verbindungen zu betrachten. Sie können Zeichen sein für ein gemeinsames Arbeiten an gemeinsamen Zielen, auch wenn in letzter Instanz die Ziele nicht die gleichen sind. Zweitens sind die konkreten politischen Positionen zu untersuchen und zu vergleichen. Und drittens ist nach Gemeinsamkeiten der Denkstile, der Denkfiguren, der Mentalität zu suchen.
Über die erste Möglichkeit einer Zuordnung sind bereits einige Anmerkungen gemacht worden. Ihre Bearbeitung erfordert die umfangreiche Sichtung der Nachlässe, um anhand von Briefzeugnissen und anderen persönlichen Dokumenten bekannte und unbekannte Verbindungen zu rekonstruieren.
Die zweite Möglichkeit ist durch die Arbeiten Stefan Breuers sehr erhellt worden. Breuer hat in einem Vergleich der konkreten politischen Positionen einer großen Gruppe von Autoren und Strömungen, die Armin Mohler und einige andere als >Konservative Revolution< bezeichnet haben, eindrucksvoll gezeigt, daß sich insgesamt betrachtet eine im einzelnen auch noch unterschiedlich weit gehende Liberalismuskritik als einziger gemeinsamer Nenner ausmachen läßt.
Dies ist nach Breuer zu wenig, um von einem einheitlichen Gebilde zu sprechen, da eine vehemente Kritik des Liberalismus auch von anderer Seite geübt wurde. Die Rede von der >Konservativen Revolution<, so Breuer, sei daher aufzugeben, da es sich um einen im wesentlichen auf Mohler zurückgehenden Mythos der Forschung handle. 28
Die Suche nach einheitsstiftenden Momenten der >Konservativen Revolution< kann auch jenseits konkreter politischer Programme auf der Ebene der Denkstile und der Mentalität ansetzen. Für Mohler ist diese dritte Möglichkeit die entscheidende. Nach Mohler ist das entscheidende Leitbild die "ewige Wiederkehr des Gleichen" Er versteht dieses Bild als den Versuch, die christliche Auffassung der Geschichte zu sprengen. Das Bild "der ewigen Wiederkehr des Gleichen" biete ein Gegenstück zum linearen Modell der Zeit, an welches die Idee des Fortschritts gekoppelt sei.
Zwar meint Mohler, daß es nicht für alle, die er der >Konservativen Revolution< zurechnet, "in gleichem Maße verpflichtend" sei, aber ihre wesentliche Denkfigur sieht er in den Gedanken Nietzsches vorgebildet. Er folgt Nietzsche in dem Dreischritt: Diagnose des Wertezerfalls, Affirmation dieses Prozesses (Nihilismus) bis zur Vollendung der Zerstörung der alten (christlichen) Werte, damit die Zerstörung in Schöpfung umschlagen kann. 29
Auch Breuer findet auf der Ebene der Mentalität eine Gemeinsamkeit der >Konservativen Revolution<. Während er in den konkreten politischen Positionen keine hinreichende Übereinstimmung findet, die es nahelegen würde, von der >Konservativen Revolution< zu sprechen, sieht er bei allen Autoren eine "Kombination von Apokalyptik, Gewaltbereitschaft und Männerbündlertum" 30 . Diese Bestimmung ist jedoch, wie Breuer selbst bemerkt, zu weit und unbestimmt, und daher ebenso unbefriedigend wie die Bestimmung über die gemeinsame Kritik am Liberalismus.
Mohlers Bestimmung hingegen ist zu eng. Die Unterstellung, der >Konservativen Revolution< sei eine antichristliche Stoßrichtung genuin inhärent, ist denn auch unmittelbar nach Erscheinen der ersten Auflage seines Buches stark kritisiert worden. 31
In der Linie dieser Kritik kann man gegen Mohler einwenden, einseitig einen eher unorganischen Begriff des Konservatismus in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Wenn Mohler, die Formulierung Albrecht Erich Günthers aufgreifend, das Konservative versteht "nicht als ein Hängen an dem, was gestern war, sondern an dem was immer gilt", so betont er nur ein Moment des Konservatismus. 32 Denn der deutsche Konservatismus ist seit seinen Ursprüngen in der Romantik weitgehend organologisch und historistisch, d. h. mehr dem Gedanken organischer Entwicklung und einer sich entwickelnden und unterschiedlich ausgestaltenden Wahrheit als dem überzeitlicher Geltung verpflichtet.
In Mohlers Bestimmung des Konservativen ist die Tradition des romantischen Konservatismus – also gerade die Tradition, der die meisten Jungkonservativen verpflichtet sind – zu sehr in den Hintergrund gerückt. 33 So ergibt sich ein schiefes Bild: Diejenige Gruppe, die die Parole >Konservative Revolution< populär gemacht hat, ist in Mohlers Fassung der >Konservativen Revolution< eine Randgruppe, der eine "nur sehr bedingte revolutionäre Haltung" attestiert wird. 34
Nur folgerichtig ist daher Mohlers Vermutung, daß bei der Verbindung von jungkonservativem Christentum und seinem Leitbild der >Konservativen Revolution< eines von beidem Schaden leide.
Zu den Merkmalen organologischen Denkens im deutschen Konservatismus sind im wesentlichen zwei Momente zu zählen: Zum einen die Annahme einer Eingebundenheit des Einzelnen in die Gemeinschaft, zum anderen ein Bild der Geschichte, nach dem eines aus dem anderen wachsen soll. Konservativ sein, bedeutet seit Edmund Burkes Kritik der Französischen Revolution eine kritische Haltung gegenüber jeder radikalen gesellschaftlichen Veränderung. Nicht Veränderung überhaupt, sondern jede Veränderung, die sich nicht in einer Gemeinschaft organisch entwickelt, wird vom konservativen Standpunkt abgelehnt.
Indem der Konservatismus seine Wurzeln in der Kritik der französischen Revolution hat, ist ihm von Beginn an die aporetische Struktur einer >Konservativen Revolution< eigen. 35 Ist der organische Zusammenhang einmal aufgebrochen, muß sich der Konservative eines Mittels bedienen, das er eigentlich ablehnt. Er muß durch einen radikalen Schritt wieder versuchen, gemeinschaftliche Bindung zu gewinnen. Kein Konservatismus kann seine Werte erst neu schaffen.
Aber je tiefer die in der Vergangenheit liegenden Werte verschüttet sind, desto schwieriger wird der Versuch, wieder einen Anschluß zu gewinnen. Nach dem ersten Weltkrieg ist der Konservatismus in Deutschland in einer Verfassung, in der über den Gehalt der Werte der Gemeinschaft – wie die Untersuchungen Breuers zeigen – keine Einigkeit mehr besteht.
Der Schluß, den Breuer aus diesem Ergebnis zieht, daß man besser nicht mehr von der >Konservativen Revolution< sprechen sollte, könnte dennoch verfrüht sein. Denn es könnte ja entweder sein, daß die Formel >Konservative Revolution< eine gemeinsame Denkfigur verschiedener Gruppen benennt, oder aber, daß zwar sinnvoll von der >Konservativen Revolution< gesprochen werden kann, die Gruppe derer, die ihr angehören, jedoch enger gezogen werden muß, als in den Arbeiten Mohlers und seiner Nachfolger.
In eigener Sache hat Jünger das Bild einer >Konservativen Revolution< nicht verwendet. Schon der Begriff >konservativ< für sich genommen bezeichnet für Jünger in der Regel etwas ihm Fremdes (218). In Sgrafitti blickte er 1960 mit Distanz auf die Idee einer >Konservativen Revolution< zurück. 36
Er selbst zählte sich ganz offensichtlich nicht zur >Konservativen Revolution<. Alfred Andersch gegenüber bekannte er im Juni 1977: "Sie rechnen mich nicht den Konservativ-Nationalen, sondern den Nationalisten zu. Rückblickend stimme ich dem zu. " 37
Daß sich bei Jünger die Formulierung >Konservative Revolution< nicht in eigener Sache findet, muß nicht bedeuten, daß sich nicht wesentliche ihrer Momente bei ihm aufweisen lassen. Jünger glaubte ja, nur auf dem Weg einer Revolution könne eine Überwindung der mißlichen Gegenwart gelingen.
Die Frage bleibt nur, inwiefern die erstrebten Veränderungen als konservativ aufgefaßt werden können. In den Aufsätzen der Jahre 1925 und 1926 fanden sich einige für das Denken des Konservativen typische Momente: die Bedeutung der Gemeinschaft und die Bedeutung der Tradition.
Etwa ab dem Frühjahr 1926 – in einer Phase, die politisch zu den stabilsten der Weimarer Republik gehörte – wird Jünger in seinen Positionen jedoch immer radikaler. Von einer Bedeutung der Tradition ist nicht mehr die Rede.
Bei oberflächlicher Betrachtung ist eine Veränderung seines Denkens nicht zu erkennen, denn noch im September 1929 bestimmt er den Charakter des Nationalismus wie ehedem durch Angabe der genannten vier Punkte: Der Nationalismus strebe den national, sozial, wehrhaft und autoritativ gegliederten Staat aller Deutschen an (S. 504). Immer wieder kehren die Motive, daß das Sterben der Soldaten im großen Krieg einen Sinn gehabt habe (S. 239), daß alles Wesentliche nur erfühlt und nicht begriffen werden könne (S. 288).
 Bestimmend bleibt auch die Bedeutung der Idee: "Nach neuen Zielen verlangt unser Blut, es fordert Ideen, an denen es sich berauschen, Bewegungen, in denen es sich erschöpfen und Opfer, durch die es sich selbst verleugnen kann" (S. 196).
Bestimmend bleibt auch die Bedeutung der Idee: "Nach neuen Zielen verlangt unser Blut, es fordert Ideen, an denen es sich berauschen, Bewegungen, in denen es sich erschöpfen und Opfer, durch die es sich selbst verleugnen kann" (S. 196).
Etwa seit Mitte 1926 zeigen sich deutliche Akzentverschiebungen. Immer stärker hebt Jünger nun die Notwendigkeit reiner Bewegung, reiner Dynamik hervor: Die Stärke einer Aktion besteht darin, "daß sie zu hundert Prozent Bewegung bleibt" (S. 256, vgl. auch S. 267). 38 Jüngers eigene Einschätzung gibt eine interessante Beschreibung der kollektiven Psyche seiner Generation: "Wir sind Dreißigjährige, früh durch eine harte Schule gegangen, und was sich in uns nicht gefestigt hat, das wird nicht mehr zu festigen sein." (S. 206)
Der Bruch mit dem Stahlhelm war mehr als ein tagespolitisches Ereignis. Er markiert den Beginn eines neuen Angriffs. Jünger fordert weiter, aber forcierter als bisher, die Revolution und den Bruch mit der Demokratie. Mit dem Ehrentitel Nationalisten wollen sich er und die seinen – "Männer, die gefährlich sind, weil es ihnen eine Lust ist, gefährlich zu sein" – vom "friedlichen Bürger" abwenden, schreibt er im Mai 1926 (S. 213). Der Nationalist habe
die heilige Pflicht, Deutschland die erste wirkliche, das heißt von sich rücksichtslos bahnbrechenden Ideen getriebene Revolution zu schenken. Revolution, Revolution! Das ist es, was unaufhörlich gepredigt werden muß, gehässig, systematisch, unerbittlich, und sollte dieses Predigen zehn Jahre lang dauern. [...] Die nationalistische Revolution braucht keine Prediger von Ruhe und Ordnung, sie braucht Verkünder des Satzes: >Der Herr wird über Euch kommen mit der Härte des Schwerts!< Sie soll den Namen Revolution von jener Lächerlichkeit befreien, mit der er in Deutschland seit fast hundert Jahren behaftet ist. Im großen Kriege hat sich ein neuer gefährlicher Menschenschlag entwickelt, bringen wir diesen Schlag zur Aktion! (S. 215)
Seine grundsätzliche Ablehnung der Demokratie brachte Jünger in einem Punkt immer wieder in Distanz zum Nationalsozialismus. Vor den Wahlen schrieb er im August 1926: "es bedeutet einen verhängnisvollen Zwiespalt, eine Einrichtung als theoretisch unsittlich zu erklären und gleichzeitig praktisch an ihr teilzunehmen. [...] Was gefordert werden muß, ist ein allgemeines striktes Verbot, an einer Wahl teilzunehmen" (S. 243ff.).
Schon früher hatte Jünger deutlich gemacht, daß er keinen unüberwindbaren Gegensatz zwischen Sozialismus und Nationalismus entdecken könne. Im Dezember 1926 bekannte er sich offen zur bolschewistischen Wirtschaftspolitik: "Wir suchen die Wirtschaftsführer davon zu überzeugen, daß unser Weg auf geradester Linie zu jener staatlich geordneten Zentralisation führt, die uns allein konkurrenzfähig erhalten kann." (S. 269)
Mit der Liberalismuskritik der Romantik, mit den >Ideen von 1914<, teilt Jünger weiter wesentliche Überzeugungen: Es gebe kein moralisches Gesetz an sich, jedes Gesetz werde durch den Charakter bestimmt. Denn Charaktere "sind nicht den Gesetzen des Fortschrittes, sondern denen der Entwicklung unterworfen. Wie in der Eichel schon der Eichbaum vorausbestimmt ist, so liegt im Charakter des Kindes schon der des Erwachsenen" (S. 210). Allgemeine Wahrheiten, eine allgemeine Moral läßt Jüngers Historismus nicht gelten:
Wir glauben vielmehr an ein schärfstes Bedingtsein von Wahrheit, Recht, Moral durch Zeit, Raum und Blut. Wir glauben an den Wert des Besonderen. [...] Aber ob man an das Allgemeine oder das Besondere glaubt, das ist nicht das Wesentliche, wie am Glauben überhaupt nicht die Inhalte das Wesentliche sind, sondern seine Glut und seine absolute Kraft. (S. 280)
Jünger nimmt hier – im Januar 1927 – ein zentrales Motiv des Abenteuerlichen Herzens vorweg: "Ein Recht ist nicht, sondern wird gesetzt, und zwar nicht vom Allgemeinen, sondern vom Besonderen" (S. 283). Im Abenteuerlichen Herz heißt es noch eindrücklicher: "Daher kommt es, daß diese Zeit eine Tugend vor allen anderen verlangt: die der Entschiedenheit. Es kommt darauf an, wollen und glauben zu können, ganz abgesehen von den Inhalten, die sich dieses Wollen und Glauben gibt." 39
Wenn die Einsicht in die historische Gewordenheit die Absolutheit jeder Weltanschauung in Frage stellt, kann dies dazu führen, daß keine wahrer und damit verbindlicher scheint als die andere. In so einer Zeit mag es durchaus sinnvoll sein, für die Bedeutung der Entscheidung, ja für die Notwendigkeit der Entscheidung einzutreten. Wenn aber das >wofür< der Entscheidung beliebig wird, man sich nicht für eine Position entscheidet, für die man zwar keine rationalen Gründe, aber immer noch Gründe anzuführen vermag, dann handelt es sich, wie Jünger ja auch selbst gesehen hat, um reinen Nihilismus. Ob man diesen Nihilismus als Stadium des Übergangs begreift oder nicht, mit einer konservativen Haltung ist diese Position nicht mehr in Einklang zu bringen.
Im September 1929 erschien in dem von Leopold Schwarzschild herausgegebenen linksliberalen Tagebuch ein Aufsatz Jüngers, in dem seine Stellung zum Konservatismus besonders deutlich wird. Jünger war von Schwarzschild aufgefordert worden, seine Position darzustellen. Unmittelbarer Anlaß waren die Attentate der Landvolkbewegung, die in der Presse heftig diskutiert wurden.
Jünger wurde vorgestellt als "unbestrittener geistiger Führer" des jungen Nationalismus, für den "sogar Hugenberg, Hitler und die Kommunisten reaktionäre Spießbürger" (S. 788) sind. Jünger stellte klar, daß sein Nationalismus mit dem "Konservativismus" nicht "das mindeste zu schaffen" habe (S. 504, vgl. S. 218). 40 Seine Kritik an der parlamentarischen Demokratie trifft jeden, der sich nicht außerhalb der Ordnung des bestehenden Systems stellt. Letztlich sind ihm alle revolutionären Kräfte innerhalb eines Staates unsichtbare Verbündete (S. 506). Zerstörung sei daher das einzig angemessene Mittel: "Weil wir die echten, wahren und unerbittlichen Feinde des Bürgers sind, macht uns seine Verwesung Spaß" (S. 507). 41
Der Aufsatz im Tagebuch löste eine rege Diskussion um Jüngers Standort aus. Wenige Monate später, im Januar 1930, nahm Jünger in Niekischs Widerstand dazu Stellung ( Schlußwort zu einem Aufsatze): Die "Wendung zur Anarchie" habe sich "endgültig im Jahr 1927" vollzogen, zunächst sei sie jedoch nur "im kleinsten Kreis" zur Sprache gekommen.
Vor mir liegen meine Briefbände aus diesem Jahr, die mit Ausführungen gespickt sind über das, was wir damals den Nihilismus nannten, und dem wir morgen vielleicht wieder einen anderen Namen geben werden - vielleicht sogar den des Konservativismus, wenn es uns Vergnügen macht. Denn Chaos und Ordnung besitzen eine engere Verwandtschaft als mancher Glauben mag. (S. 541) 42
In einem der Briefe, aus denen Jünger zwei längere Passagen zitiert, heißt es, "wir" seien "als Glieder einer Generation vorläufig nur echt", "als wir durch den Nihilismus hindurchgehen und unseren Glauben noch nicht formulieren" (S. 542f.). Jünger kommentiert: Diesen Gedankengängen liege das Bestreben zu Grunde, "das Sein von allen Gewordenen Gebilden zu lösen, um es tieferen und furchtbareren Gewalten anzuvertrauen – solchen, die nicht das Opfer, sondern die Triebkräfte der Katastrophe sind" (S. 543).
Was Jünger und seinem Kreis vorschwebte war also ein radikaler Bruch mit der geschichtlichen Überlieferung überhaupt. Aus der Sicht des deutschen Konservatismus kann man nicht antikonservativer eingestellt sein. Jünger war sich dieses Antikonservatismus vollends bewußt, indem er ihm einen anderen Konservatismus gegenüberstellte:
Die Ursprünglichkeit des Konservativen zeichnet sich dadurch aus, daß sie sehr alt, die des Revolutionärs, daß sie sehr jung sein muß. Die Konservativen von heute sind aber fast ohne Ausnahme erst hundert Jahre alt. [...] Mit anderen Worten: Der Bannkreis des Liberalismus hat größere Reichweite, als man im allgemeinen glaubt, und fast jede Auseinandersetzung vollzieht sich innerhalb seines Umkreises. (S. 589)
In den Aufsätzen des Jahres 1930 manifestierte sich der antihistoristische Affekt weiter. 43 Im Mai 1930 schrieb Jünger:
Unser Gesellschaftsgefühl ist anarchisch. [...] Überall offenbart sich das Streben nach neuer Ordnung, nach Schaffung neuer, im besten Sinne männlicher Werte. Eine Evolution aber ist unmöglich! Nur die kommende, die mit zwingender Gewalt kommende Revolution kann Besserung bringen. [...] Erst aus den Tiefpunkten kulturpolitischer Falschwirtschaft wird sich – gemäß des ehernen Gesetzes der Weltgeschichte – bei uns der Aufstieg vollziehen! (S. 583)
Bestimmt man die >Konservative Revolution< als den radikalen Versuch, das, was traditionell in Deutschland Konservatismus genannt wird, unter den Bedingungen einer antikonservativen Zeit wieder zu beleben, so kann Jünger nach 1926 eigentlich nicht mehr zur >Konservativen Revolution< gezählt werden.
Für Mohler, der einen ungeschichtlichen, eher anthropologischen Konservatismusbegriff zu Grunde legt, bietet Jüngers Denken um 1929 jedoch beinahe den Idealtyp der >Konservativen Revolution<. In einer Hinsicht bleibt jedoch eine Spannung. Die Absage an jede geschichtliche Überlieferung bedeutet auch eine Absage an Geschichtsphilosophie. Jünger bleibt jedoch durch seinen Hang zur Idee dem geschichtsphilosophischen Denken in einem wesentlichen Punkt verhaftet. 44
Zum Schluß noch einige Bemerkungen zu der von Sven Berggötz besorgten Edition. Leider haben sich in die Texte Jüngers einige Fehler eingeschlichen. Bei der Edition eines Klassikers ist dies besonders ärgerlich.
An einigen Stellen störte sich Berggötz an Jüngers Grammatik und griff in den Text ein. Einen Autor vom Format Jüngers bei der Bildung eines Genitivs zu korrigieren, ist eigentlich überflüssig.
Einige der Texteingriffe sind jedoch unbegreiflich. Sie zeigen, wie fremd dem Herausgeber das Denken Jüngers geblieben ist. Natürlich meint Jünger in der folgend angeführten Passage "das Arbeiten der Idee" und nicht ein "Arbeiten an einer Idee". Ideen sind für Jünger überpersönliche Mächte: "Denn was jetzt in allen Völkern vor sich geht, ist das Arbeiten [an] einer universalen Idee" (S. 262).
Weshalb es in der folgenden Passage "Tugend" heißen soll, wie Berggötz in seinem Kommentar vermutet (S. 770), ist ebenfalls nicht einzusehen: "Es bedürfte dieser Aufforderung nicht, denn ich betrachte mich überall als Mitkämpfer, wo man mit jener stillen Entschiedenheit, in der ich die für unsere Zeit notwendigste Jugend [sic] erblicke, an der Rüstung ist" (S. 449f.). Unverständlich ist auch, weshalb die wenigen Fußnoten Jüngers sich nicht in den Texten Jüngers, sondern in den Kommentaren finden.
In den Kommentaren finden sich zwar viele interessante und hilfreiche Erläuterungen, einige Kommentare provozieren jedoch Kritik. In einem Kommentar zum "Fundamentalsatze des Descartes" (S. 503) heißt es, das "ich denke, also bin ich" sei "der erste absolut gewisse Grundsatz, mit dem Descartes die Wende der neuzeitlichen Philosophie zum Sein begründete" (S. 710). Einmal ganz abgesehen davon, daß ein Kommentar zu Descartes' "Fundamentalsatz" vezichtbar wäre: Mit gleichem Recht könnte es auch heißen, der Satz begründe die Wende zum Bewußtsein.
Ein anderes Beispiel: Eine Bemerkung Jüngers über Keyserlings Reisetagebuch eines Philosophen (S. 160) kommentiert Berggötz mit dem Hinweis, Thomas Mann hätte das Buch für die Frankfurter Zeitung rezensieren sollen. Nun weiß der Leser, daß sich Berggötz auch für Thomas Mann interessiert. Für das Verständnis von Jüngers Text ist dieser Kommentar unerheblich.
Viele eindeutige Anspielungen und Zitate blieben hingegen unkommentiert. Nicht wo sich Goethes Wendung "alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" findet, sondern wo Rathenau gesagt hat, daß die Weltgeschichte ihren Sinn verloren hätte, "wenn die Repräsentanten des Reiches als Sieger durch das Brandenburger Tor in die Hauptstadt eingezogen wären" (S. 575), möchte man gerne erfahren.
Matthias Schloßberger, M.A.
Universität Potsdam
Institut für Philosophie
Praktische Philosophie / Philosophische Anthropologie
Am Neuen Palais, Haus 11
D - 14469 Potsdam
Homepage
Copyright © by the author. All rights reserved.
This work may be copied for non-profit educational use if proper credit is given to the author and IASLonline.
For other permission, please contact IASLonline.
Diese Rezension wurde betreut von unserem Fachreferenten PD Dr. Alf Christophersen. Sie finden den Text auch angezeigt im Portal Lirez – Literaturwissenschaftliche Rezensionen.
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, ernst jünger, révolution conservatrice, stahlhelm, nationalisme révolutionnaire, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, république de weimar, weimar, nationalisme soldatique, national-bolchevisme, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Desde la muerte de Ernst Jünger en 1998 no ha transcurrido un solo año sin que saliese al mercado alemán alguna novedad perteneciente a su legado intelectual. Varios especialistas trabajan con ahínco en distintos ámbitos con el fin de publicar todos los escritos que puedan resultar de interés para la comprensión de un escritor tan polémico como longevo. Después de la publicación de varias correspondencias con distintas personalidades de su tiempo, esta vez le ha tocado el turno a sus artículos 'malditos' durante el periodo de Weimar, una publicación esperada, puesto que Ernst Jünger se negó a incluirlos en la edición de sus Obras completas en Klett-Cotta. Esta editorial, sin embargo, ha reunido todos los artículos políticos escritos entre 1919 y 1933, 145 en total, en un volumen separado, excelentemente comentado y anotado por el politólogo Sven Olaf Berggötz.
Ernst Jünger Sven Olaf Berggötz (editor) Klett-Cotta. Stuttgart, 2001 850 páginas. 98 marcos alemanes
Otro de los alicientes de este volumen es que por fin se ofrecen ordenados cronológicamente los artículos dispersos en varios periódicos o revistas como Arminius, Das Reich, Die Standarte, Der Widerstand o el Völkischer Beobachter, la mayoría de ellos, efímeros órganos de propaganda nacional-revolucionaria, que han servido como arsenal para atribuir a Jünger un claro papel de precursor del nacionalsocialismo o para hacer hincapié en su apología de la violencia. Y no se puede negar que muchos de estos artículos son dinamita, no sólo por su contenido, sino por un estilo fascinante que rompe las limitaciones del panfleto político; no resulta extraño que Jünger se convirtiese en el escritor más solicitado en ese tipo de publicaciones; su prosa limpia y acerada, pero al mismo tiempo de un radicalismo deslumbrante, encontró una entusiástica acogida en numerosos jóvenes, frustrados por la derrota y posterior humillación de Versalles. Tampoco olvidemos que a Jünger le rodeaba el nimbo de su condición de héroe de guerra, era el representante y el símbolo de una generación que lo había sacrificado todo y se creía traicionada por fuerzas oscuras de la retaguardia: la leyenda de la puñalada por la espalda que también Jünger asumió y difundió.
 En estos artículos, que muestran la obsesiva actividad proselitista del autor, no nos encontramos con el Jünger elogiado por Hermann Hesse o H. G. Gadamer, con el ensayista profundo, el novelista imaginativo o el observador preciso, sino con el agitador político que lanza sin ambages su mensaje subversivo. No obstante, en estos escritos también se puede comprobar cierta evolución temática e intelectual. En los primeros textos se ocupa principalmente de la experiencia guerrera, del valor del sacrificio y de la sangre como cemento de una nueva sociedad, a lo que se une un profundo odio a la burguesía y a la República de Weimar. Jünger consideraba que en su generación había surgido un nuevo 'tipo humano', forjado en la guerra de material y de trincheras, a quien, a su vez, correspondía forjar un nuevo mundo: 'Como somos los auténticos, verdaderos e implacables enemigos del burgués, nos divierte su descomposición. Pero nosotros no somos burgueses, somos hijos de guerras y de enfrentamientos civiles...'. Inspirándose en Nietzsche, Spengler y Sorel, y haciendo suyo el pathos del futurismo italiano, Jünger ensalza el odio y la destrucción como elementos creativos: 'La verdadera voluntad de lucha, sin embargo, el odio verdadero, se alegra de todo lo que destruye a su contrario. La destrucción es el único instrumento que parece adecuado en las actuales circunstancias'. En estos pasajes, el escritor adopta un nihilismo heroico que convierte la violencia en un fin en sí mismo, en una experiencia mística del combatiente que debe continuar su lucha en la sociedad civil. En ellos desarrolla una estética pura de la violencia que se mueve en un vacío ético y que, supuestamente, según el autor, debería generar nuevos valores.
En estos artículos, que muestran la obsesiva actividad proselitista del autor, no nos encontramos con el Jünger elogiado por Hermann Hesse o H. G. Gadamer, con el ensayista profundo, el novelista imaginativo o el observador preciso, sino con el agitador político que lanza sin ambages su mensaje subversivo. No obstante, en estos escritos también se puede comprobar cierta evolución temática e intelectual. En los primeros textos se ocupa principalmente de la experiencia guerrera, del valor del sacrificio y de la sangre como cemento de una nueva sociedad, a lo que se une un profundo odio a la burguesía y a la República de Weimar. Jünger consideraba que en su generación había surgido un nuevo 'tipo humano', forjado en la guerra de material y de trincheras, a quien, a su vez, correspondía forjar un nuevo mundo: 'Como somos los auténticos, verdaderos e implacables enemigos del burgués, nos divierte su descomposición. Pero nosotros no somos burgueses, somos hijos de guerras y de enfrentamientos civiles...'. Inspirándose en Nietzsche, Spengler y Sorel, y haciendo suyo el pathos del futurismo italiano, Jünger ensalza el odio y la destrucción como elementos creativos: 'La verdadera voluntad de lucha, sin embargo, el odio verdadero, se alegra de todo lo que destruye a su contrario. La destrucción es el único instrumento que parece adecuado en las actuales circunstancias'. En estos pasajes, el escritor adopta un nihilismo heroico que convierte la violencia en un fin en sí mismo, en una experiencia mística del combatiente que debe continuar su lucha en la sociedad civil. En ellos desarrolla una estética pura de la violencia que se mueve en un vacío ético y que, supuestamente, según el autor, debería generar nuevos valores.  En el terreno ideológico, los artículos reflejan una visión particular y nebulosa que no llega a identificarse con ninguna de las ideologías dominantes. Sus rasgos principales son, en su vertiente negativa, un profundo sentimiento antidemocrático y antipacifista, así como un fuerte rechazo de las instituciones, excluyendo al ejército como encarnación de la idea prusiana. Su odio a la República de Weimar es manifiesto; una República, si bien es cierto, que se ha definido con frecuencia como la 'democracia sin demócratas' y que era el blanco favorito del desprecio de la mayoría de los intelectuales. Aunque Jünger se confiesa nacionalista, en concreto 'nacionalista de la acción', no asocia el concepto con una forma política concreta, más bien se limita a describir vagamente modelos utópicos o retóricos que encontrarán un desarrollo más maduro en su libro El trabajador. Armin Mohler empleó el término 'revolución conservadora' para explicar esta posición política, pero Jünger también se acercó al nacionalismo de izquierdas de un Niekisch e incluso colaboró en su revista Der Widerstand, prohibida con posterioridad por los nacionalsocialistas. La impresión que recibimos es que Jünger estaba obsesionado con una revolución, viniese de donde viniese, siempre que fuese nacional. En sus escritos solía dirigirse a 'los nacionalistas, los soldados del frente y los trabajadores'. Este empeño revolucionario fue el que le acercó al nacionalsocialismo en los primeros años del movimiento: 'La verdadera revolución aún no se ha producido, pero se aproxima irresistiblemente. No es ninguna reacción, sino una revolución auténtica con todos sus rasgos y sus manifestaciones; su idea es la popular, afilada hasta un extremo desconocido; su bandera es la cruz gamada; su forma de expresión, la concentración de la voluntad en un único punto: la dictadura. Sustituirá la palabra por la acción, la tinta por la sangre, la frase por el sacrificio, la pluma por la espada'.
En el terreno ideológico, los artículos reflejan una visión particular y nebulosa que no llega a identificarse con ninguna de las ideologías dominantes. Sus rasgos principales son, en su vertiente negativa, un profundo sentimiento antidemocrático y antipacifista, así como un fuerte rechazo de las instituciones, excluyendo al ejército como encarnación de la idea prusiana. Su odio a la República de Weimar es manifiesto; una República, si bien es cierto, que se ha definido con frecuencia como la 'democracia sin demócratas' y que era el blanco favorito del desprecio de la mayoría de los intelectuales. Aunque Jünger se confiesa nacionalista, en concreto 'nacionalista de la acción', no asocia el concepto con una forma política concreta, más bien se limita a describir vagamente modelos utópicos o retóricos que encontrarán un desarrollo más maduro en su libro El trabajador. Armin Mohler empleó el término 'revolución conservadora' para explicar esta posición política, pero Jünger también se acercó al nacionalismo de izquierdas de un Niekisch e incluso colaboró en su revista Der Widerstand, prohibida con posterioridad por los nacionalsocialistas. La impresión que recibimos es que Jünger estaba obsesionado con una revolución, viniese de donde viniese, siempre que fuese nacional. En sus escritos solía dirigirse a 'los nacionalistas, los soldados del frente y los trabajadores'. Este empeño revolucionario fue el que le acercó al nacionalsocialismo en los primeros años del movimiento: 'La verdadera revolución aún no se ha producido, pero se aproxima irresistiblemente. No es ninguna reacción, sino una revolución auténtica con todos sus rasgos y sus manifestaciones; su idea es la popular, afilada hasta un extremo desconocido; su bandera es la cruz gamada; su forma de expresión, la concentración de la voluntad en un único punto: la dictadura. Sustituirá la palabra por la acción, la tinta por la sangre, la frase por el sacrificio, la pluma por la espada'.
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, première guerre mondiale, violence, guerre, militaria, histoire, allemagne, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Für den "Zeit"-Journalisten André Müller war es ein Lebenstraum, den Schriftsteller Ernst Jünger zu interviewen. Mindestens fünf Mal trafen sich die beiden zwischen 1989 und 1996, drei Gespräche wurden aufgezeichnet. Die Originaltranskripte verraten viel über das väterliche Verhältnis Jüngers zu Müller.
Am Tag vor Ernst Jüngers 100. Geburtstag im März 1995 notierte André Müller:
"Jünger ist ein ganz unanalytischer Mensch, naiv wie ein Kind, unfähig zur Auswahl von Wichtigem, alles notierend auf verzweifelter Suche, in der unbewussten Hoffnung, andere mögen ihn (der sich nicht kennt) finden."
Vermutlich hat er damit Recht. Der Ernst Jünger, den Müller erlebte, ist weit weg vom Weltkriegs-Haudegen der "Stahlgewitter" und dem demokratiefeindlichen Theoretiker des "Arbeiters". Müller entdeckt das Kind im alten Mann. Und der Andere, den er ihm unterstellt, um gefunden zu werden, das könnte dann er selbst, Müller, sein.
André Müller war berühmt für seine Interviews in der "Zeit", die er stets konfrontativ, ja mit einer gewissen Verachtung dem Gesprächspartner gegenüber anlegte. Eigentlich ging es dabei immer nur um ihn selbst und um seinen Nihilismus und um die verzweifelte Suche nach Wahrheit. Nur drei von all seinen zahlreichen Gesprächspartnern hat er wirklich geachtet: Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und eben Ernst Jünger, den er hartnäckig umwarb, bis er endlich einwilligte. Bei Jünger war es sogar ein Liebesverhältnis, und Müller zögerte nicht, es genau so nach Wilflingen zu schreiben und sich ganz zu offenbaren: "Herr Jünger, ich liebe sie." So gelang es ihm, das Vertrauen des Alten zu gewinnen, der für ihn zu einer Vaterfigur werden sollte.
Mindestens fünf Mal haben die beiden sich zwischen 1989 und 1996 getroffen. Drei dieser Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet, doch nur das erste, geführt am Tag vor dem Mauerfall, ist dann stark bearbeitet und gekürzt in der "Zeit" erschienen. Jetzt kann man es zusammen mit den beiden anderen, vom Tag nach der Währungsunion 1990 und von einem Wintertag 1993, in voller Länge als Originaltranskription nachlesen, mit allen Floskeln und Nichtigkeiten, die ein Gespräch ja auch ausmachen. Das ist gerade im Falle Ernst Jüngers wichtig, für den das Gespräch – neben dem Traum – eine offene, neugierige Annäherung an Einsichten gewesen ist.
Herausgeber Christophe Fricker hat diese Dokumente belassen wie sie sind und sich auf Anmerkungen und einleitende, sehr hilfreiche Erläuterungen beschränkt. Dazu bietet der Band den Briefwechsel der beiden Gesprächspartner, Postkarten, und Mitschnitte von Jüngers Anrufen auf Müllers Anrufbeantworter. Herausgekommen ist ein Buch, mit dem man Ernst Jünger tatsächlich – und das ist schon eine Sensation – nahekommen kann, weil er sich in seiner Empfindsamkeit zeigt. Nebenbei erfährt man auch etwas über seine Verhältnisse zu Frauen und davon, dass er im Wald beim Spazierengehen laut schrie.
"Gespräche über Schmerz, Tod und Verzweiflung" lautet der Untertitel. Das ist auch nicht falsch, und doch ist die Stimmung zumeist gelöst und heiter, es wird viel gelacht, Jüngers berüchtigtes, stakkatohaft-militärisches "Ha Ha!" durchzieht den Text wie ein grundierender Rhythmus. Müller berichtet, dass er, zunächst irritiert von diesem Lachen, mitzulachen versuchte, damit aber wiederum Jünger irritierte, weshalb er es dann unterließ. Der Tod jedenfalls, das ist bekannt, hat Jünger nicht geschreckt. Auch der Tod wurde von ihm als Freund begrüßt und mit einem Lachen quittiert. Komik entfalten die Gespräche auch deshalb, weil sich Müller sehr viel besser an viele Details aus Jüngers Leben zu erinnern scheint. Auf Ereignisse aus dem 1. Weltkrieg angesprochen, weiß Jünger nicht viel mehr zu sagen als: "Das ist lange her" oder "So, so, aha" oder "Wenn Sie das sagen" oder "Ha, ha." Die Gespräche produzieren bei aller Coolness, die beide zur Schau stellen, eine große Nähe und Wärme. Es ist tatsächlich eine Liebesgeschichte. Das macht dieses Buch zu einem berührenden Leseabenteuer.
Christophe Fricker (Hg.): Ernst Jünger – André Müller. Gespräche über Schmerz, Tod und Verzweiflung
Böhlau Verlag, Köln 2015
234 Seiten, 24,90 Euro
Kurz und Kritisch - Post von der Front
(Deutschlandradio Kultur, Lesart, 30.08.2014)
Erster Weltkrieg - Patchwork von Autorenstimmen
(Deutschlandradio Kultur, Buchkritik, 04.06.2014)
Erster Weltkrieg - Hunger auf Kampf und Abenteuer
(Deutschlandradio Kultur, Buchkritik, 02.04.2014)
Aus den Feuilletons - Ernst Jüngers sexuelle Eskapaden
(Deutschlandradio Kultur, Kulturpresseschau, 23.03.2014)
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com
A propos de la guerre, Ernst Jünger écrivait : "Oui, le soldat, dans son rapport à la mort, dans le sacrifice de sa propre personne pour une idée, ignore à peu près tout des philosophes et de leurs valeurs. Mais en lui, en ses actes, la vie trouve une expression plus poignante et plus profonde qu'il n'est possible en aucun livre. Et toujours, de tout le non-sens d'un processus extérieur parfaitement insensé, ressort une vérité rayonnante : la mort pour une conviction est l'achèvement suprême. Elle est proclamation, acte, accomplissement, foi, amour, espérance et but ; elle est, en ce monde imparfait, quelque chose de parfait, la perfection sans ambages. " Il y a un siècle, la Première Guerre mondiale inaugurait le combat moderne en même temps qu'elle propulsait sur des centaines de théâtres d'opération des millions de jeunes âmes volontaires ou contraintes de vivre leur guerre "comme expérience intérieure". Des hommes, tel Ernst Jünger, héraut de l'aristocratie guerrière allemande, René Quinton ou Joseph Darnand, frères d'armes français, naquirent pour la seconde fois sous la tempête des Orages d'acier. Mais combien d'hommes marqués à jamais par l'indicible effroi de l'expérience du combat ? Eux qui clamèrent plus volontiers, non la Guerre notre mère mais la Guerre notre mort. Le thème de la guerre figure parmi les plus explorés du cinéma. Excellente occasion de découvrir ou redécouvrir, sous de nombreux aspects, de brillantes réalisations abordant plus généralement la perception psychologique des conflits.

LES CHEMINS DANS LA NUIT
Titre original : Wege in der Nacht
Film allemand de Krzysztof Zanussi (1979)
1943, des soldats du Reich prennent possession d'une grande ferme polonaise. La chasse aux alentours est l'occupation favorite des officiers de la Wehrmacht, parmi lesquels deux universitaires, Friedrich et son cousin Hans-Albert. Friedrich se distingue de son cousin par sa passion pour l'art et la littérature. Il tombe bientôt amoureux d'Elzbieta, fille du baron propriétaire, qui est animée des mêmes goûts artistiques. Un amour nullement réciproque. Elzbieta juge Friedrich trop peu critique à l'égard de la barbarie de la guerre. Et patriote polonaise ardente, Elzbieta est bien décidée à utiliser l'amour de Friedrich pour aider l'action militaire des partisans polonais...
Pas tout à fait un film de guerre, la réalisation de Zanussi explore de manière admirable la collaboration par l'inaction. Si Friedrich n'est pas un national-socialiste convaincu, son inaction pour combattre le régime et son acceptation de la barbarie le transforment en complice actif. Et c'est toute la faiblesse morale du héros, présenté comme un personnage affable et sympathique mais obéissant aveugle à un régime qu'il ne cautionne pas, que souhaite mettre en exergue le réalisateur. Tourné en 1979, Zanussi, de nationalité polonaise, ne manque pas d'établir un parallèle fort avec l'intelligentsia polonaise, de même, complice du régime communiste par sa lâcheté. Le film, en outre servi par de brillants interprètes, est un petit bijou.

EMPIRE DU SOLEIL
Titre original : Empire of the Sun
Film américain de Steven Spielberg (1987)
Shanghai en 1941, la zone anglaise de la ville connaît un destin singulier quand le reste de la Chine est occupée par l'armée japonaise. James Graham est le jeune fils d'un riche industriel britannique et mène une adolescence insouciante. Mais James est bientôt rattrapé par la guerre. L'aviation japonaise vient d'attaquer Pearl Harbour scellant la déclaration de guerre nippone aux forces alliées. L'armée impériale envahit la Concession internationale de Shanghai. Séparé de sa famille, le jeune garçon erre et découvre la peur et la mort avant de se retrouver prisonnier dans un camp dans lequel il doit apprendre à survivre. Ses rêves de révolte et de guerre perdent leur sens. Aidé par le prisonnier Basile, James n'a d'autre possibilité pour évader son esprit que de transformer sa détention en aventure extraordinaire...
Si le talent de Spielberg est largement surestimé, le présent film constitue l'une de ses meilleures réalisations avec Rencontres du troisième type. Bien que non soldat, James est contraint de mener et vivre sa guerre sans fusil comme un parcours initiatique qui le révèlera et le conduira à l'âge adulte. L'image émouvante d'un antihéros qui se représente la guerre et la barbarie comme son nouveau terrain de jeu. Le film est une adaptation du récit semi-autobiographique de l'écrivain de science fiction James Graham Ballard. Une œuvre lyrique et envoutante.

LE FAUBOURG OKRAINA
Titre original : Okraina
Film russe de Boris Barnet (1933)
1er août 1914, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie tsariste. Un vent patriotique souffle dans tout le pays, aussi sur le faubourg d'une petite ville menacée par l'avancée des troupes du Kaiser. Gresin, le fabricant attitré de bottes pour l'armée est le plus fervent patriote et enjoint tous les hommes en âge de combattre du quartier à monter au front. L'ouvrier Nikolaj Kadin est mobilisé et rejoint par son frère Son'ka qui se porte volontaire. Ces modestes ouvriers et paysans vont bientôt découvrir les horreurs des tranchées et la gestion irresponsable d'officiers généreux en chair à canon. A l'arrière du front, l'effervescence patriotique cède la place à la contestation d'un conflit engraissant les marchands de canons. Les thèses bolchéviques trouvent un terreau favorable à leur éclosion...
Certes, il s'agit d'un film de propagande stalinienne qui ne fait guère l'économie d'un certain nombre de poncifs. C'est le lot des films de propagande après tout... Barnet livre néanmoins ici une vision douce-amère de la guerre, éloignée de la grandiloquence d'autres productions bolcheviques. L'autre particularité du film réside également en une présentation de la perception du conflit par l'ensemble des classes sociales, limitant un point de vue uniquement prolétaire. Bref, une réalisation assez iconoclaste au sein du monolithisme du cinéma soviétique. A voir !

FLANDRES
Film français de Bruno Dumont (2005)
De nos jours en Flandre, Demester doit quitter son exploitation agricole, accompagné d'autres jeunes Flamands, pour être propulsé sur un théâtre d'opération lointain. Demester menait jusqu'alors une vie pauvre et simple. Il aime secrètement Barbe, son amie d'enfance avec laquelle il partage de longues ballades. Il aime Barbe malgré ses mœurs libres et ses amants, parmi lesquels Blondel qui la séduit. Attendant le retour de Demester, Blondel et leurs compagnons, Barbe s'ennuie au village. Quant à Demester, de nature aussi taciturne et morose que l'était son ciel de Flandre, il fait face à la guerre avec une parfaite tenue au feu et se mue en véritable guerrier. Une guerre dont il ne sortira pas indemne psychologiquement...
Afrique du Nord ? Moyen Orient ? Rocailleux et écrasé par un lourd et brûlant soleil, le théâtre d'opération défini par Dumont est imaginaire et filmé avec un ton glacé. Le film n'épargne rien au spectateur plongé au cœur d'un voyage au bout de l'enfer. Une descente aux enfers qui se poursuit après le retour du champ de bataille et maintient le spectateur dans une position inconfortable sublimée par d'interminables moments de silence. Bruno Dumont ne cesse d'étonner et de confirmer l'étendue de son incroyable talent. A voir absolument !

LA HONTE
Titre original : Skammen
Film suédois d'Ingmar Bergman (1968)
Jan et Eva Rosenberg vivent reclus sur une île et vouent une passion inconditionnelle pour la musique dans un monde en proie à une guerre lointaine. Une panne de radio suivie d'autres incidents mineurs précipitent progressivement l'île dans le conflit. Les comportements de chacun se modifient radicalement. Jan se montre ainsi de plus en plus agressif envers Eva. Arrêtés tour à tour par les conquérants et les libérateurs, les amoureux sont relâchés sur ordre de leur ami, le colonel Jacobi. Eva s'offre au colonel bientôt fusillé sous leurs yeux. Les musiciens prennent la fuite en compagnie d'autres fugitifs en barque sur une mer jonchée de cadavres. Ils savent que, désormais, plus rien ne sera comme avant...
L'histoire de deux civils ordinaires plongés dans un conflit imaginaire aussi banal qu'insoutenable. Avec brio, le réalisateur démontre l'intrusion de la violence et les irréversibles bouleversements qu'elle engendre. Les deux individus sont littéralement pris au piège et otages d'un monde qui ne les concerne pas. Une anomalie dans la filmographie de Bergman qui parvient à montrer la guerre avec un indéniable talent conjugué à une parfaite psychologisation des protagonistes. Un chef d'œuvre !

LA LIGNE ROUGE
Titre original : The Thin Red Line
Film américain de Terence Malick (1998)
1942, la bataille de Guadalcanal fait rage dans le Pacifique. Le cadre paradisiaque est trompeur. Au milieu de tribus amérindiennes otages d'un conflit étranger, soldats américains et nippons se livrent une lutte sans merci, dont aucun combattant ne sortira indemne. Au sein de la Charlie Company, le fantassin Witt, accusé d'avoir déserté, bénéficie de la clémence du sergent Welsh. Le chemin menant à l'objectif, la colline 210 défendue par un solide bunker, semble interminable et la préparation d'artillerie semble bien mince. De nombreux soldats gisent déjà au sol. Les survivants sont assoiffés. Il n'y a plus d'intendance... Le capitaine Staros refuse de poursuivre l'assaut commandé par sa hiérarchie, estimant qu'il s'agit d'une mission-suicide. Après de longues heures d'attente, une patrouille de sept hommes est chargée d'effectuer la reconnaissance des abords de la colline 210. Le G.I. Witt en fait partie...
Witt et ses compagnons d'armes étaient de simples civils peu auparavant. Qu'a-t-il bien pu s'opérer pour qu'ils se muent en bêtes de guerre ? Malick livre ici une formidable réalisation sur le vécu d'une troupe et mêle très habilement l'alternance de scènes d'effroyables combats avec de longs plans sur la faune et la flore insulaires et le quotidien d'indifférentes tribus autochtones plongées, malgré elles, dans l'une des plus sordides boucheries. Autre habileté : l'utilisation de la voix off pour accentuer le caractère tragique de la guerre. A voir absolument!

SIGNES DE VIE
Titre original : Lebenszeichen
Film allemand de Werner Herzog (1967)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune soldat du Reich, Stroszek, est blessé et envoyé en convalescence dans un dépôt de munitions dont il assure la garde sur l'île de Crète. Loin du tumulte de la bataille et réduit à l'inaction, le soldat occupe le temps en s'astreignant à d'inutiles tâches qu'il juge nécessaires à son équilibre psychique. Le conscrit pourrait mener une vie paisible dans cette forteresse que nul ne menace, en compagnie d'une jeune femme grecque dont il fait son épouse et deux autres camarades. Mais face à l'interminable attente, Stroszek sombre progressivement dans la folie et devient dangereux pour son entourage...
Premier long-métrage du génial Werner Herzog. Et c'est une réussite ! Stroszek, symbole du combattant déchu de sa guerre, orphelin de sa mort, que ses gestes dérisoires pour se maintenir parmi les guerriers attirent vers la déraison. Quel contraste entre la violence d'une guerre et le pacifique calme solaire de cette île du Dodécanèse où le temps semble s'être arrêté ! Herzog filme magnifiquement la lente dégradation des rapports entre ces êtes que la guerre a oubliée. Une œuvre oppressante !
Virgile / C.N.C.
Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source
00:05 Publié dans Cinéma, Film, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerre comme expérience intérieure, ernst jünger, militaria, cinéma, films, 7ème art |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Dalla sua avventurosa vita – quasi come ricordi del ragazzino di famiglia scappato di casa per arruolarsi nella Legione Straniera – da lì, sono riemerse le tracce di ferite. Nelle screpolature della sua pelle di vecchissimo, come tracciati di radici profonde, per la marchiatura del tempo, sono sbucati dal buio dei ricordi i segni cavallereschi, le tacche sulla carne. Nessuno per esempio aveva notato sull’avambraccio un segno secco. Forse occultato dalla rigenerazione della vita quotidiana, ieri, la morte glielo ha ripescato: disteso lungo il suo percorso raggrinzito di corpo morto. Dei suoi capelli bagnati nell’acqua gelida del fiume, bianchissimi fili, la rigidità cadaverica ha catturato l’impercettibile alito, un elmo che è quasi un’aureola. Una foto in bianco e nero restituisce il taglio all’altezza delle orecchie, a nuca nuda, in parallelo con gli alettoni aerodinamici del cappottone d’ordinanza. Le linee telefoniche raccontano già della “mobilitazione totale“ del governo, dei potentissimi professori, degli “amici francesi“, che sul grande morto – innamorato come tutti i morti del ricordo di tutto ciò che è vita – stanno “approntando il memoriale“. Tedesco e “parigino“ a un tempo, della sua avventurosa vita, per tutti i centodue anni portati in faccia al mondo per lui sempre più estraneo, Ernst Jünger porterà sulla bara il fasto di un’esistenza eccezionale, dentro la bara invece, trascinerà “l’addio al mondo“. Era anche un dandy: “La volontà regna sul mondo diventato materiale dell’oggettivazione incondizionata”. È stato “sublime” (glielo diceva un altro dandy). Disse, un giorno, a fondamento del suo destino: “Meglio un delinquente che un borghese”. Sublime bacchettatore di Hitler, che pure era stato suo sodale segreto nella “società di Thule”, schizzinoso rispetto alla pietas del demos, al fondatore del Terzo Reich, rinfacciava sempre l’eccessivo democraticismo, l’insopportabile volgarità plebea delle “camicie brune”. Qualcuno commissionò l’eliminazione di Jünger, Hitler che candidamente lo riconosceva “come un superiore in gradi”, un “vero capo”, lo salvò dai sicari.
Nella sua essenza di testimone, nel suo essere stato passeggero dei battelli a vapore e del Concorde, nel suo essere stato tutto quel che Ernst Jünger è stato, hippy e notabile prussiano, entomologo e romanziere, arrivando adesso all’Oriente Eterno, chiuderà la sua estrema scommessa. Al cospetto dell’Onnipotente, certamente, da algido chirurgo del Nulla qual è, l’orologiaio del Nichilismo sta portando sulle sue spalle di grande morto, l’immagine a lui più profondamente vera, la sua forma, e dunque la divisa. Dell’habitus militare, Jünger ha offerto l’esempio assoluto. Scrittore, infaticabile diarista, interlocutore e protagonista in quell’officina di vampe che fu la Rivoluzione Conservatrice, Jünger non chiude solo un capitolo nella storia della letteratura, ma brucia con la sua morte l’ultimo modo possibile di essere “uomo d’arme”. Arrivando davanti a Dio, infatti, davanti al Dio lungamente cercato nelle sua passeggiate quotidiane nel piccolo cimitero del suo villaggio, la sua anima si specchia levigata nella ruvida stoffa grigioverde del soldato. È morto il soldato dunque, l’ultimo vero soldato planetario, erede di Ludovico Ariosto e di Ercole Saviniano Cirano de Bergerac. Innamorato del sogno cavalleresco, ad Alberto Moravia, in un’intervista-dialogo confidò: “Nella guerra nucleare i due giocatori faranno saltare in aria la scacchiera”, e non si capì bene se il cruccio nucleare fosse, per il vecchio Jünger, più un fastidioso ostacolo per la guerra o per la pace. Ritenuto a torto purificato nel dopoguerra, ma forse fortunatamente non troppo purificato, nelle lunghe passeggiate con Martin Heidegger e Carl Schmitt, dopo i primi quindici minuti di conversazione metafisica, arrivati a un altopiano, si lasciavano prendere la mano da altre curiosità, tipo: “Secondo voi, una mitragliatrice collocata qui, quale inclinazione di tiro potrebbe avere?”. Combattente volontario delle due guerre mondiali, di due sconfitte, della prima ne ricordava “di Londra, Parigi e Mosca, lo straordinario entusiasmo della gioventù, l’ebbrezza”, della seconda intuì da subito l’ambiguità: “O ci sarà una rivoluzione, o sarà una lunghissima guerra di trincea, come nel 1914-1918”. Nato a Heidelberg nel 1895, Ernst Jünger è stato decorato due volte con la Croce di Ferro, la più alta onorificenza a cui ogni galantuomo belligerante avrebbe potuto aspirare. La prima l’ebbe dalle mani dell’Imperatore, la seconda, invece, l’ha ricevuta dal suo maldestro allievo, per aver salvato dei dissennati che si erano spinti troppo avanti nella trincea nemica per scattare delle fotografie. Disse: “Fui comunque divertito dall’idea di ricevere la Croce di Ferro per la seconda volta”. Era anche un dandy.
Pietrangelo Buttafuoco
Il 17 febbraio di 17 anni fa moriva Ernst Jünger.
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, martin heidegger, révolution conservatrice, allemagne, philosophie, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Notes on Nihilism
By Greg Johnson
Ex: http://www.counter-currents.com
It is often said that nihilism is one of the leading characteristics of the modern age, but what is nihilism? Nihilism means something like the “death” of God, the denial of objective meaning and value, the erasure of moral distinctions and hierarchies, the dissolution of a common world into individual perspectives, and the dissolution of a common culture into subjective “given preferences.”
Nietzsche defines nihilism as the devaluation of the highest values, the core values, of a civilization. On that account, to understand nihilism we must, therefore, grasp: (1) the nature of values, (2) the role of values in life, (3) the nature of the claim that values make upon us, and (4) how it is possible for values to lose their claim upon us. I propose that we answer these questions through an examination of four thinkers: Giambattista Vico (1668–1744), Søren Kierkegaard (1813–1855), Friedrich Nietzsche (1844–1900), and Ernst Jünger (1895–1998).
Nietzsche on Life and Values
Nietzsche called the ultimate constituent of the world Will to Power. This is a highly anthropomorphized name for something that is neither a will (for there is no agent behind it that wills) nor is it “to power” (for it is not directed toward the goal of power, or any other goal). Will to Power is Nietzsche’s name for chaos, which he conceived of as a virtual infinity of points of force charging and discharging entirely without pattern or purpose.
Chaos somehow gives rise to life, life to consciousness, and consciousness to self-consciousness. Self-consciousness, however, presents a problem for life, because self-conscious beings demand reasons for continuing to live; they demand meaning and purpose in life. And this is a demand that chaos cannot meet. In a world of chaos, all options are equal. Nothing is any better or any worse than anything else. No option is preferable to any other. Choosing is not preferable to not choosing. Action, therefore, is fundamentally irrational. There is no reason to get out of bed in the morning. There is no reason to prefer continued existence to non-existence. Nothing matters. Nothing makes a difference. This is a condition so terrifying to self-conscious beings that they are annihilated when they encounter it directly.
Life, however, goes on. It preserves itself behind the back of consciousness by manufacturing values. These manufactured values are fictions which consciousness mistakenly thinks it discovers as objective facts. Fictional though they may be, values change everything. Once values are created, some things show up as better than others; some actions show up as better than others; some things show up as goals to be pursued; others show up as evils to be avoided. Life takes on meaning, purpose, and structure. Things begin to make a difference. One suddenly has a reason to get out of bed in the morning. Life can go on. The truth of chaos is a truth that kills. But the lie of values is a lie that we can live with. It is a necessary lie, a noble lie.
For Nietzsche, nihilism results when the core values of a culture cease being believed. There are two types of nihilism: passive and active. The passive nihilist deeply identifies with the core values of his civilization. Thus be experiences their loss as demoralizing and devitalizing. The active nihilist primarily experienced the reigning values as impediments to the freedom of his desires and imagination. Therefore, he experiences their downfall as liberating. For Nietzsche, the age of nihilism will be terminated by a particular kind of active nihilism: setting up and imposing new core values for a new civilization.
Vico & Cassirer
At this point, I wish to add an aside on the accounts of the origins of language, myth, and culture offered by Giambattista Vico (1668–1744) and Ernst Cassirer (1874–1945), for I think that these naturalistic accounts are broadly compatible with Nietzsche’s account of the origins of values and they supplement it nicely by describing the concrete embodiment of values in language, myth, and culture. Vico and Cassirer give essentially the same account of the origin of language and myth, for both hold that the first words were proper names of gods, and around these names grew up mythologies and languages which formed the cores of cultures.
 Vico offers a wonderful myth to illustrate the origins of language and myth. After the biblical flood, when the Earth was drying out and slowly re-populating, the sons and grandsons of Noah went back to nature, becoming very much like the Natural Man described in Rousseau’s Discourse on the Origins of Inequality. They lost all arts and sciences, organized families and communities, myth and religion, and even the use of language. And, because they also lost personal cleanliness and wallowed in their own urine and feces, Vico claimed—in accordance with an old wives’ tale then current in his hometown of Naples—they grew to a gigantic stature. Thus Vico offers us a picture of giants, devoid of language and culture, without families or cities, wandering alone in a vast forest that covered the drying Earth, occasionally bumping into one another and fornicating and then going their separate ways.
Vico offers a wonderful myth to illustrate the origins of language and myth. After the biblical flood, when the Earth was drying out and slowly re-populating, the sons and grandsons of Noah went back to nature, becoming very much like the Natural Man described in Rousseau’s Discourse on the Origins of Inequality. They lost all arts and sciences, organized families and communities, myth and religion, and even the use of language. And, because they also lost personal cleanliness and wallowed in their own urine and feces, Vico claimed—in accordance with an old wives’ tale then current in his hometown of Naples—they grew to a gigantic stature. Thus Vico offers us a picture of giants, devoid of language and culture, without families or cities, wandering alone in a vast forest that covered the drying Earth, occasionally bumping into one another and fornicating and then going their separate ways.
Eventually, though, evaporation from the drying Earth brewed up huge thunderstorms—thunderstorms greater than any seen before or since, thunderstorms that blanketed the entire Earth, and from the storm came a flash of lightning that lighted up the entire world and a mighty clap of thunder that shook it to its foundations, and the giants cried out in their terror a single word: “Jove.”
Jove was the first word. It is a proper name. And what it names is a terrifying force of nature. But when this force is named Jove and personified, something remarkable happens. The storm is no longer such a terrifying mystery. Rather, it is the product of a deity who has his reasons for sending it. The storm suddenly becomes intelligible. Furthermore, if we can discover the reasons behind the storm, then perhaps we can avoid riling Jove up. Or, if we can find his price, we can bribe him. Either way, we gain some control over our world. Myth and language, then, are man’s first attempts to master and understand an otherwise chaotic, inscrutable, and terrifying world.
But note that the origins of language and myth are pre-rational or irrational. They are not deliberately constructed, but spontaneous and automatic reactions to environmental stimuli. Nobody sat down and created languages and myths as conventions. Rather, the existence of conventions already presupposes the existence of a common language and a common community which can discuss and agree upon the adoption of certain conventions.
But if language and myth, culture and values are pre-rational fictions, then what kind of claim can they make upon us? What would motivate us to believe and follow them? What is the source of their authority and allure? For an answer to these questions, we turn to Kierkegaard.
Kierkegaard on the Claim of Values
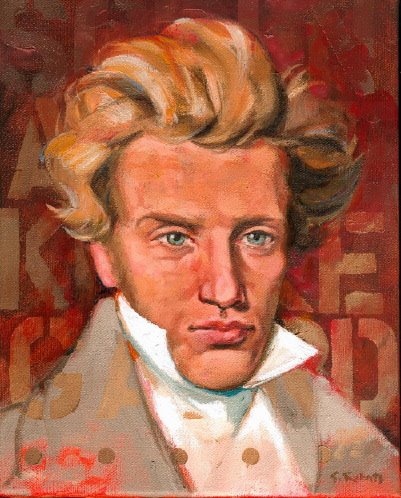 Søren Kierkegaard was the first self-proclaimed “existentialist.” Kierkegaard, like many skeptics and fideists, reverses the traditional philosophical valorization of theory over practice. Kierkegaard holds that it is practical, engaged activity, not disengaged theoretical reflection, that gives us access to the true and the good. We learn what is true and what is good through being socialized into a community and culture, and the process of socialization is primarily a practical matter.
Søren Kierkegaard was the first self-proclaimed “existentialist.” Kierkegaard, like many skeptics and fideists, reverses the traditional philosophical valorization of theory over practice. Kierkegaard holds that it is practical, engaged activity, not disengaged theoretical reflection, that gives us access to the true and the good. We learn what is true and what is good through being socialized into a community and culture, and the process of socialization is primarily a practical matter.
We learn by doing—by doing as others do around us, by imitating authoritative persons and following their commands. We learn what is true and what is good by apprenticeship in the concrete institutions and practices of a society, and the true and the good are accessible to us only so long as we participate in these concrete institutions and practices and recognize their authority.
In short, the primary locus of values is culture. The primary means of disseminating values is enculturation. And the authority of values derives from our pre-reflective, pre-rational identification with our culture and way of life.
Because values are disclosed through practice, not theory, their claim upon us is pre-rational. Therefore, the attempt to use reason to reflect upon, criticize, and perhaps give a foundation for our values, serves instead only to alienate us from them by weakening our pre-rational commitments to them.
In his 1846 work, The Present Age, Kierkegaard described how reason and reflection had undermined all authoritative institutions and practices of Western culture, thereby undermining commitment to its core values, leading to the collapse of moral distinctions, the flattening out of moral hierarchies, and the subjectivization of values. He prophesied the coming of a nihilistic age.
Kierkegaard’s question was how to regain a meaningful existence, how to save values from withering away from a sickly and effeminate rationalism, how to claw our way out of the quicksand of passive nihilism. Kierkegaard’s answer was simple: Each individual must make a conscious and absolute commitment to some form of life and its constitutive values. Once we make such a commitment, the world is no longer a matter of indifference to us; things again show up as good or bad, right or wrong—so long as we maintain our commitment unwaveringly. In short, for Kierkegaard the cure for passive nihilism is active nihilism—and the fact that Kierkegaard’s own commitment was to Christianity makes that commitment no less nihilistic.
Jünger on Technology and the Death of Values.
 Ernst Jünger is in essential agreement with Nietzsche on the origin and nature of values and with Kierkegaard on the nature and cure for nihilism, but he adds a significant new dimension to our understanding of the means by which nihilism comes to reign. It is an account that profoundly influenced Heidegger, and with which Heidegger was in essential agreement.
Ernst Jünger is in essential agreement with Nietzsche on the origin and nature of values and with Kierkegaard on the nature and cure for nihilism, but he adds a significant new dimension to our understanding of the means by which nihilism comes to reign. It is an account that profoundly influenced Heidegger, and with which Heidegger was in essential agreement.
The central concept of Jünger’s account of nihilism is technology. If values are fictions posited by life to sustain itself, and if values are encoded in and transmitted through concrete cultural institutions and practices, then one can see culture as a protective wall that we erect against the enervating terrors of a chaotic reality. For Jünger, modern technology is the Trojan Horse that leads us to open the gates of culture to the overwhelming forces of chaos.
Modern technological civilization is a form of culture. But it is a form of culture that undermines all other forms of culture—and also undermines itself as a culture—for the modern technological worldview is premised on the use of reason, science, and technology to progressively liberate mankind from all external and irrational impediments to the satisfaction of his desires.
While the ancients experienced nature as a fixed an eternal order founding and bounding the realm of human action, moderns experience nature as simply a pile of resources that are, in principle, infinitely transparent to human knowledge and infinitely malleable to human ends. From the technological point of view, there are no fixed boundaries to human action; there are only temporary impediments that will eventually yield, in time, to better science and better technology.
Unfortunately, however, the technological mentality regards values and their concrete cultural and institutional embodiments in religion, myth, and practice as such impediments. Values, after all, arise out of pre-rational or irrational sources. They are by necessity falsifications of reality. And they impose limitations on the technological satisfaction of our desires.
How many of us sigh and shake our heads bitterly when we hear of people refusing their children blood transfusions and vaccinations “merely” on religious grounds, merely in the name of something sacred? Technological civilization must, therefore, set itself at war with myth, religion, tradition, custom, values, and the kind of pre-rational attachments that, for instance, make us want to help our own children even though other people’s children might need our help more.
However, as we progressively bargain away more and more of the sacred and the moral for the benefits of technological culture, we also bargain away the sanctity and dignity of our own humanity; we find ourselves slowly transformed from sovereign subjects employing technology to satisfy our desires, into passive objects of technology.
For instance, we find that more and more of our desires are supplied by the imperatives of the very technological system that was designed to satisfy them. Once our activities are determined not by ideals and values, but by bodily desires—by our pre-cultural, naturalistic selves—the body, not the soul, becomes the subject, the driving agent, of the technological system.
But the body’s agency is illusory, for the body is—and always has been—primarily the object, not the subject, of technological manipulation. From makeup and fashion to piercing and tattooing, from diet and exercise regimens to plastic surgery to genetic engineering, the body is the object of technological manipulation, largely in response to imperatives generated by the technological system itself.
In our pursuit of freedom through the mastery of our environment, we soon discover that each one of us is an object in somebody else’s environment, and that the other side of mastery is domination. But it is a form of domination in which everybody is an object and nobody is a subject, i.e., it is domination without a dominator, domination by an impersonal technological machine that grew as an unintended consequence of individual actions, that was not consciously designed by anyone, and that cannot be consciously controlled by anyone.
Domination without a dominator is another way of speaking of will without a willer; it is another way of speaking of the Will to Power. The Will to Power is the very chaos that culture was supposed to protect us from. But technological culture, by undermining the pre-rational origins, necessary falsehoods, and constitutive values of culture, has brought the Will to Power into the heart of human world and installed it as our master.
The most chilling image of the triumph of the technological Will to Power are the “Borg” in Star Trek—The Next Generation. The Borg are humanoid creatures whose lives became so intertwined with technology—including technological implants in their own bodies—that they lost all individual consciousness and became almost literally mere cogs in their own machines They became objects, not subjects, of an autonomous technological system. And although this system had attained a collective consciousness of its own, which drowned out the individual consciousnesses of its humanoid components, the Borg collective mind is driven by a single imperative: to assimilate all other technologies and all other living beings into its technological system. Why? There is no ultimate end beyond the simple continuation of the process itself. The Borg assimilate only in order to continue to assimilate. The Will to Power wills only one thing: the continuation of its willing.
What is Jünger’s solution to technological nihilism? Jünger believed that the technological Will to Power is unstoppable, that it will subjugate the entire Earth and the entire universe, that nothing can stand in its way. Jünger’s experiences in the trenches of the First World War led him to believe that the war was an autonomous technological system, a human creation that quickly escaped the control of its creators and subjected them to the technological imperatives of its own continued existence. All moral and political motivations, all policy objectives, all means-ends rationality became moot, but the war went on; it carried itself on, simply for the sake of carrying on. Jünger became convinced that the only way to understand the phenomenon of total and autonomous war is to view it as an expression of the Will to Power, as its unstoppable volcanic eruption into the human world.
And, if you can’t beat it, join it. Jünger was convinced that the only way to salvage some meaning from the unfolding of technological nihilism was to submit oneself to it, to will the inevitable, and thus to internalize it and make it one’s own. In Battle as Inner Experience, he writes:
All goals are past, only movement is eternal, and it brings forth unceasingly magnificent and merciless spectacles. To sink into their lofty goallessness as into an artwork or as into the starry sky, that is granted only to the few. But he who experiences in this war only negation, only inherent suffering and not affirmation, [not] a higher movement, experiences it like a slave. He has no inner, but only an external experience.
Like Kierkegaard, Jünger holds that the solution to passive nihilism is active nihilism, which still leaves us within the realm of nihilism.
Heidegger
 Is there a fundamental alternative to nihilism? Is there an alternative to strong wills positing or negating values? Is there an alternative to weak wills receiving or losing the values imposed or negated by others? Is there an alternative to all this willing? For the root of nihilism is the will—specifically, the inflation of the will to the point that it becomes the defining trait of Being itself. Martin Heidegger’s philosophical project can be understood as an attempt to overcome nihilism at its root, the inflation of the will into the meaning of Being.
Is there a fundamental alternative to nihilism? Is there an alternative to strong wills positing or negating values? Is there an alternative to weak wills receiving or losing the values imposed or negated by others? Is there an alternative to all this willing? For the root of nihilism is the will—specifically, the inflation of the will to the point that it becomes the defining trait of Being itself. Martin Heidegger’s philosophical project can be understood as an attempt to overcome nihilism at its root, the inflation of the will into the meaning of Being.
Heidegger’s account of nihilism agrees with Nietzsche’s account of the origins and the nature of values, with Kierkegaard’s account of the cultural embodiment and transmission of values, with Kierkegaard’s account of the role of reason in the undermining of commitment, and with Jünger’s account of technology as the Trojan Horse that allows the Will to Power to invade and conquer the human world. But Heidegger does not agree with their solutions, which all boil down to replacing passive nihilism with active nihilism. For active nihilism is still nihilism.
Overcoming nihilism, however, is no simple task. For Heidegger traces the metaphysics of the will back to the origins of Western metaphysics. Thus to overcome nihilism, we must overcome metaphysics. But Heidegger does not see the metaphysical tradition as merely a record of human errors, but as the product of Being’s self-concealment. Thus trying to overcome nihilism, or trying to overcome metaphysics—as if they are merely human errors that can be corrected by human means—is itself essentially nihilistic. We may only be done with nihilism when we accept the possibility that nihilism may not yet be done with us.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2015/02/notes-on-nihilism/
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, kirkegaard, vico, cassirer, ernst jünger, heidegger, nihilisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

di Valerio Alberto Menga
Ex: http://www.lintellettualedissidente.it
“Meglio morire come una meteora effervescente che spegnersi tremolando”.
E. Jünger
In occasione del centenario della Prima guerra mondiale tante sono state le pubblicazioni in memoria del grande e catastrofico evento. Si segnalano, di passata, per la saggistica Mondadori e Laterza, i saggi dello storico Emilio Gentile L’Apocalisse della Modernità e Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Due titoli straordinari per l’efficacia che ha avuto l’autore nell’interpretare il primo confilitto mondale e la sproporzione delle conseguenze seguite all’attentato di Sarajevo del 1914. A distanza di 92 anni dalla sua originaria apparizione, e per la prima volta in italiano, è stato pubblicato per le edizioni Piano B (e magistralmente tradotto da Simone Butazzi, che si ringrazia) quella che era stata, a torto, considerata un’opera minore nella bibliografia di Enrst Jünger: La battaglia come esperienza interiore.
Fu un’innovazione quella che portò Jünger alla letteratura di guerra. Embelatici erano, e rimangono tutt’ora, Il fuoco di Barbusse e Niente di nuovo sul fronte occientale di Remarque. Questi due autori furono le due principali voci di un atteggiamento di sconforto, di orrore, di paura, di delusione, e di disfattismo davanti alla guerra. Lo stesso atteggiamento che portò Louis-Ferdinand Céline, volontario nell’esercito francese, a riflessioni come quelle che compaiono nel suo Viaggio al termine della notte: “Per quanto lontano cercassi nella memoria, gli avevo fatto niente io, ai tedeschi. Ero sempre stato molto gentile ed educato con loro. Li conoscevo un po’ i tedeschi, ero persino stato a scuola da loro, quando ero piccolo, dalle parti di Hannover. Avevo parlato la loro lingua. Allora erano una massa di cretinetti caciaroni con occhi pallidi e furtivi come quelli dei lupi […] ma da lì adesso a tirarci nella colombarda, senza neanche venire a parlarci prima e nel bel mezzo della strada, ce ne correva parecchio, un abisso. Troppa differenza. La guerra insomma era tutto quello che non si capiva”. Jünger invece – come giustamente sottolinea Rodolfo Sideri nel suo Inquieto Novecento- è interprete di un atteggiamento “volto a lasciare che la guerra tempri l’uomo nella sua dimensione interiore”.
Ma che cosa è stato esattamente Ernst Jünger? Qual è la sua maggiore peculiarità? E’ stato uno scrittore? Un soldato? Un filosofo? Nacque in Germania, ad Heidelberg, nel 1895. E morì nel 1998 a Riedlingen, avendo sorpassato la soglia dei cento anni, dopo aver visto morire il fratello, i figli e la prima moglie. Per la lunga durata della sua vita fu indubbiamente il prezioso testimone di un’epoca. È stato anche un entomologo. Non deve certo stupire se un grande carattere del Novecento come lui si sia interessato allo studio e alla collezione di scarafaggi e scarabei. Ai suoi occhi guerrieri, essi apparivano un po’ come animali con una corazza naturale che, talvolta, riflettono i colori della guerra: il rosso e il grigio. Piccoli soldati di Madre Natura.

Il rosso e il grigio, quindi. Ecco i colori che attraverso lo sguardo del grande scrittore tedesco hanno determinato la Grande Guerra. E Le rouge et le gris –in onore a Stendhal- doveva essere il titolo originale del grande diario di guerra Nelle tempeste d’acciaio che gli valse, di diritto, un posto nel pantheon dei grandi scrittori europei del Novecento. Tuttavia optò per il secondo titolo, ispirato ad una poesia islandese, che meglio definiva “l’eternità tombale” della vita in trincea durante la guerra. Rosso come il sangue; grigio come le divise dei soldati, come l’acciaio delle armi e dei proiettili, come l’umore in trincea, come la terra devastata dai colpi, come il cielo oscurato dalla battaglia.
Incuriosisce il fatto che La battaglia come esperienza interiore era stato concepito dall’autore come un’opera che avrebbe dovuto fare da pendant al precedente Nelle tempeste d’acciaio, il cui punto di vista si riferiva agli avvenimenti puri e semplici. In quest’opera, invece, si può trovare tutto ciò che nelle “Tempeste” si era cercato invano.
Nelle tempeste d’acciaio ha il merito di descrivere nel titolo, e in due parole, la guerra di trincea. Interpreta il primo conflitto mondiale in chiave nichilistica (come “lotta dei materiali”), osservando la realtà con sguardo oggettivo. Il difetto maggiore che però la caratterizza è la mancanza dello spazio concesso alle emozioni e al sentimento. La battaglia come esperienza interiore colma questo vuoto. E può annoverarsi senza dubbio tra le grandi opere di Jünger, grazie alla sua prosa alta e inarrivabile.Prima di aprire questo libro bisogna preparare il lettore ad entrare psicologicamente in trincea. Bisogna essere pronti a ricevere lo schizzo del sangue nemico dritto in faccia. Se invece siete tra coloro che non sopportano di guardare la realtà negli occhi, allora lasciate in pace questo libro.
 “La battaglia rientra nelle grandi passioni. [...] E’ un canto antico e tremendo, che risale all’alba dell’uomo: nessuno avrebbe mai pensato che fosse ancora così vivo in noi”. In questo scritto di guerra non manca nulla: il sangue, l’orrore, la trincea, l’eros, il coraggio, il fuoco, la paura… Questo per dare un’idea di ciò che aspetta il lettore che abbia il coraggio e la maturità di affrontare quest’opera rovente, che di certo non poteva non piacere ad un giovane nazional-socialista dei tempi. Perché Jünger è stato considerato, e forse è considerato ancora, un nazista. E’ vero che Hitler disse “Jünger non si tocca!” e lo protesse per ben due volte dalle grinfie di Göring che voleva la sua testa. Ma furono il rispetto per il soldato e lo scrittore di guerra che, con tutta probabilità, spinsero il Führer a perdonare a Jünger il suo comportamento. Ci si riferisce al suo antinazismo allegorico, aleggiante nel romanzo Sulle scogliere di marmo, e alla sua parte nella congiura capitanata da Stauffenberg che sfumò nel fallito attentato a Hitler, ben narrato nel film di Bryan Singer Operazione Valchiria. Scrisse un romanzo antinazista e partecipò all’attentato a Hitler, che mirava ad ucciderlo. Anche se in lui l’idea dell’uccisione del tiranno era indicice di mentalità rozza. Queste due cose stanno ben a sottolineare il fantomatico nazismo di cui fu accusato. Ma agli occhi stanchi e superficiali dei molti faciloni, è apparso così per molto tempo. È vero invece che i nazisti trassero, a piene mani, buona parte della loro cultura da alcuni scritti del grande soldato tedesco. Solo in seguito al premio Goethe, ottenuto nell’82, venne riabilitato ufficialmente come scrittore.
“La battaglia rientra nelle grandi passioni. [...] E’ un canto antico e tremendo, che risale all’alba dell’uomo: nessuno avrebbe mai pensato che fosse ancora così vivo in noi”. In questo scritto di guerra non manca nulla: il sangue, l’orrore, la trincea, l’eros, il coraggio, il fuoco, la paura… Questo per dare un’idea di ciò che aspetta il lettore che abbia il coraggio e la maturità di affrontare quest’opera rovente, che di certo non poteva non piacere ad un giovane nazional-socialista dei tempi. Perché Jünger è stato considerato, e forse è considerato ancora, un nazista. E’ vero che Hitler disse “Jünger non si tocca!” e lo protesse per ben due volte dalle grinfie di Göring che voleva la sua testa. Ma furono il rispetto per il soldato e lo scrittore di guerra che, con tutta probabilità, spinsero il Führer a perdonare a Jünger il suo comportamento. Ci si riferisce al suo antinazismo allegorico, aleggiante nel romanzo Sulle scogliere di marmo, e alla sua parte nella congiura capitanata da Stauffenberg che sfumò nel fallito attentato a Hitler, ben narrato nel film di Bryan Singer Operazione Valchiria. Scrisse un romanzo antinazista e partecipò all’attentato a Hitler, che mirava ad ucciderlo. Anche se in lui l’idea dell’uccisione del tiranno era indicice di mentalità rozza. Queste due cose stanno ben a sottolineare il fantomatico nazismo di cui fu accusato. Ma agli occhi stanchi e superficiali dei molti faciloni, è apparso così per molto tempo. È vero invece che i nazisti trassero, a piene mani, buona parte della loro cultura da alcuni scritti del grande soldato tedesco. Solo in seguito al premio Goethe, ottenuto nell’82, venne riabilitato ufficialmente come scrittore.
Davanti ad un uomo come lui è difficile dire se sia l’opera a superare la grandezza della vita dell’autore o viceversa. Jünger visse più di cento anni, giovanissimo si arruolò nella Legione Straniera per andare a combattere, per poi essere ripescato e rimpatriato dal padre. Fu un eroe decorato con la medaglia Pour le mérite dopo esser stato ferito quattordici volte nella Grande Guerra; vide due volte la cometa Halley (cha ha un ciclo di 76 anni); fu amico di Martin Heidegger e Carl Schmitt, e con essi scrisse alcune opere. Ha incontrato molti grandi del suo tempo, e in tutta la sua opera ha analizzato e affrontato il nichilismo, che è il tratto peculiare del suo e del nostro tempo. Da entomologo ha scoperto due nuove specie di coleotteri che oggi portano il suo nome: il Carabus saphyrinus juengeri e la Cicindera juengeri juengerorum. Da scrittore, invece, ha incantato il mondo e continua ad incantare, ad accendere le passioni e il pensiero.
La battaglia come esperienza interiore è un’opera scritta da un giovane inquieto che vuole conciliare il pensiero con l’azione. Qui vi si ritrova uno Jünger intriso di letture nietzscheane che, con la sua prosa alta e viscerale, scava nel profondo dei più indicibili sentimenti che hanno portato l’uomo moderno a scontrarsi, a riversare la propria Volontà di potenza nel campo di battaglia. Per il lettore che ama sottolineare i tratti più salienti, quest’opera, strage di carne e materia, sarà anche una strage di grafite. E si spera che, quindi, chi leggerà queste righe, perdonerà a chi scrive se si è fatto ampio uso di doverose citazioni. Lo stile dello scrittore-soldato porta lo spirito del lettore a vette così alte che il ritorno alla terra scavata dalle trincee è un vero e proprio schianto del cuore. Sconquassa l’anima del lettore, lo cattura con la sua scrittura; lo tiene inchiodato al libro pagina dopo pagina, in una stretta mortale dalla quale non potrà districarsi facilmente. Questo è un libro per anime in tempesta, per cuori d’acciaio, scritto con il sangue degli eroi.
Solitario tra i solitari, Jünger mostra il volto del gelido vento della morte, riscaldato dall’alito di fuoco di quella fornace che è la guerra. La figura romantica del soldato Jünger che legge l’Orlando furioso piegato sulle ginocchia, in trincea, rende bene l’idea del sentimento che lo portò ad arruolarsi volontario in guerra. L’odio per la comoda vita borghese è ben descritto in queste righe: “Ogni senso di reputazione borghese era rimasto indietro, a distanze siderali. Cos’era la buona salute? Utile, semmai, a persone che contano di vivere a lungo”. Nota è ormai la massima jungeriana per cui è meglio essere un delinquente che essere un borghese. Un giovane inquieto come lui, in Italia, in seguito dirà che “Borghese è colui che sta bene ed è vile” (Benito Mussolini). Questo libro breve ma intenso potrebbe essere preso a ragione come il Manifesto degli interventisti o dei militaristi. Per l’autore è la guerra a fare gli uomini, essa è “madre di tutte le cose”, siamo noi a modellare il mondo, non il contrario. La guerra, aggiunge, non è solo nostra madre, ma anche nostra figlia. L’abbiamo cresciuta così come ha fatto con noi. “Noi siamo fabbri e acciaio sfavillante allo stesso tempo, martiri di noi stessi spinti da intime pulsioni[...] La guerra è umana quanto l’istinto sessuale: è legge di natura, perciò non ci sottrarremo mal al suo fascino. Non possiamo negarla, altrimenti finiremo divorati.”
Qui di seguito ecco alcuni passaggi che meglio sottolineano le ragioni e le passioni che portarono Jünger, come altri uomini, a provare loro stessi sul campo di battaglia, in quel particolare frangente della Storia. Molte erano le aspettative di coloro che si arruolarono volontari negli eserciti delle grandi nazioni europee: “La guerra è una grande scuola, e l’uomo nuovo apparterrà alla nostra schiatta”. E poi, scriverà: “Il punto di cristallizzazione pareva raggiunto, il superuomo in procinto di arrivare[...] Tutto questo sembrò chiaro quando la guerra lacerò la compagine europea”. Queste le parole dello Jünger soldato, filosofo e scrittore. Egli incarna le pulsioni e i turbamenti dell’uomo del Novecento che si affaccia con volto risoluto alla Modernità. E si scontra. Se il Novecento è stato il grande secolo delle ideologie e della politica, così come dei grandi conflitti, vale allora la formula di Clausewitz per cui la guerra è la semplice continuazione della politica con altri mezzi, che nasce in seguito alla “frizione”. Arriva, cioè, laddove la diplomazia non è riuscita. E per gli appassionati della polemologia questa è una lettura consigliata. Molte le passioni e i sentimenti che scaturiscono in queste pagine, ma vi è anche spazio per la riflessione. Un giusto equilibrio tra ragione e sentimento.

“Ognuno può rapportarsi alla guerra come vuole, ma non la può negare. Quindi io m’impegno, in questo libro nel quale mi voglio rassegnare alla guerra, a osservarla come qualcosa che è stato ed è ancora in noi, a privarla di ogni preconcetto e a descriverla per quello che è.” E poi ancora: “La guerra è il più potente incontro tra i popoli. Mentre nel commercio e per le trattative, nelle gare sportive e ai congressi si muovono solo le personalità di punta, in guerra l’intera squadra conosce un solo obiettivo: il nemico”. Non è possibile la guerra senza l’uomo. Né l’uomo senza la guerra. Questa assumerà di volta in volta il volto e il nome che l’occasione le suggerirà: battaglia, lotta, lo scontro, frizione, incidente diplomatico…
Il coraggio è un sentimento, fulcro della guerra per Jünger: “Un soldato senza coraggio è come un Cristo senza fede. Ecco perché in un esercito il coraggio deve essere quanto di più sacro”. Nelle “Tempeste d’acciaio” si leggono parole di riconoscimento del valore e del rispetto del nemico: “Durante la guerra mi sforzai sempre di considerare l’avversario senza odio, di apprezzarlo secondo la misura del suo coraggio. In battaglia cercai di individuarlo per ucciderlo, senza attendere da lui cosa diversa”. Nessun odio verso i nemici. I Francesi? “Sono dei gran viveurs, loro. Gente gradevole, davvero. Io non li odio mica.” E poi: “Chi saremmo noi senza questi vicini audaci e senza scrupoli che ogni cinquant’anni ci puliscono la ruggine dalle lame?”.
Al nemico viene riconosciuto il valore del suo coraggio. E ne La battaglia come esperienza interiore scrive: “I cuori coraggiosi riconoscono istintivamente la vera grandezza. Il coraggio riconosce il coraggio”. Ecco una delle sue massime maggiori: “Il mondo potrà anche ribaltarsi, ma un cuore coraggioso sarà sempre saldo”. L’uomo di Heidelberg è figlio della guerra, figlio ed interprete acuto del suo tempo. Lui è l’uomo nato dalla guerra, nella guerra e per la guerra. Lui, cuore coraggioso, anima in tempesta. Come egli stesso sottolinea, lo spirito di un’epoca si concentra sempre in pochi individui solitari. In questo libro si può carpire lo spirito guerriero che forgiò l’Uomo nuovo della Grande Guerra. E lui è uno di quegli individui solitari, voce di un’epoca in radicale mutamento. Importante è anche il rapporto con la Donna, nelle opere di guerra di Jünger. In un altro scritto dello stesso genere, intitolato Il tenente Sturm, la donna viene definita dall’autore come “ministra del grande mistero”. E la donna non ama la guerra, ma ama i guerrieri. Curzio Malaparte disse: “Amo la guerra perché sono un uomo”. E Jünger coerentemente afferma: ” Esiste un solo punto di vista per contemplare il fulcro della guerra, ed è quello mascolino”. In uno dei capitoli più belli della Battaglia viene affrontato il rapporto uomo/donna guerra, ed in merito a ciò sottolinea: “Bisognava che anche le donne fossero d’acciaio, per non finire schiacciate nel tumulto”. Il racconto che invece viene accennato, con infinita poesia, nel capitolo Eros, riporta alla memoria l’immagine di uno studente tedesco (in cui possiamo facilmente riconoscere il giovane Ernst) e una contadina piccarda che fanno l’amore nel bel mezzo della guerra, nell’imperversare della tempesta, essi, “centrifugati su una scogliera bellica”, sono “due cuori accesi in un mondo ghiacciato”. E con queste immagini e magnifiche parole conclude il capitolo: “Due labbra accarezzavano l’orecchio dell’uomo, impegnate più che mai a versarvi tutta la melodia di una lingua straniera[...] Poi finivi sotto la grandine dei proiettili con i baci ancora tra i capelli. La morte ti veniva incontro come un’amica. Tu, chicco di grano maturo che cadi sotto la falce”. Questo è Jünger.
Per il grande scrittore di Heidelberg sembra valere il precetto di Julius Evola per cui “la patria è là dove si combatte”. E la guerra è una donna da possedere, almeno finché infuria la battaglia. L’uomo, la guerra e la donna: fili intrecciati di un inestricabile destino, di un ciclo infinito: Vita Amore e Morte. Oggi gli animi dei molti pacifisti che popolano il mondo postmoderno irriderebbero il romanticismo di cui talvolta sono impregnati gli scritti di guerra. Non potrebbero però evitare di rimanere colpiti e affascinati dallo stile di uno scrittore immenso come quello che oggi si è voluto ricordare.

Si vuol concludere ora con due stralci tratti, rispettivamente, dalle opere Il tenente Sturm e con la conclusione de La battaglia come esperienza interiore che spiegano bene la complessità della guerra nel pensiero di Enrst Jünger: “Laggiù una stirpe nuova dava vita a una nuova interpretazione del mondo, passando attraverso un’esperienza antichissima. La guerra era una nebbia originaria di possibilità psichiche, carica di sviluppi; chi tra i suoi effetti riconosceva solo l’elemento rozzo, barbarico coglieva, di un complesso gigantesco, un solo attributo, con l’identico arbitrio ideologico di chi vedeva soltanto il carattere eroico e patriottico”.
“Ma chi in questa guerra vede solo negazione e sofferenza e non l’affermazione, il massimo dinamismo, allora avrà vissuto da schiavo. Costui avrà avuto solo un’esperienza esteriore, non un’esperienza interiore.”
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, première guerre mondiale, allemagne, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La guerre est synonyme de souffrance et de désolation et les hommes de 14 sont les victimes de la barbarie moderne. Cent ans ont passé depuis le début de la Grande Guerre et cette opinion est aujourd’hui largement partagée ; elle anime l’esprit des discours et les cérémonies de commémoration. En Allemagne comme en France, Ernst Jünger incarne tout ce que notre Europe moderne et pacifiée ne souhaite plus voir et rejette, tout ce qu’elle a en horreur : un soldat, incarnation de cette culture martiale européenne aujourd’hui disparue, un guerrier devenu écrivain dont une grande partie de l’œuvre puise son inspiration dans les quatre années passées dans la boue et la fureur des tranchées du nord de la France.
L’œuvre de Jünger est vaste ; elle parcourt le XXème siècle, ses tourments et ses drames. Elle interroge sur les forces nihilistes à l’œuvre chez l’homme et dont l’écrivain ressentit le caractère destructeur au plus profond de sa chair, lui le guerrier blessé quatorze fois au front. Après quatre années de guerre, il est l’officier le plus décoré de l’armée allemande. Dans son premier livre, Orages d’acier, écrit dès son retour à la vie civile, il relate cette expérience inouïe de l’homme plongé au cœur de masses destructrices. À sa lecture, on s’immerge dans ce quotidien des tranchées, où alternent morne routine et actes de guerre effarants. La description des combats est précise, sans état d’âme, dépassionnée et parfois, presque esthétisante. Loin du pacifisme d’Erich Maria Remarque dans À l’ouest, rien de nouveau, l’auteur semble vivre cette guerre comme une opportunité unique de vivre ses rêves de gloire et d’aventure, forgé par une enfance bercée de héros mythologiques grecs et germaniques. Face à la fureur du feu, Jünger pour ne pas subir son destin, livré aux hasards de la guerre moderne, décide d’en devenir le maître. Par instinct de survie, pour ne pas être tué, il décide de devenir, lui même, un tueur, mais cette mort, il la veut sans haine, dans le respect de l’adversaire.
À l’heure du pacifisme béat contemporain, les soldats de la Grande Guerre sont aujourd’hui considérés comme les tristes victimes de l’histoire et du nationalisme ; des pantins craintifs envoyés à l’abattoir par des généraux ivres de sang et par des nations avides de guerre. L’expérience militaire de Jünger nous offre une vision en miroir contraire. Il y apparaît maître de son destin, attaché à la noblesse du soldat, fier du combat qu’il mène avec un cœur irrigué par un patriotisme ardent. Malgré ses horreurs, la guerre devient à ses yeux l’aventure épique au sein de laquelle l’homme peut découvrir une voie vers l’élévation, et non pas seulement une mort abjecte dénuée de sens. La guerre devient alors une expérience intérieure presque mystique, et ce, malgré l’effondrement de la conscience qu’elle engendre au cœur des combats : « La grande bataille marqua aussi un tournant dans ma vie intérieure, et non pas seulement parce que désormais je tins notre défaite pour possible. La formidable concentration des forces, à l’heure du destin où s’engageait la lutte pour un lointain avenir, et le déchaînement qui la suivait de façon si surprenante, si écrasante, m’avaient conduit pour la première fois jusqu’aux abîmes de forces étrangères, supérieures à l’individu. C’était autre chose que mes expériences précédentes ; c’était une initiation, qui n’ouvrait pas seulement les repaires brûlants de l’épouvante. »
Jünger est à la fois horrifié et fasciné par cette guerre sans nulle autre pareille alors, mais son abjection lui apparaît comme un des reflets de l’âme humaine. Il prend conscience d’être à la charnière de deux mondes, de vivre un point de non-retour. « On ressentait (…) l’inéluctable engloutissement d’une civilisation, et l’on prenait conscience en frissonnant d’être entraîné dans le maelstrom. » Le monde bourgeois qu’il a connu jusqu’alors vole en éclats et son tempérament l’amène à vouloir œuvrer à l’élaboration du nouveau monde qui va le remplacer. Cette guerre devient la matrice de ce siècle encore neuf où, malgré le chaos ambiant, l’avenir est à conquérir et une nouvelle société à construire.
D’une guerre à l’autre
Il sort de cette guerre en héros, couvert de gloire dans une Allemagne affligée par la honte d’une défaite incomprise. Le jeune officier, qu’il est alors, devient alors une des nombreuses figures de la révolution conservatrice ; ce mouvement intellectuel né dans le foisonnement culturel de la République de Weimar axé sur une critique de la modernité, un rejet du système démocratique assorti d’une franche hostilité à la société capitaliste et à certaines de ses manifestations comme l’urbanisation, l’industrialisation, le matérialisme et la perte de spiritualité. On peut voir dans ce mouvement un terreau intellectuel au fascisme, qui en partage certaines valeurs, même si la plupart de ses figures éminentes se démarqueront du mouvement nazi.
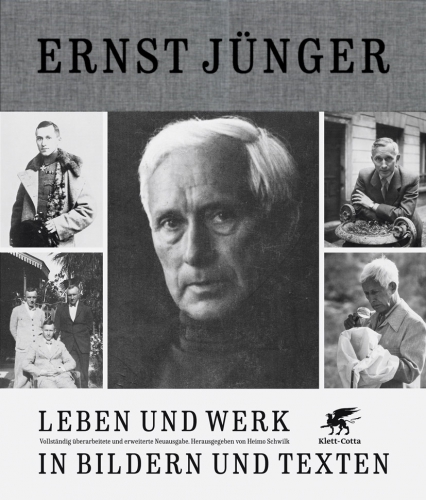
Ainsi, la submersion hitlérienne ne suscite pas l’adhésion de ce patriote réfractaire à toutes formes d’idéologie. Il exècre en effet l’amoralité, la vulgarité et l’antisémitisme du régime nazi et entre alors dans une opposition passive : cette émigration intérieure théorisée par Franck Thiess. Hitler développe pourtant quant à lui une fascination pour Jünger, incarnation superbe du guerrier germanique fantasmé par la plupart des hiérarques du nouveau régime.
Fort de cette admiration qui le protège face à la Gestapo et la censure, il se permet l’audace de publier en 1939 Sur les falaises de marbre, un roman allégorique mettant en scène un monde imaginaire paisible et raffiné, submergé par le Grand Forestier, incarnation du mal brisant un monde d’harmonie. On y perçoit alors une condamnation du totalitarisme hitlérien. L’ouvrage devient alors un pamphlet antinazi pour de nombreux Européens même si ce livre présente une dimension intemporelle comme le souligne Julien Gracq : « Livre de tous les temps de catastrophe possible et passée. »
La guerre n’en a cependant pas fini avec lui. L’Europe s’embrase à nouveau et le contraint à revêtir l’uniforme pour une nouvelle guerre et pour un homme auquel il ne croit pas. Il est incorporé au sein des troupes d’occupation basées à Paris où il fréquente l’élite intellectuelle française. Le héros des tranchées exècre ce nouveau conflit et pense même à la désertion ou au suicide. Cette guerre ne lui apparaît plus comme source de gloire mais comme une tache qui ternit l’uniforme allemand d’une teinte de honte. Entre le jeune soldat avide de gloire de la Grande Guerre et l’officier mûr et assagi, stationné à Paris en 1940, le temps a modifié le regard. Il écrit alors : « le même uniforme, le même grade, mais un homme différent. »
La guerre comme élément naturel
Après 1945, son œuvre devient sinueuse et prolifique. Il théorise alors des concepts développés déjà avant-guerre. Il devient ainsi le théoricien d’une forme d’anarchisme propre à sa vision du monde. Jünger se passionne également pour l’entomologie et développe une pensée écologiste d’avant-garde mais loin d’entrer en contradiction avec sa pensée belliciste, celle-ci au contraire l’y conforte. Pour lui, la guerre s’inscrit entièrement dans l’ordre naturel, elle est gravée dans les gènes de l’humanité. C’est une utopie de s’y opposer car elle s’inscrit dans l’équilibre du monde : « La guerre n’est pas instituée par l’homme, pas plus que l’instinct sexuel ; elle est la loi de la nature. C’est pourquoi nous ne pourrons jamais nous soustraire à son empire. Nous ne saurions la nier sous peine d’être englouti par elle. »
Jünger traverse ce XXème siècle et atteint l’âge canonique de 102 ans pour s’éteindre après la réunification des deux Allemagne en 1998. Peu avant sa mort, l’homme suscite la polémique dans cette Allemagne entièrement pacifiste vouée à expier ce militarisme germanique, source pour de nombreux Européens de toutes les catastrophes du siècle. Pour ces raisons, il subit tout au long de ses ultimes années, l’attaque de la gauche et des verts allemands qui ne lui pardonnent pas son œuvre conservatrice et belliciste. En effet, dans une Europe en paix et démocratique, dont le poids sur les affaires internationales et la place dans l’histoire du monde s’atténuent toujours un peu plus, Jünger et son œuvre apparaissent comme vestiges d’un temps disparu et oublié, un temps où la guerre était acceptée comme inhérente aux affaires humaines et à la vie des nations.
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Jünger's The Glass Bees
Matthew Gordon
(From Synthesis)
& http://www.wermodandwermod.com
Ernst Jünger
Louise Bogan & Elizabeth Mayer (transl.)
The Glass Bees
New York Review Books, 2000
 THE Glass Bees is an introspective novel about a quiet but dignified cavalry officer called Richard. Unable to adjust to life after war and needing money, he applies for a security job at the headquarters of the mysterious oligarch Zapparoni. Confronted with mechanical and psychological trials, the dream becomes a nightmare, and Richard is forced to contemplate his place in the modern world and the nature of reality itself.
THE Glass Bees is an introspective novel about a quiet but dignified cavalry officer called Richard. Unable to adjust to life after war and needing money, he applies for a security job at the headquarters of the mysterious oligarch Zapparoni. Confronted with mechanical and psychological trials, the dream becomes a nightmare, and Richard is forced to contemplate his place in the modern world and the nature of reality itself.
Although philosophical and lyrical, this book is nonetheless a tense page-turner with all the qualities of great sci-fi drama. The poetic imagery is highly expressive, but there are times when the sentences are clumsy and over-long, the meaning of a passage can be lost over a seemingly unnecessary paragraph break. Whether this is down to Jünger's original German or the fault of translation I couldn't possibly say. Nonetheless Ernst Jünger stands among the most lucid and skilful of continental modern writers.
Jünger's vision of the future isn't the ultra-Jacobin "boot stamping on a human face" of Nineteen-Eighty-Four - it is a subtler, more Western dystopia. Jünger is amazingly prescient in this, although he is rarely given credit for it; he predicts that the media and entertainment will rule the psyches of men, that miniaturisation and hyperreal gratification will become our new Faustian obsession and that for all the wonders and benefits of technology it is ultimately dehumanising and alienating. The new world won't be ruled by crude and brutal tyrants like Hitler, Stalin or Kim Jong Ill, but by benevolent and private businessmen, like Rupert Murdoch. We won’t be dominated by the authoritarian father-ego of Freud, but by the hedonistic-pervert of Lacan. Jünger anticipates the theory of hyperreality formulated by Baudrillard, and it is interesting that this book was published before theories on post-modernism and deconstruction became vogue.
Faced with this less than perfect future, Jünger's doesn't try to incite revolution or political struggle – his message remains the same throughout his work – but to inspire individual autonomy. Despite all outward constraints, uprightedness and self-reliance is real freedom. Jünger depicts a superficial and spiritually bankrupt future, but if he is to be believed, the potential for man to be his true self is always the same.
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, abeilles de verre, allemagne, dystopie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

 door Vincent Blok,
door Vincent Blok, Om ernaar te luisteren:
00:05 Publié dans Histoire, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : première guerre mondiale, histoire, littérature, littérature allemande, littérature française, lettres, lettres allemandes, lettres françaises, ernst jünger, céline, guerre, polémologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Littérature, Nouvelle Droite, Révolution conservatrice, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, allemagne, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
In geübten Zügen: Jünger daheim
von Till Röcke
Ex: http://www.blauenarzisse.de
Ein Leckerbissen für die andere Seite. Die Aufzeichnungen von Wilhelm Rosenkranz sind sensationell belanglos – aber auch kurzweilig. Ernst-Jünger-Freunde aufgepasst!
Die von Thomas Baumert herausgegebenen Erinnerungen des Herrn Rosenkranz haben in der Reihe der „Bibliotope“ (Band 5) einen liebenswürdigen Rahmen der Publikation gefunden. Wer sonst, wenn nicht Tobias Wimbauer, ist überhaupt befugt, derartige Marginalien unters Volk zu streuen?
Herausgekommen ist demnach ein exklusives Büchlein mit wenigen, behutsam ausgewählten Fotografien. Sie zeigen nicht nur Ernst Jünger beim Käferfangen, sondern auch das „nüchterne Haus“ (E. J. über seine backsteinige Heimstatt) in Kirchhorst.
Daneben besteht das Bändchen aus Berichten einiger der wenigen Zusammenkünfte von Rosenkranz und Jünger. Ersterer lebte ganz in der Nähe und kam – so mancher kriegsbedingten Einwirkung zum Trotz – des Öfteren mit dem verehrten Dichter zusammen.
Die im Ton der sympathischen, an keiner Stelle albernen Bewunderung gegenüber dem schreibenden Klausner getragenen Aufzeichnungen dürften die entsprechende Klientel angemessen bedienen. Jüngers Frau ist herzlich und stört nicht, die Natur um Kirchhorst herum geizt nicht mit Reizen und wer mit Jünger anbandelt, der fängt irgendwann das Träumen an. Es erwischt Wilhelm Rosenkranz auf dem Fahrrad.
Im zweiten Teil finden sich einige Briefe von Rosenkranz an Jünger, leider fehlt der Jüngersche Part vollends. Wie dem auch sei, Wilhelm Rosenkranz zeigt sich dem Leser als ein vom Werk des bewunderten Dichters vollends in den Bann gezogener. Noch Jahre nach dem Krieg hängt er den Eindrücken an jene Kirchhorster Jahre nach, und als er schließlich 1975 stirbt, erinnert man sich sogar in Wilflingen noch an jenen „Leser namens Rosenkranz“.
Kaufempfehlung für die Anhänger Ernst Jüngers und für alle, die bei Klett Cotta nichts mehr finden.
Thomas Baumert (Hrsg.): Wilhelm Rosenkranz: Die andere Seite. Begegnungen mit Ernst Jünger in Kirchhorst. 110 Seiten, Eisenhut Verlag 2014. 12,90 Euro.
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, allemagne, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
von Benjamin Jahn Zschocke
Ex: http://www.blauenarzisse.de

Der Literaturwissenschaftler Matthias Schöning hat zusammen mit zahlreichen Jünger-Kennern ein ambitioniertes Handbuch zum Gesamtwerk des Meisters herausgegeben, von A wie „Arbeiter“ bis Z wie „Zwille“.
Zunächst zu den Daten: 56 Autoren, darunter zehn Frauen, stellen auf rund 450 Seiten Exposés zu allen Werken Ernst Jüngers (1895 — 1998) zusammen. Unter den Autoren finden sich Namen wie Ulrich Fröschle, Helmuth Kiesel, Steffen Martus und Ingo Stöckmann, die typischerweise für eine literaturwissenschaftliche und eben keine vordergründig politisch-moralische Auseinandersetzung mit dem Werk Ernst Jüngers bekannt sind.
Auf den Herausgeber Matthias Schöning sei ein kurzes Schlaglicht geworfen: Sein Themenspektrum reicht von Aufsätzen über die Literatur in der Romantik, im Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik bis hin zur DDR, aber auch zu Betrachtungen herausgehobener Autoren wie Louis-Ferdinand Céline, Gottfried Benn und Thomas Mann.
Seine umfangreichste Arbeit leistete Schöning aber bislang zu Ernst Jünger. Bereits 2001 gab er zusammen mit Ingo Stöckmann das Werk Ernst Jünger und die Bundesrepublik: Ästhetik, Politik, Zeitgeschichte heraus und versuchte so, den zumeist einseitigen Schriften zu Jüngers politischen Werken vor 1945 ein  ernstzunehmendes Gegengewicht entgegenzustellen, nicht zuletzt in der unübersehbaren Hoffnung, den Fokus der fortwährenden Debatte um Jünger auf einen bislang stiefmütterlich behandelten Schaffensabschnitt des Autors zu lenken.
ernstzunehmendes Gegengewicht entgegenzustellen, nicht zuletzt in der unübersehbaren Hoffnung, den Fokus der fortwährenden Debatte um Jünger auf einen bislang stiefmütterlich behandelten Schaffensabschnitt des Autors zu lenken.
Zwei Verwerfungslinien im Werk Jüngers werden bei der Lektüre des Handbuches offengelegt: Einerseits sein zeitlebens betriebenes Umdichten, Umdeuten und Relativieren seiner politisch gefärbten Frühwerke, das ihm von seinem Sekretär Armin Mohler kompromißlos und unnachgiebig vorgeworfen wurde und letztlich zum Bruch zwischen den Denkern führte.
Andererseits, und das ist deutlich interessanter, die Veränderungen in Jüngers Werk nach 1945. Hier sind Schöning und Stöckmann wieder in ihrem Element, denn dort beginnt die „Debatte“ um Jünger. Für beide liegt der Gedanke nahe, daß die Debatte vor allem als Symbolbildungsort für die Prozesse sozialer Integration diente und heute noch dient. Anhand der Person Jünger wird diskutiert, was man sagen darf und was nicht, was und wie erinnert werden soll, wem man die Frage nach der „deutschen Schuld“ stellt und welche Aufgabe der Intellektuelle in der BRD haben soll.
Die Zeitenwende nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist auch in Ernst Jüngers Werken überdeutlich abzulesen. Diese Zäsur besteht jedoch nicht darin, daß er auf einmal vom Tagebuch oder Essay zum erzählenden Text findet. Das hat er schon 1939 mit den Marmorklippen getan.
In den zwanziger und dreißiger Jahren stehen Jüngers Texte in einem unmittelbar zeitdiagnostischen Zusammenhang. Der Autor ist in alle wesentlichen Ereignisse dieser Zeit denkend involviert. Mit dem Ende des Krieges ändert sich das: Jünger geht zum Zeitgeschehen und zu den Hauptdiskursen der BRD auf Distanz.
Das äußert sich darin, daß er zu keinem der Gründungsmythen, die für die BRD etabliert wurden, einen Beitrag leistete. Er bedient sich weder der Auffassung der „Stunde Null“, noch jener der „Restauration“. Er blieb bis ans Ende seines Lebens auf elitärstem Niveau außen vor.
Dem heutigen Leser, dem diese Debatten vielleicht nicht einmal mehr dem Namen nach bekannt sind, ist mit dem Handbuch ein grundsolides Werk in die Hand gegeben, das zum ersten Entdecken ebenso einlädt wie zum Vertiefen der Erkenntnisse des Fortgeschrittenen.
Matthias Schöning (Hrsg.): Ernst Jünger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 439 Seiten, J. B. Metzler Verlag 2014. 69,95 Euro.
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, allemagne, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
|
 MONTMEDY & MARVILLE & plus... : MONTMEDY & MARVILLE & plus... : Orages d'acier - commémoration théatrale 14-18
| ||
|---|---|---|
| FRANCE | Début : Samedi 11 Octobre 2014, 16:00 Fin : Dimanche 12 Octobre 2014, 16:00 |
|
|
L'association Transversales vous donne rendez-vous le samedi 11 octobre à 16h00 à la citadelle de Montmédy, ainsi que le dimanche 12 octobre à 16h00 dans les caves de Marville. Vous assisterez alors à un témoignage des plus saisissants de la 1ère guerre mondiale:
|
||
18:54 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, france, lorraine, montmédy, ernst jünger, théâtre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

L’anno è il 1895. Röntgen era vicino alla scoperta dei raggi X; in Francia esplodeva l’affaire Dreyfus. Amava ricordare questi due avvenimenti, Ernst Jünger. Essi attraversarono tacitamente la sua vita e le sue riflessioni, le quali non sono altro che lo specchio di un secolo: quel Novecento veloce e potente come il fulmine di Eraclito, fulmine che «governa ogni cosa», come era scritto sopra la soglia della baita di Heidegger nella Selva Nera. La scoperta di Röntgen aprì il secolo della tecnica, dando la possibilità all’uomo di “vedere l’invisibile”, di osservare ciò che al microscopio era precluso, di sviluppare la ricerca sull’atomo e sulla fissione nucleare. Cinquanta anni separarono la tanto casuale quanto fortunata scoperta del 1895 da Little Boy, dolce artificio statunitense, che Hiroshima ricorda come fuoco celeste: meno modesto del giottesco bagherino luminoso di san Francesco, più furioso dell’infuocato carro del Libro dei Re, dipinto da Roerich sulle calde tonalità del rosso. L’atomica non lasciò niente; non rimase a terra il mantello che a Elia cadde durante l’ascesa. Chi ha vissuto il Novecento ha timore dell’uomo più che di Dio, le cui distruzioni narrate nell’Antico Testamento sembrano delle grazie in confronto ai massacri di due guerre mondiali. Il caso Dreyfus inaugurò invece l’arma migliore delle democrazie occidentali: l’opinione pubblica, lama dotata della più affilata critica, aumentò il grado di incertezza politica, incassando una vittoria sulle baffute e polverose forze conservatrici. Il secolo passato è stato mutevole come l’acqua, oltre che terribile come il fulmine. Ernst Jünger è nato così: con l’invito a riflettere sulla tecnica e sulla politica, ma senza cadere nella spirale della sola contemplazione. Il tempo dell’uomo è limitato, l’educazione costosa. Alla contemplazione riunì l’azione, ma lo fece in modo più armonico e costante del giapponese Mishima, altro equilibrista a metà tra la luce notturna del pensiero e quella diurna dell’atto senza scopo. La bellezza, ne siamo suggestionati, è un tramonto: il momento in cui le forze lunari e solari si dividono il campo, e contemplazione e azione diventano Uno, nell’ascesa di un pilota verso la stella più vicina, su un affilata lama dei cieli. Mishima in Sole e acciaio insegna che «corpo e spirito non si fondono mai».
Jünger lottò con l’acciaio, quello dell’artiglieria inglese e francese, sul fronte occidentale. E, checché ne dica un beffardo adagio militare, non bastò la colazione a tenere insieme anima e corpo: ci volle ben altro. Già nel 1913, appena maggiorenne e fuggito dall’ambiente borghese della casa familiare, si arruolò nella Légion étrangère, covo di avventurieri e delinquenti più che di disciplinati soldatini. L’esperienza algerina a Sidi-bel-Abbès, a suo dire «avvenimento bizzarro come la fantasia», fu pubblicata in forma di confessione romanzata nel 1936, con il titolo di Afrikanische Spiele (Ludi africani). Ma Jünger allora era già noto per le sue imprese nella Prima guerra mondiale. Rimpatriato dall’Africa per l’intercessione del padre Ernst Georg Jünger, farmacista confidente più con la vetreria da laboratorio che con le pallottole, accolse con gioia l’invito del 1914, arruolandosi come volontario nell’esercito del Kaiser Guglielmo II. Aveva da poco incontrato su carta ciò che stava per vedere sul fronte. Le letture di Friedrich Nietzsche lo gettarono tra le braccia della guerra come un vitello che, spinto al mattatoio, si sente nel suo palazzo reale. Ma la carne di Jünger non fu tenera come quella di un vitello, e sopravvisse con estremo ardimento a ben quattordici ferite, di cui l’ultima molto grave, passando da semplice fante a Strosstruppfüher (capo di commando d’assalto), fino all’onore di portare al petto due Croci di Ferro, una Croce di cavaliere dell’Ordine di Hohenzollern e una Pour le Mérite, riconoscimento di una volontà dura come il ferro della medaglia, privilegio che ebbero solo dodici ufficiali subalterni dell’esercito imperiale.
In una caserma della Reichswehr (madre della Wehrmacht), tra il 1918 e il 1923, scrisse i suoi primi libri, tra cui un titolo imprescindibile per chi subì (e subisce) il fascino della Grande guerra: In Stehlgewittern (Nelle tempeste d’acciaio), frutto della rielaborazione di appunti dalla trincea sotto forma di memorie belliche, pubblicato nel 1920. Il destino dell’opera fu diverso da quello di altri racconti di guerra. Non è Il fuoco di Barbusse, apparso in pieno conflitto, ma nemmeno il celebre Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque. Se il successo di questi fu lesto e universale, In Stehlgewittern – pubblicato tardi in traduzione italiana (1961) – circolò in ambienti di destra, tra circoli militari, associazioni di reduci, gruppi nazionalisti e conservatori, i quali ne compresero solo in parte lo spirito. L’esperienza bellica – descritta poi in altre memorie quali La battaglia come esperienza interiore (recentemente pubblicato per i tipi di Piano B), Il tenente Sturm, Boschetto 125, Fuoco e sangue – non solo aveva catturato la gioventù «come un’ubriacatura» ed emancipato le nuove generazioni di tedeschi dal «minimo dubbio che la guerra ci avrebbe offerto grandezza, forza, dignità», ma aveva il sapore dell’«iniziazione che non apriva soltanto le incandescenti camere del terrore, ma anche le attraversava». Le incessanti esplosioni degli shrapnels, angeli del cielo che più che nuove portano palle di piombo a lacerare la carne, furono soltanto uno degli aspetti più terribili di quella guerra tecnica, di materiali. Non è la Francia dipinta dagli impressionisti, quella di macchie e pennellate giustapposte, ma è terreno di mutilazioni, di corpi insanguinati e ricoperti di fanghiglia, di un cielo di pallottole. È la guerra di trincea. È il soldato «che canta spensierato sotto una volta ininterrotta di shrapnels», come immaginato con futuristica eccitazione da Marinetti. E il giovane Jünger coglie tutto ciò con un nichilismo estetizzante, cristallizzato in una prosa magistrale. Il soldato e l’artista qui celebrano la loro intima parentela, giacché la guerra è un’arte e viceversa. Valgono le parole riferite ad Aschenbach, protagonista de La morte a Venezia di Thomas Mann: «Anche lui era stato soldato e uomo di guerra come alcuni dei suoi maggiori; poiché l’arte è una guerra, è logorante battaglia». In Stehlgewittern è una splendida glossa a Novalis, spirito europeo e cristiano, nella sua esaltazione del dinamismo poetico della guerra. La notorietà procuratagli dal libro permise a Jünger un’attiva partecipazione a movimenti nazionalistici e antidemocratici e la collaborazione a giornali come «Arminius», «Der Vormarsch» e «Widerstand», rivista dell’amico nazionalbolscevico Ernst Niekisch. Fu nel primo dopoguerra che cominciò la sua produzione saggistica, incisa ne La mobilitazione totale, Il dolore, L’operaio. Hans Blumenberg non aveva torto quando affermava che Jünger è l’unico autore tedesco ad aver lasciato testimonianze di un confronto pluridecennale con il nichilismo.
Nella sua opera sono forti l’inevitabilità del suddetto confronto e la sfida a tale problema. Egli ha cercato il nulla, l’annientamento del vecchio mondo di borghesi, scienziati e parrucconi; lo ha inseguito, infaticabile, nel deserto (Ludi africani), nello sprezzo della vita di fronte alla guerra (Nelle tempeste d’acciaio), nell’ebbrezza (Avvicinamenti. Droghe ed ebbrezza), nel dolore (Sul dolore), «equivalente metafisico del mondo illuminato-igienico del benessere» (Blumenberg, L’uomo della luna). L’annientamento dell’uomo passa per il suo innalzamento, per la pianificazione totale della società “mobilizzata” nel lavoro e nello studio, per la riduzione finale della persona nella monade tecnico-biologica prospettata nella metafisica de L’operaio, libro fondamentale nelle tappe dell’evoluzione intellettuale del pensatore tedesco, testo oggetto di studio per due grandi filosofi come Martin Heidegger, che negli anni Trenta organizzò sul tema dei seminari privati, e Julius Evola, che ne fece un commento (L’operaio nel pensiero di Ernst Jünger).
Ma c’è un evento nel mezzo della vita del nostro, luminoso come quella cometa di Halley che Jünger contemplò due volte (Due volte la cometa). Mentre lo Stato totale del lavoro da lui immaginato andava realizzandosi, ecco una «svolta imprevista, che va annoverata tra gli eventi più importanti della storia spirituale tedesca» (ancora Blumenberg): Sulle scogliere di marmo, il diamante prezioso tra i piccoli vetrini luccicanti nell’asfalto. Soffermarvisi è d’obbligo. I precedenti biografici del libro chiariscono meglio la svolta. Come ebbe a dire Goebbels, Ministro della Propaganda del Terzo Reich, «abbiamo offerto a Jünger ponti d’oro, ma lui non li volle attraversare». L’insofferenza dello scrittore per i modi pacchiani e volgari del Partito Nazionalsocialista gli procurò antipatie tra i gerarchi: la stampa smise di parlare dei suoi libri e la Gestapo gli perquisì la casa. Nel romanzo decisivo per sua vita, egli descrive un Paese – la Marina, in cui ogni elemento sociale e politico è in armonia – minacciato da un pericoloso popolo di confine, barbaro, portatore di violenza e distruzione, dallo stile terribile e plebeo, guidato dal Forestaro (figura che molti identificarono con Hitler, altri con Stalin). La canaglia del bosco si muove contro la civiltà, l’anarchia nichilistica contro le forze della Tradizione. I due protagonisti, due fratelli (allusione all’autore stesso e a suo fratello, Friedrich Georg), sono supportati da quattro personaggi: Padre Lampro, dietro cui si può scorgere la Chiesa, o almeno la forza spirituale della religione; Belovar, vecchio e coraggioso barbuto a rappresentanza del vecchio mondo rurale; di nobile stirpe, invece, il principe Sunmyra, la cui testa mozzata dopo un’eroica impresa è recuperata dal protagonista e diventa oggetto di rituali; infine Braquemart, bellicoso sodale del principe ed effigie del nobile intellettuale nichilista, che interpreta la vita come meccanismo le cui ruote motrici sono la violenza e il terrore, uomo di «fredda intelligenza, sradicata e incline all’utopia». Chiunque abbia confidenza con la letteratura jüngeriana ricorderà le parole che aprono Sulle scogliere di marmo: «Voi tutti conoscete la selvaggia tristezza che suscita il rammemorare il tempo felice: esso è irrimediabilmente trascorso, e ne siamo divisi in modo spietato più che da quale si sia lontananza di luoghi». La ricerca della bella morte in guerra fa spazio alla «vita nelle nostre piccole comunità, in una casa ove la pace regni, fra buoni conversari, accolti da un saluto affettuoso a mattina e a sera». A chi vive l’esistente come poesia non resta altro che chiedere asilo ai manieri della propria interiorità, confidando nella resistenza dei nobili contro il nulla, nella sublimazione di tutto nel fuoco catartico dello specchio di Nigromontanus.
Fu Hitler a salvare Jünger da morte certa. Il Forestaro apprezzava la penna che lo tratteggiò. Lo salvò anche dopo il 20 luglio del 1944, data del celebre attentato al Führer. Se è vero che non furono trovate prove della collaborazione tra gli attentatori e Jünger (che durante la Seconda guerra mondiale si occupava dell’ufficio di censura a Parigi, come ufficiale dello Stato Maggiore), lo è altrettanto il fatto che i sospetti su di lui erano più che forti, tanto da fargli recapitare un’espulsione dall’esercito per Wehrunwürdigkeit (indegnità militare). Era definitivamente finito il tempo dell’eroe di guerra, cominciava quello del contemplatore solitario. Sottoposto a censura durante l’occupazione alleata, sorte condivisa con gli amici Martin Heidegger e Carl Schmitt (il quale era, tra le altre cose, padrino del secondo figlio di Ernst, Alexander Jünger), si ritirò nel paesino di Wilflingen, prima nel castello degli Stauffenberg (famiglia da cui proveniva Claus Schenk von Stauffenberg, organizzatore del fallito attentato a Hitler), poi nella foresteria del conservatore delle acque e delle foreste della stessa famiglia, edificio che fu sua abitazione fino alla morte. Vasta è l’opera di questo grande scrittore tedesco. Fu il diarista del Novecento, interprete del suo spirito. La costanza con cui annotò fatti e riflessioni sui suoi diari è nota. Anche nella scrittura, Ernst Jünger mostrò coraggio: il diario è più di altre la forma stilistica attraverso la quale un pensatore o un letterato si mostra nella sua intima debolezza di uomo, sottoponendosi a una dilapidazione di credibilità; l’estrema rinuncia alla plasticità dell’artista in cambio dell’autenticità dell’origine dei propri pensieri. I diari completano gli altri scritti, dimostrando che Jünger non offrì prodotti, ma indicò vie. Lo fece in tutta la letteratura successiva a Sulle scogliere di marmo, da Heliopolis a Eumeswil, da Il libro dell’orologio a polvere a Al muro del tempo, da Il nodo di Gordio (dialogo a due voci con Carl Schmitt) a Oltre la linea (con Martin Heidegger). Proprio in quest’ultimo testo, composto da due scritti che omaggiano il sessantesimo giorno genetliaco del rispettivo interlocutore, avviene il confronto sul tema del nichilismo tra due dioscuri simbolici del tramonto vivo di un’epoca, un duello a colpi diretti nel quale ognuno, ça va sans dire, si compiace della maestria dell’altro. Interrogarsi sul nichilismo è, nel secondo dopoguerra, cercare una risposta alla domanda: quale poesia dopo Auschwitz?
Non condividiamo il giudizio di Evola sul secondo Jünger. Non fu un pluridecorato «normalizzato e rieducato», come ebbe a mugugnare il filosofo romano durante un colloquio con Gianfranco de Turris, ma un pensatore capace di profonde riflessioni, di analisi e previsioni rivelatesi tanto esatte quanto inquietanti. Fu uno dei pochi che riuscì a disvelare, con tormentata quiete, la patina ideologica che copre la realtà. Ecco, le ideologie. Egli non le amava, perché «un errore diviene colpa soltanto quando si persevera» (Sulle scogliere di marmo); rifuggì tutti gli ismi, ma si arrogò il diritto di vivere la vita come un esperimento, non come un processo soggetto a logiche limitative. «Il suffisso ismo ha un significato restrittivo: accresce la volontà a spese della sostanza» (Eumeswil). La sua scrittura è «espressione di ciò che è problematico, del qui e del là, del sì e del no», come si espresse Thomas Mann pensando a se stesso nelle Considerazioni di un impolitico. Ernst Jünger fu maestro insuperabile della contemplazione, esempio memorabile di azione, teologo della nuova epoca, platonico moroso, entomologo competente, pedagogo della libertà. Infine amante dell’Italia, dalla Dalmazia irredenta all’assolata Sicilia, da quel di Napoli fino alla più amata di tutte, quella Sardegna dalla terra «rossa, amara, virile, intessuta in un tappeto di stelle, da tempi immemorabili fiorita d’intatta fioritura ogni primavera, culla primordiale». «Le isole – insegna – sono patria nel senso più profondo, ultime sedi terrestri prima che abbia inizio il volo nel cosmo. A esse si addice non il linguaggio, ma piuttosto un canto del destino echeggiante sul mare. Allora il navigante lascia cadere la mano dal timone; si approda volentieri a caso su queste spiagge» (Terra sarda). E la sua opera fu un’isola di luce lontana dalla baruffa letteraria del Novecento, oasi per gli spiriti assetati di libertà.
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
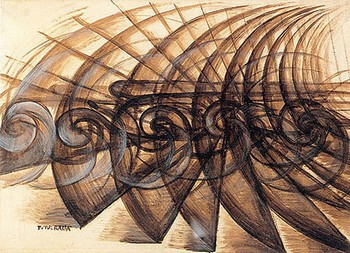
di Marco Zonetti
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]
Leggendo il racconto “L’Uomo della Sabbia” di Ernst Theodor Hoffmann e il breve romanzo distopico “Le api di vetro” di Ernst Jünger, potremmo scoprire che i due autori non condividono soltanto il nome di battesimo e la nazionalità, bensì una peculiare e chiaroveggente diffidenza nei confronti della tecnologia, o perlomeno del suo potere manipolatore e disumanizzante.
Nel racconto di Hoffmann, scritto nel 1815, il giovane Nathanael è ossessionato dalla figura di un uomo misterioso, Coppelius, che fin dall’infanzia egli apparenta iconograficamente all’Uomo della Sabbia (o Mago Sabbiolino), una sorta di uomo nero delle tradizioni popolari che getta la sabbia negli occhi dei bambini, strappandoli e portandoli nel suo rifugio sulla “falce di luna” per darli da mangiare ai suoi “piccolini dai becchi ricurvi”.
Coppelius viene introdotto nel racconto in veste di vecchio avvocato amico del padre di Nathanael, per poi rivelarsi una specie di folle scienziato/alchimista nonché complice di un fabbricante di automi italiano, Lazzaro Spalanzani, che si spaccia per un innocuo professore di Fisica. Nathanael conosce la figlia di quest’ultimo, Olimpia, in realtà un automa costruito da Spalanzani con l’aiuto di Coppelius, e se ne innamora perdutamente finendo in un vortice di follia. Dopo una breve parentesi di serenità, accudito dalle amorevoli cure della fidanzata Clara e dell’amico Lothar, che rappresentano il focolare domestico e gli affetti sinceri non contaminati dall’unheimlich costituito dalle “diavolerie” della tecnica incarnate invece da Coppelius e Spalanzani, Nathanael sembrerà aver ritrovato brevemente la ragione, salvo poi risprofondare nelle antiche ossessioni – ridestate da un cannocchiale fabbricato da Coppelius – che lo condurranno al suicidio.
Lo stesso approccio alla scienza e alla tecnologia viste come “perturbanti” traspare dal breve romanzo di Ernst Jünger, “Le api di vetro” del 1957. Api di vetro, ovvero minuscoli automi intelligenti che popolano i giardini dell’industriale Zapparoni (un altro italiano) ove il protagonista Richard – reduce di guerra e di un mondo semplice fatto di tradizioni d’onore e di valori ormai perduti – è capitato in cerca di un impiego. Nei giardini di Zapparoni, arricchitosi grazie all'ideazione e costruzione di macchine tecnologicamente avanzate che dominano ormai il mondo, Richard osserva la “spaventosa simmetria”, per citare William Blake, delle api di vetro e della loro fisiologia ipertecnologica che, lungi dal migliorare o perfezionare la natura (imperfettibile in sé come fa notare Jünger in molte sue opere, ricordandoci che più la tecnologia progredisce più l’umanità subisce un’involuzione e viceversa), la impoveriscono, devastandola in ultima analisi – i fiori toccati dalle “api di vetro” sono infatti destinati a perire poiché deprivati dell’impollinazione incrociata..
Seppur concepite in due epoche diverse, Olimpia e le api di vetro rappresentano l’elemento perturbante di un mondo ossessionato dalla scienza, e in corsa dissennata verso un futuro ultratecnologico in cui uomini e macchine divengono intercambiabili sempre più a discapito dei primi. In cui la poesia dell’ideale romantico e dell’amore sincero, come quello di Nathanael per Clara, viene guastato dall’ossessione per la fredda e innaturale Olimpia, meccanismo perfetto ma inumano come quello degli “automi di Neuchatel” che devono aver ispirato Hoffmann per la sua protagonista. In cui uomini e animali vengono via via sostituiti distopicamente dalle macchine e dagli automi, e dove la stessa nascita, lo stesso atto d’amore che porta al concepimento dell’essere umano viene sostituito da un alambicco, da una provetta, da una miscela in laboratorio, in una sorta di “catena di montaggio” della riproduzione, di “fordismo” applicato alle nascite come nel “brave new world” di Aldous Huxley, “eccellente mondo nuovo” in cui sia Olimpia sia le api di vetro sarebbero cittadini onorari e abitanti privilegiati.
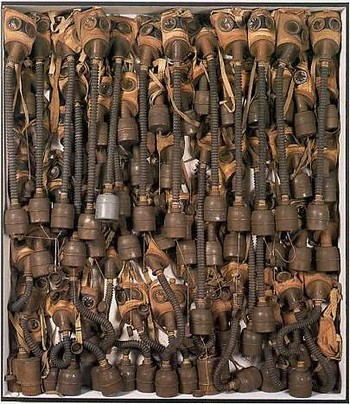 Altra peculiare affinità fra le due opere è quella data dalla ricorrenza dell’elemento degli “occhi” e del “vetro”. Nel racconto di Hoffmann, troviamo per esempio il leitmotiv dei cannocchiali (“occhi” fatti di vetro come le api) costruiti dal solito Coppelius nelle vesti dell’italiano Coppola. Cannocchiali che ci riportano immediatamente a Galileo Galilei, sommo esponente dell’ambizione scientifica dell’uomo, ambizione che nel racconto di Hoffmann è tuttavia distorta dagli ambigui scopi di Coppelius, intenzionato a deprivare Nathanael degli occhi, per renderlo un cieco automa come la stessa Olimpia. Paradossalmente, anziché donargli una visione amplificata della realtà rendendolo più “lungimirante”, il cannocchiale che Nathanael acquista da Coppelius lo fa sprofondare in una follia primordiale che non riconosce affetti, amore, amicizia, né tantomeno connotati umani, portandolo infine all’annullamento di sé, ovvero al suicidio.
Altra peculiare affinità fra le due opere è quella data dalla ricorrenza dell’elemento degli “occhi” e del “vetro”. Nel racconto di Hoffmann, troviamo per esempio il leitmotiv dei cannocchiali (“occhi” fatti di vetro come le api) costruiti dal solito Coppelius nelle vesti dell’italiano Coppola. Cannocchiali che ci riportano immediatamente a Galileo Galilei, sommo esponente dell’ambizione scientifica dell’uomo, ambizione che nel racconto di Hoffmann è tuttavia distorta dagli ambigui scopi di Coppelius, intenzionato a deprivare Nathanael degli occhi, per renderlo un cieco automa come la stessa Olimpia. Paradossalmente, anziché donargli una visione amplificata della realtà rendendolo più “lungimirante”, il cannocchiale che Nathanael acquista da Coppelius lo fa sprofondare in una follia primordiale che non riconosce affetti, amore, amicizia, né tantomeno connotati umani, portandolo infine all’annullamento di sé, ovvero al suicidio.
Come lo stesso Richard protagonista de “Le api di vetro”, Nathanael perde a poco a poco la propria umanità e l’attaccamento alle proprie tradizioni e ai propri valori, travolto dalla tecnologia malvagia di due esseri votati alla creazione di marionette e pagliacci destinati a divertire le folle, fenomeni da baraccone come Olimpia, o come gli automi di Zapparoni finiti a sostituire gli attori in carne e ossa nei film, quali li descrive Jünger nel suo romanzo.
Per tornare al tema degli occhi, il protagonista de “Le api di vetro” capirà a poco a poco che, per l’incarico che intende assumere, occorrono occhi disumanizzati, asettici, (occhi di vetro?) che devono vedere senza guardare, senza discernere, così da passar sopra alle atrocità perpetrate nel giardino (e nella società) degli orrori tecnologici di Zapparoni. Per poter sopravvivere nel mondo ipertecnicizzato e inumano insediatosi grazie alla perdita dei valori e della tradizione, Richard si renderà dunque conto che è necessario lasciarsi cavare metaforicamente gli occhi dall’Uomo della Sabbia rappresentato dall’ambizione e della protervia dell’uomo.
Con le derive della tecnologia, con il sacrificio dell’etica sull’altare della Hýbris, con la corsa dissennata a voler piegare la natura al nostro volere, sembrano quindi preconizzarci Hoffmann e Jünger, l’essere umano diventa simulacro di se stesso, automa (fintamente) perfetto, “ape di vetro” senz’anima, senza cuore, senza sesso. Transgender e ultragender costruito in serie come una marionetta, al punto che – nella nostra realtà più vicina – i genitori risultano tanto spersonalizzati da abdicare perfino al nome di padre e di madre per diventare “genitore 1” e “genitore 2”, espressioni che tanto piacerebbero all’ambiguo Zapparoni – che deve il suo successo al tramonto dell’etica e della tradizione – ma anche all’infido Coppelius, sorta di “tormento del capofamiglia” kafkiano, non meno inquietante del “rocchetto di filo” Odradek, protagonista del celebre racconto dello scrittore praghese. Ma soprattutto al mostruoso Uomo della Sabbia che, dal suo antro nella “falce di Luna”, non potrebbe che compiacersi oltremodo della nostra cieca ambizione, che ci impedisce di vedere la realtà distopica nella quale, superbi e protervi, ci stiamo gettando a capofitto inseguendo le derive della tecnologia e dell’ingegneria genetica.
La Hýbris demiurgica della tecnica rappresentata da Coppelius e Zapparoni, ovvero l’aspirazione a replicare la potenza creatrice divina, racchiude necessariamente l’annullamento di sé e dell’umanità, per questo il Nathanael di Hoffmann non può che suicidarsi e il Richard di Jünger tradire i propri princìpi per assoggettarsi al nuovo status quo e al nuovo regime di spersonalizzazione dell’uomo.
Privi degli occhi dell’etica, dei valori e del sacro rispetto della natura, accecati dalla nostra arroganza, siamo solo bambini sprovveduti destinati a diventare cibo della progenie di occulti “uomini della sabbia” o schiavi di scaltri e spietati “Zapparoni”.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst theodor hoffmann, ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, lettres, révolution conservatrice, technologie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
di Luciano Lanna
Fonte: Segnavia
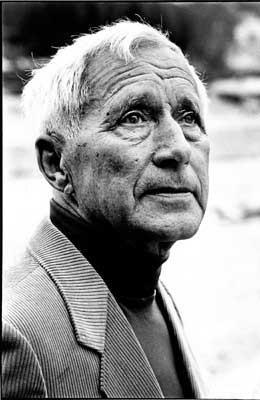 Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…
Un’operazione analoga a quella che ha riguardato sul Garantista Céline dovrebbe a nostro avviso coinvolgere anche Ernst Jünger, il decano novecentesco della letteratura tedesca, nato nel 1895 e scomparso nel 1998 alla veneranda età di 103 anni. Al di là della sua militanza adolescenziale tra i nazionalisti, infatti, della sua partecipazione da volontario alla Grande Guerra e la stessa strumentalizzazione che il regime hitleriano fece della sua opera L’operaio, dedicata alla società della mobilitazione di massa, lo scrittore – nonostante i suoi scritti giovanili militaristi – non solo arrivò ben presto a esporsi esplicitamente contro la dittatura nazista e a partecipare addirittura al complotto del 1944 per far fuori Hitler ma, sin dagli anni ’30, produsse tutta una serie di opere inequivocabilmente di natura libertaria. Sarà lui, e non Brecht, ad esempio a scrivere: “L’obbligo scolastico è, essenzialmente, un mezzo di castrazione della forza naturale, e di sfruttamento. Lo stesso vale per il servizio militare obbligatorio. Respingo come una scemenza l’obbligo scolastico, come ogni vincolo e ogni limitazione alla libertà”. Non solo: Jünger negli anni ’60 del Novecento descriverà con benevolenza e simpatia “i figli dei fiori della California, i provos di Amsterdam, gli hippies multicolori accoccolati sulla scalinata di piazza di Spagna, o sui bordi della Barcaccia, gli indefinibili che emergono dappertutto e che parlano un nuovo gergo. Compagni simili esplorano il sottosuolo: è una buona cosa poi se sono anche colti”. Del resto, lui stesso negli anni ’20 aveva aderito ai Wandervögel, il movimento giovanile tedesco che per la passione ecologista, la ricerca di una nuova spiritualità anticonformista e la sensibilità comunitaria anticipava i beatnik e il libertarismo della generazione “on the road”. Si pensi anche alla sua vicinanza senile ai Verdi che manifestavano in Germania per il neutralismo e contro il nucleare, al suo libro sul fenomeno degli stupefacenti e alla sua teorizzazione della figura dell’anarca nel suo romanzo Eumeswil…
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Jünger, un anarchiste conservateur droit dans ses bottes

Ernst Jünger, à la fin de la Première Guerre mondiale. Le conflit fit perdre ses illusions au jeune soldat qu'il était.
Deux photos peuvent résumer une vie. La première, prise à la fin de la Première Guerre mondiale, dévoile un officier arborant l'ordre Pour le mérite, la plus haute décoration militaire allemande, créée par Frédéric II. Le jeune homme, "pas très grand, mince, se tenant bien droit, visage étroit comme coupé au couteau", sera le dernier à la porter, puisqu'il meurt à près de 103 ans, en 1998. Son nom : Ernst Jünger, guerrier exceptionnel, grand écrivain, collectionneur d'insectes facétieux, voyageur au coeur aventureux.
Quel homme incarne mieux le XXe siècle qu'Ernst Jünger, héros de Grande Guerre et symbole de l'Europe nouvelle et pacifiée ? Ernst Jünger. Dans les tempêtes du siècle, c'est précisément le titre de la biographie que lui consacre Julien Hervier, meilleur spécialiste français de l'auteur d'Orages d'acier.
Quelque chose chez Jünger ne passe pas, en France : cette rigidité, cette maîtrise, qui fait prendre cet Allemand de tradition catholique (mais athée), aux origines paysannes et ouvrières, pour l'archétype de l'aristocrate prussien protestant, le junker. Sans doute y a-t-il méprise.
Selon Ernst Niekisch, instituteur marxiste et chef de file du "nationalbolchevisme" - l'un des multiples courants rouge-brun qui saperont la république de Weimar -, familier de l'appartement-salon berlinois de Jünger, où se côtoient artistes fauchés, demi-soldes aux abois et aventuriers en tout genre, "sa distinction ne repose pas sur un privilège social, mais directement sur le contenu intime de son être : il fait partie de ces rares hommes qui sont absolument incapables de bassesse. Celui qui pénètre dans la sphère où il vit entre en contact avec une dure et froide sincérité, une sobre et sévère objectivité, et surtout, un modèle d'intégrité humaine."
Pour son biographe, Jünger est d'abord victime de sa monomanie : "l'obsession de la tenue", qu'il s'agisse de posture, maintien, aspect, fermeté, dignité, "surmoi", fruit d'une "anthropologie personnelle" élaborée pendant la Grande Guerre au contact du genre humain. Car le jeune soldat de 1914, nostalgique "de l'inhabituel, du grand péril", saisi par la guerre "comme [par] une ivresse", adoptant un flegme fataliste à l'épreuve du feu, vieillit d'un siècle en quatre ans et quatorze blessures, comme l'illustrent ses Carnets de guerre 1914-1918, qui viennent d'être traduits. Et y perd ses illusions.
"Là où un homme est monté jusqu'à la marche presque divine de la perfection, celle du sacrifice désintéressé où l'on accepte de mourir pour un idéal, on en trouve un autre pour fouiller avec cupidité les poches d'un cadavre à peine refroidi." La vieille chevalerie est morte, la guerre moderne est menée par des techniciens et la transgression est au coin de la rue. Lors de son bref séjour sur le front, dans le Caucase, en 1942, apprenant par la rumeur les exactions de la Wehrmacht contre les civils, "la Shoah par balles", il est "pris de dégoût à la vue des uniformes, des épaulettes, des décorations, des armes, choses dont [il a] tant aimé l'éclat ".
Le "junker", soldat héroïque d'un autre temps, était-il finalement modelé pour la guerre? "Lorsque je me place devant mes soldats [...] je constate que j'ai tendance à m'écarter de l'axe du groupe; c'est là un trait qui dénote l'observateur, la prédominance de dispositions contemplatives." L'aveu. Le guerrier se rêve hors de la ligne de mire et du champ de bataille. On le lui reprochera suffisamment.
Pourquoi ne s'engage-t-il pas aux côtés des officiers instigateurs du complot du 20 juillet 1944 contre Hitler, alors qu'il est en plein accord avec eux ? Parce qu'il réprouve les actes terroristes. C'est au nom du même principe, que, militant nationaliste, il refuse, en 1922, de se joindre au corps franc qui assassine le ministre des Affaires étrangères, Walther Rathenau. Question de tenue. Jamais la fin ne justifie les moyens. Il le dira noir sur blanc aux nazis qui multiplient les appels du pied : "Ce n'est pas [...] une caractéristique majeure du nationaliste que d'avoir déjà dévoré trois juifs au petit déjeuner."
Jünger est sans doute le seul homme à avoir été protégé à la fois par Adolf Hitler, lorsque les nazis veulent liquider cet "officier méprisant", et par Bertolt Brecht, quand ses camarades communistes veulent en finir avec ce "produit de la réaction". Qui peut bien être ce diable d'homme protégé par de tels anges gardiens? Un de ses biographes allemands l'a qualifié d'"anarchiste conservateur".
Jünger est à fois un homme d'ordre et en rupture de ban. Lorsque, à peine âgé de 16 ans, il s'engage dans la Légion étrangère, c'est pour déserter à Sidi Bel Abbes et emboîter le pas de Rimbaud dans de nouveaux Jeux africains. Lorsque, après la guerre, il expérimente les drogues - auxquelles, blessé à la tête, il a goûté, dès 1918 - auprès d'Albert Hofmann, l'inventeur du LSD, c'est sous contrôle médical.
Au fond, Jünger-le-corseté déteste la politique, les organisations et la technique. Il abhorre le nihilisme des nazis et celui de Céline, dont il dresse un portrait accablant dans ses Journaux parisiens. Pour venir à bout du Mal, il mise sur la liberté - celle du hors-la-loi scandinave du Traité du rebelle -, sur Eros (l'amour est l'adversaire du Léviathan) et la création artistique.
Lors des terribles ébranlements politiques dont il est témoin, Jünger ressent "une grande sensibilité sismographique", mais il ne se départit pas de son rôle de spectateur. Depuis l'enfance, il se réfugie dans les livres et la nature. Le sentiment, alors éprouvé, que "la lecture est un délit, un vol commis contre la société" ne l'a jamais quitté.
Il lit partout et par tous les temps. Sous les déluges d'obus, "alors qu'avec effroi tu penses que ton intelligence, tes capacités intellectuelles et physiques sont devenues quelque chose d'insignifiant et de risible", il avale les grands Russes, Gogol, Dostoïevski, Tolstoï, et les Aphorismes sur la sagesse dans la vie, de Schopenhauer.
Sa passion pour les insectes, métamorphosée au fil du temps et des désillusions en entomologie, leur étude scientifique, nourrit ses Chasses subtiles. Les cicindèles, sous-groupe des coléoptères, ont sa préférence. L'une de ces créatures porte d'ailleurs son nom : Cicindela juengerella juengerorum.
A partir des années 1950, il parcourt la planète, attentif aux bonnes nouvelles - fécondité inépuisable du monde naturel, pertinence des techniques primitives - comme aux mauvaises : dégâts du tourisme de masse, suprématie du béton, règne bruyant des moteurs. Les réflexions de cet écologiste avant l'heure - les Verts allemands le détestent - alimentent les cinq tomes de Soixante-dix s'efface, son oeuvre ultime.
Et si, finalement, la clef de cet homme balançant entre action et contemplation se logeait dans son combat contre la dépression - aux pires heures de l'Allemagne, à la mort, en uniforme, de son fils aîné, en 1944 à Carrare, et après guerre, à la suite du suicide du cadet - et contre une Sehnsucht insondable ? Son éditeur Michael Klett en émet l'hypothèse à l'enterrement de l'écrivain. "Lors de coups d'ailes plus légers de l'ange de la Mélancolie, ajoute-t-il, il se plongeait dans la contemplation d'une fleur, s'épuisait en d'interminables promenades ou s'imposait un emploi du temps rigide quasi digne d'un ordre mystique." Ainsi était Ernst Jünger. Mais il n'en a jamais rien dit. Question de tenue.
Ernst Jünger. Dans les tempêtes du siècle, par Julien Hervier. Fayard, 540 p., 26 €.
Carnets de guerre 1914-1918, par Ernst Jünger. Trad. de l'allemand par Julien Hervier. Bourgois, 576 p., 24 €.
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, allemagne, ernst jünger, révolution conservatrice, weimar, julien hervier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Julien Hervier - Ernst Jünger, dans les tempêtes du siècle
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, julien hervier, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ex: http://www.larepubliquedeslivres.com
Un débat de haute volée a récemment agité certains intervenautes de la « République des livres » : était-il concevable qu’un homme tel que Ernst Jünger (1895-1998) ait pu ignorer en 1940 que le verre dans lequel il convenait de verser le champagne se nommait une « flûte », sonorité qui l’amusa ainsi que les officiers de son régiment alors qu’ils passaient par Laon ? On trouve cela dans ses carnets de guerre. La réponse à cette passionnante question ne figure pas dans la biographie, pourtant très complète, que Julien Hervier consacre à Ernst Jünger. Dans les tempêtes du siècle (538 pages, 26 euros, Fayard). On y découvrira en revanche un portrait d’une grande finesse de cet individualiste forcené, une analyse exhaustive de son œuvre, un examen attentif de sa correspondance, un panorama méticuleux de l’Allemagne de son temps, une étude éclairante de ses cercles d’amitié à ses différentes époques. Toutes choses qui rendent ce livre indispensable à tous ceux que cet écrivain singulier fascine ou intrigue quand il n’inquiète pas – du moins en France, où une véritable biographie manquait cruellement.
Pas évident d’écrire la vie d’un écrivain qui s’est déjà tant raconté tant dans ses romans que dans ses journaux intimes. Julien Hervier, son traducteur français et son éditeur dans la Pléiade, y parvient de manière convaincante en évitant l’écueil du démarquage. Il excelle à comparer les différents états des manuscrits, à confronter les préfaces successives d’un même livre. Sur les falaises de marbre, qui compta tant pour ceux qui choisirent l’exil intérieur, est bien mis en parallèle par l’auteur (dans le civil professeur de littérature comparée) avec Le Désert des Tartares de Buzatti et Le Rivage des Syrtes de Gracq, son grand admirateur. De même le dédoublement de la vision à l’œuvre dans Le Cœur aventureux, tant et si bien qu’on put parler alors de réalisme magique. Il entremêle parfaitement l’œuvre et la vie, rendant vaine toute tentative de les dissocier, comme s’y risquent certains biographes qui traitent de la vie à l’exclusion de l’œuvre, abandonnant son analyse aux universitaires. Comme s’il y avait une séparation entre les deux !
N’oubliant jamais sa qualité de traducteur, l’auteur nous éclaire sur des ambiguïtés qui ont souvent échappé au lecteur français notamment dans Le Travailleur (1932) : ainsi de Bürger qui signifie à la fois « citoyen » et « bourgeois » ; ou de Gestalt, à la fois « figure » et « forme » ; ou encore pour son Journal de guerre, de Strahlungen, à la fois « Rayonnements » et « Radiations » ; parfois, le traducteur reconnaît le « faute de mieux » s’agissant par exemple de son journal Siebzig verweht rendu en français par Soixante-dix s’efface, ce qui n’évoque pas, comme dans l’original, l’idée du sable qui s’écoule dans un verre et du vent qui emporte les jours à jamais. Passionnant, sonrécit est parfois un peu sec, à l’image de son héros, raide guerrier devenu pacifiste écologiste, doté d’une sensibilité sismographique aux grands ébranlements historiques, jamais dépris de sa fascination pour les vertus chevaleresques de l’armée prussienne, et plus encore depuis que les guerres étaient gouvernées par des techniciens.
Le récit de sa première guerre, celle qui lui valut de se voir décerner par Guillaume II à même pas 24 ans la plus haute distinction militaire allemande, l’ordre « Pour le Mérite », est bien documenté. Il montre bien le goût sportif du danger, l’autorité de fer exercée sur ses hommes, le courage à la tête des assauts, la capacité à maîtriser les situations de ce petit homme sec de 63 kgs, dont l’attitude n’est pas sans dandysme ni forfanterie. Sa stature de héros s’est façonnée là. Elle l’a longtemps protégé. Si Orages d’acier est l’un des grands livres (moins patriotique qu’on ne le croit) sur cette catastrophe, à ranger entre Le Feu de Barbusse, Ceux de 14 de Genevoix, Les Croix-de-bois de Dorgelès et La Comédie de Charleroi de Drieu la Rochelle, c’est parce que de tous les dangers qu’y a courus Jünger, celui qui le hanta le plus durablement, le plus angoissant de tous, n’est pas un corps à corps avec l’ennemi ou une course avec les obus, mais juste une errance dans les tranchées inconnues à la froide lumière du matin. Mais il y a en plus dans Orages d’acier quelque chose d’un roman d’éducation, où la guerre est considérée comme un grand jeu initiatique, sésame pour le passage à l’âge adulte, quitte à verser parfois dans ce que l’on a appelé « une esthétique de l’effroi ».
 On l’a dit anarchiste conservateur, faute de mieux. Jünger était également fasciné par la politique et par la technique. Cette biographie éclaire l’influence sur sa pensée de la lecture du Déclin de l’Occident de Spengler, ou de l’amitié qui le liait au national-bolcheviste Ernst Niekisch ou au juriste Carl Schmitt, de même que la complicité intellectuelle qui le lia à son frère Friedrich Georg, ses relations avec les poètes Gottfried Benn et Paul Celan, son aversion pour Louis-Ferdinand Céline, qu’il rencontra sous l’Occupation à l’Institut allemand de Paris, et qui l’effrayait : il voyait en lui « la monstrueuse puissance du nihilisme contemporain, alliée à la mentalité d’un homme de l’âge de pierre »
On l’a dit anarchiste conservateur, faute de mieux. Jünger était également fasciné par la politique et par la technique. Cette biographie éclaire l’influence sur sa pensée de la lecture du Déclin de l’Occident de Spengler, ou de l’amitié qui le liait au national-bolcheviste Ernst Niekisch ou au juriste Carl Schmitt, de même que la complicité intellectuelle qui le lia à son frère Friedrich Georg, ses relations avec les poètes Gottfried Benn et Paul Celan, son aversion pour Louis-Ferdinand Céline, qu’il rencontra sous l’Occupation à l’Institut allemand de Paris, et qui l’effrayait : il voyait en lui « la monstrueuse puissance du nihilisme contemporain, alliée à la mentalité d’un homme de l’âge de pierre »
N’en déplaise à ses irréductibles détracteurs (il y en a toujours eu en Allemagne comme en France, ils n’ont jamais désarmé, mais l’emphatique sérénité de cette biographie ne les calmera pas), on ne trouvera pas sous sa plume l’ombre d’un satisfecit accordé à Hitler ou au national-socialisme. Il ne l’a jamais rencontré ; mais, après avoir assisté à l’un de ses meetings, il en a retiré l’impression d’avoir affaire à un maître du Verbe « qui proposait moins des idées nouvelles qu’il ne déchaînait de nouvelles forces ». Non qu’il fut hostile par principe à un Führer, mais il estimait que celui-ci n’était « pas à la hauteur de la tâche à accomplir ». A partir de 1933, il a amendé ses écrits afin d’éviter leur instrumentalisation par les nazis, l’année même où il refusé la proposition de l’Académie allemande de poésie, passée sous la coupe des nazis, de la rejoindre. Tenir, se tenir, maintenir. Tant de lui s’explique là. Garder de la tenue, toujours.
L’un des plus violents articles qu’il ait écrits (dans Das Tagebuch, 21 septembre 1929) était clairement nihiliste, prônant la destruction de l’ordre bourgeois, ce qui lui valut d’être aussi pris à partie par le journal de Goebbels qui attribua sa conception du nationalisme à « son nouvel entourage kascher ». Quant à la question juive, il ne lui trouve aucun intérêt sur le plan politique. Il la règle d’ailleurs en une formule que Julien Hervier juge d’une détestable ambiguïté : « ou bien être Juif en Allemagne, ou bien ne pas être ». Ce qu’il explicita en associant « le Juif de civilisation » (entendez le Juif soucieux de s’intégrer et de s’assimiler aux Allemands) au libéralisme honni. Ce qui ne l’empêche pas de démissionner, avec son frère, de l’association des anciens combattants de leur régiment lorsque les Juifs en sont exclus
Le 20 juillet 1944, malgré son hostilité fondamentale au régime, sa solidarité et son amicale sympathie pour les conjurés, il ne fut pas du complot avorté contre Hitler. Son biographe rappelle qu’il a toujours été hostile au principe de l’attentat, non seulement à cause des représailles mais parce que les hommes se remplacent même au plus haut niveau et qu’un attentat ne saurait amener un bouleversement de fond en comble. Il échappa « miraculeusement » à la répression. Il n’en demeura pas moins pour beaucoup un officier de la Wehrmacht, un ancien ultra du nationalisme qui s’était répandu dans maints journaux durant l’entre-deux-guerres, un théoricien de la mobilisation totale.
L’homme privé n’est pas négligé par ce biographe inspiré, doté d’admiration critique. Pas un homme religieux mais pieux au sens ancien du terme, désarmé face au caractère sacré du monde naturel. Les drogues, Jünger a commencé à y toucher en juin 1918, à l’hôpital de Hanovre : blessé au combat (il le fut quatorze fois), il en profita pour essayer l’éther, expérience qu’il poursuivra plus tard notamment aux côtés d’Albert Hofmann, l’inventeur du LSD ; mais il cessa lorsqu’il comprit que si les substances lui permettaient d’accéder à des intuitions inédites, elles étaient un obstacle majeur à la conscience lucide indispensable à la création artistique. Mais c’est sur la question de sa vulnérabilité que ce livre apporte une lumière nouvelle.
Il nous montre son héros en mélancolique miné par les effets délétères de la Sehnsucht, état qui se traduisait notamment par des périodes d’aboulie. Dans les derniers temps du contemplatif centenaire, écrivain accablé d’honneurs et de prix qui ne se plaisait que dans ses voyages aux îles, le mot qui le résume le mieux selon lui n’en est pas moins « gratitude ». Il ne cessait de payer sa dette aux hommes qui l’avaient fait, aux valeurs dans lesquelles il se reconnaissait, dans les institutions auxquelles il devait, convaincu qu’il n’était pas de plus haute vertu que la reconnaissance. Bien que d’origine catholique et paysanne, il passa pour l’incarnation de l’aristocrate prussien protestant. Beaucoup ont confondu Jünger et Junker. Question d’euphonie probablement. Sa fierté d’avoir un papillon à son nom (Pyralis jüngeri Amsel) et même un organisme monocellulaire à lui dédié (Gregarina jungeri), une vingtaine d’insectes en tout, que l’entomologiste amateur respecté des professionnels a la coquetterie de juger plus importante que sa notoriété littéraire.
Alors oui, certes, sa capacité d’émerveillement face à la découverte de la flûte à champagne… Celle d’un homme qui avait mûri au milieu des tempêtes ainsi qu’en témoignait son ex-libris : « In tempestatibus maturesco ».
(« Ernst Jünger à différents âges – et avec Cioran » photos D.R.)
00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, weimar, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, julien hervier |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

A Tribe Among the Trees:
Ernst Jünger’s The Forest Passage
By Jack Donovan
Ex: http://www.counter-currents.com
Ernst Jünger
The Forest Passage [2]
Translated by Thomas Friese
New York: Telos Press, 2013
We all live in deserts.
Urban deserts. Suburban deserts. Even in rural areas it is difficult to escape the commercially refined silicates of mechanized and meaningless modernity that blow over and bury the fossilized remains of dead gods and old ways. The desert — The Nothing [3] — grows and obscures and stifles all.
Describing the terrorized boredom of modern men, Ernst Jünger, quoting Nietzsche, warns: “woe to him in whom deserts hide.”
Jünger was writing in the aftermath of World War II about the chafing of his own individualism against the bureaucratic machine of Nazi Germany, and The Forest Passage makes mention of dictatorships. But, with uncanny foresight, he predicted our Twenty-First Century predicament, from the pointlessness of voting to near-constant surveillance and the neurotic need to know the news numerous times throughout the day. Jünger prophesied our states that make technicians into priests, while paving over institutions, like churches, which facilitate an inner spiritual life that the secular state is unable to control. That which cannot be counted, measured, or taxed cannot be permitted. This unquantifiable grain of existence that survives beyond the reach of the mechanized world is what Jünger identifies as freedom, and woe to him who knows only the desert, “woe to him who carries within not one cell of that primal substance that ensures fertility, again and again.”
Jünger’s forest is a spiritual oasis. It is not in the desert, but within it. The forest is everywhere — in the desert, in the bush, and in the enemy’s’ own backcountry — like an invisible layer of transcendent humanity and creative life energy that is seen only by those who choose to see it.
. . . it is essential to know that every man is immortal and that there is eternal life in him, an unexplored and yet inhabited land, which, though he himself may deny its existence, no timely power can take from him.
He doesn’t reference it directly, but one wonders if the forest is some kind of allusion to the Garden of Eden — some memory of pure, sinless and untainted man living in harmony with nature. Throughout the book, Jünger seems to be equating pure, primal human morality with Christ-like morality — which will seem an obvious error to everyone who is not a Christian, and a natural fact to anyone who is. The forest rebel — one who takes the forest passage — is so morally certain that, “he allows no superior power to dictate the law to him, neither through propaganda nor force.” This is somewhat problematic, because this kind of individualism-at-all-costs makes tribal life impossible, and therefore makes a new, better society impossible. Without hope for a better society and the ability to integrate into it and trust one’s peers, the forest rebel is just raging against the machine, and seems like a mere contrarian or malcontent.
The Christian morality of The Forest Passage is an integral part of it, but Jünger’s conception of it is so amorphous that it often seems Jungian or similar to the work of Joseph Campbell — it’s as if he’s superimposing Christian morality on all myths.
This brings me to my favorite line in the book, which opens up a point of entry for those of us who see a somewhat different forest: “Myth is not prehistory; it is timeless reality, which repeats itself in history.”
If we use the forest as a code for the timeless world of myth that exists in us, and choose to perceive it as being alive in something as cold and dead as shopping mall parking lot or a government building, we can experience life differently.
In a recent interview I did with Paul Waggener from the Wolves of Vinland [4], he said that Germanic mysticism was his life, and that the aim of ritual was to plant a seed that spreads out like the branches of a tree and affects every aspect of one’s life, until everything becomes ritual. One could say that a man who achieves this state of being is living in the forest, despite the desert.
The work of spiritual revolt in the desert, of keeping the forest alive and planting seeds of it in the sidewalk cracks of the mechanized world is what Jünger referred to as “the forest passage.”
In old Iceland, Jünger wrote, “A forest passage followed a banishment; through this action a man declared his will to self-affirmation from his own resources.” A man on the forest passage “‘takes the banishment in stride” and becomes his own warrior, physician, judge and priest.
Jünger warned forest rebels away from the controlled, predictable and pointless forms of rebellion, like voting “no,” and offered that a man scrawling “no” on a wall would have a greater impact on the minds of those around him. Spreading dissenting and destructive ideas and information can have a greater impact than making an official gesture that can be easily tracked, quantified and punished.
One can never know the true motives for the sniping of anonymous online characters today, and it is difficult to gauge their sincerity because they are ultimately accountable only to themselves and can easily change positions or be complete hypocrites. However, it is possible and likely that some are truly sincere and have chosen the forest passage because it allows them to do greater harm to the desert forces. Those who fund the operations of more public figures and organizations are also examples, as they must remain covert to continue to generate the income that they funnel into insurgent operations.
Jünger did understand that change would not come from ideas alone, and that action would also be necessary. In several passages, he predicted the necessity of service-disrupting fourth generation warfare tactics of the type outlined in John Robb’s Brave New War. The forest rebel,
. . . conducts his little war along the railway tracks and supply routes, he threatens bridges, communication lines, and depots. His presence wears on the enemy’s resources, forces them to multiply their posts. The forest rebel takes care of reconnaissance, sabotage, dissemination of information in the population.
However, Jünger wanted to be clear that while the forest rebel does not fight “according to martial law,” he does not fight like a bandit. He wasn’t clear what the difference is between a bandit and a rebel, and distinctions like this seem like little more than moral posturing. The controlled masses will see the actions of any forest rebel the way they see the acts of terrorists and criminals. After all, he saw how fragile our status as non-criminals was and would be, and wrote:
None of us can know today if tomorrow morning we will not be counted as part of a group considered outside the law. In that moment the civilized veneer of life changes, as the state props of well-being disappear and are transformed into omens of destruction. The luxury liner becomes a battleship, or the black jolly roger and the red executioner’s flag are hoisted on it.
This is one of the great strengths of The Forest Passage, and a good reason to read and contemplate it. Any of us could be forced into a position — such as prison — where solitary and spiritual revolt is the only form of revolt left available to us. Understanding the nature of power and the nature of the modern bureaucratic systems means understanding that you will receive no justice from the system, and that you may find yourself completely alone.
The resistance of the forest rebel is absolute: he knows no neutrality, no pardon, no fortress confinement. He does not expect the enemy to listen to arguments, let alone act chivalrously. He knows that the death penalty will not be waived for him. The forest rebel comes to learn a new solitude . . .
Like any prisoner of war who knows he will not be rescued, he is ultimately alone with his honor.
However useful, this focus on solitude and the absolute moral authority of the individual requires some sort of caveat. This kind of alienation and absolute individualism limits human connections and makes human relationships disposable. It is a product of and the way of the desert. It is the way of the inveterate consumer who chooses one identity today and another tomorrow, fearful of the risks associated with true commitment to other people.
The forest passage is a strategy for desperate and fearful times. It is a tool for the prisoner, whether behind bars, or behind a desk typing with a camera over his shoulder and some algorithmic authoritarian tagging and monitoring his keystrokes.
Any vision of a forest worth preserving must include a reconnection not only with myth, but with men. The end must be to find a tribe among the trees, or the forest itself, however magical, will forever be a lonely and fearful place, and it will offer little comfort from the encroaching desert.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/06/a-tribe-among-the-trees/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/06/ForestPassage.jpg
[2] The Forest Passage: http://www.amazon.com/gp/product/0914386492/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0914386492&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=OFSI2UZ5WKZGALOV
[3] The Nothing: http://www.amren.com/features/2014/05/identity-defies-the-global-marketplace/
[4] In a recent interview I did with Paul Waggener from the Wolves of Vinland: http://www.jack-donovan.com/axis/2014/06/start-the-world-podcast-episode7-the-wolves-of-vinland/
00:09 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Entretiens, Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook